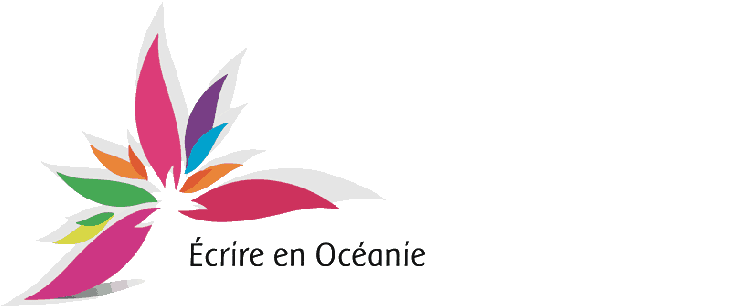Étude de Quintet, un roman de Frédéric Ohlen par Nicole CHARDON-ISCH
Quintet
ou la genèse du vivre-ensemble
___
Étude de Quintet,
un roman de Frédéric Ohlen
par
Nicole CHARDON-ISCH
Mai-Août 2014
Remerciements
Que mon époux Augustin Isch soit remercié ici
pour les traductions des passages en allemand.
Toute ma gratitude va également à l’auteur du roman, Frédéric Ohlen,
qui a bien voulu relire et enrichir ces pages,
m’accorder du temps en entretiens et en relecture.
— SOMMAIRE —
I. Genèse d’un projet
II. Composition de l’œuvre et signification du titre
III. Périples et déplacements
IV. Le feu et ses réminiscences
V. La ville au XIXe siècle et les conditions de vie des colons
VI. Les personnages féminins : Maria Dohrn, Naïtani Paddon, Elena Metzger.
VII. Les personnages masculins : le gouverneur Charles Guillain et le saint-simonisme ; les Kanak : Kuindo, Medjamboulou ; les colons : Heinrich Ohlen, Jean-Baptiste Gustin, l’instituteur ; Fidély, la Tête-Pointue ; Paunchy Billy, le bagnard évadé ; James Paddon ; Ferdinand Knoblauch ; le juge Charles de Rieu.
VIII. La traite des Mélanésiens
IX. Mythes et croyances
X. Intérêt de l’œuvre
XI. Sources et bibliographie
XII. Note sur la franc-maçonnerie
I. Genèse d’un projet
En rupture apparente avec sa pratique de nouvelliste et de poète, Frédéric Ohlen publie un premier roman, Quintet, tiré à 3 500 exemplaires chez Gallimard (collection Continents noirs). Il ne cache pas sa fierté d’avoir contribué, à l’instar de Claudine Jacques, autre écrivain prolifique du Caillou, à introduire les œuvres francophones néo-calédoniennes dans l’espace romanesque français.
Les faits se déroulent entre 1859 et 1864, en Nouvelle-Calédonie essentiellement, sous la tutelle du gouverneur Charles Guillain, juste avant l’arrivée de L’Iphigénie et l’installation du bagne. L’intrigue repose sur une constante interaction entre cinq personnages amenés à se rencontrer, riches d’expériences préalables et individuelles, mais unis, bien avant l’heure, dans une sorte de destin commun. Ils devront aller à la rencontre de l’Autre, s’affronter, se découvrir, se reconnaître, dans une atmosphère de méfiance, de paternalisme ou d’amour. La peur, l’incertitude, l’affection, mais aussi l’ambition forment la clef de voûte du roman.
C’est l’histoire d’Heinrich, l’aïeul allemand, l’histoire des colons volontaires venus d’Europe et d’Australie, la création d’une école pluriethnique non religieuse, l’horreur des blackbirders esclavagistes monnayant la force de travail des Mélanésiens exilés de force ou trompés par la trouble notion « d’engagé volontaire ». C’est aussi la chronique des terribles dysenteries qui ont décimé les populations kanak, le discernement humaniste de Maria. C’est l’amour chanté pour une terre qui est bien plus qu’un « morceau de nickel » ou qu’un « monceau de disputes ». C’est la fierté kanak et le mythe colonial résorbés dans l’adoption et les pactes d’alliance. C’est l’initiation de Fidély, fil conducteur venu des Nouvelles-Hébrides, avaleur de livres qu’il appelle « franges », et bénéficiaire (et/ou victime) du métissage culturel, préfiguration de la mondialisation. C’est enfin la convocation des mythes océaniens.
L’imagination dans ce roman historique et engagé est étayée par des documents authentiques, des archives et des journaux d’époque. Le romancier fait la part belle à la poésie tout en n’omettant pas les difficultés du réel : point d’idéalisation mélanésienne avec les colons, un cadre spatio-temporel hostile, où tout est à faire – ou à défaire, des mots durs pour dénoncer l’esclavage, les abus coloniaux, les erreurs des frères maristes, le bagne qui pointe le bout de son nez avec le risque de complexifier et de tendre les relations. Enfin, traversé par la culture classique et subtile de l’auteur, le roman distille une riche intertextualité.
Frédéric Ohlen a su, en remontant les traces du passé, trouver un alter ego génétique et spirituel en la personne d’Heinrich. Le romancier ne se reconnaît pourtant dans aucune des thèses défendues par ses personnages, à l’exception notable de Maria Dohrn, celle qui prend soin des corps et nie les distances, et du capitaine de Rieu, celui qui cherche la vérité.
II. Composition de l’œuvre et signification du titre
La composition du roman n’est pas homogène. Composé de cinq parties inégales en longueur, il fait allusion dans le titre à une composition musicale constitué de cinq instruments, avec chacun sa voix, son timbre. Le terme quintet est employé au sens littéral une seule fois dans le chapitre final, quand le juge de Rieu évoque un concert où son épouse Emma s’est rendue.
Dans les deux premières parties, la focalisation est externe. L’auteur parle des personnages à la troisième personne et met des guillemets lorsqu’il leur donne la parole. Maria (dite Kadamè), puis Heinrich, émigrés allemands d’abord installés en Australie, évoquent leur passé douloureux en Allemagne, Hambourg, leur ville détruite par un grand incendie, les aléas et les et les difficultés qu’ils affrontent lors de leur installation en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, dès l’incipit de la troisième partie : « Je suis né en 1840 à Namur », le narrateur (Monsieur Gustin, l’instituteur) s’exprime à la première personne. Il y narre les difficultés et les joies de son enfance et cet extraordinaire voyage qui le mènera en Nouvelle-Calédonie, via le Brésil.
La quatrième partie, la plus longue, centre de gravité du roman, commence ainsi : « Cette nuit aussi, j’ai rêvé de Paunchy Billy. » Le narrateur (le Mélanésien Fidély) s’exprime à la première personne et, marque d’altérité et d’incompréhension voulue par l’auteur, les propos de son ami Billy sont retranscrits en anglais sans traduction littérale – ce qui n’était pas le cas pour l’allemand. La sensibilité de Fidély, son extraordinaire capacité à intégrer des notions nouvelles, son don inouï pour les langues, sa passion pour sa compatriote Naïtani, femme du négociant James Paddon, sa discrétion, son tempérament pacifique attirent et surprennent. Fidély occupera des fonctions variées : traducteur, homme de confiance, agent d’émigration, super nounou, aspirant franc-maçon…
La troisième phrase de la cinquième partie est la suivante : « En accédant à sa demande, en lui fournissant plume et papier, je n’aurais jamais pensé qu’il puisse aller aussi loin. » Le narrateur est un juge de paix, le capitaine Charles de Rieu, qui s’exprime à la première personne. Les réflexions du juge sur le monde qui l’entoure, sur la gestion de Guillain, sur le cas Fidély servent a priori d’épilogue au roman par les éclairages croisés et complexes qu’elles apportent concernant tous les autres personnages.
Le Néo-hébridais Fidély fait le lien entre toutes les séquences. Par ailleurs, celles-ci s’étoffent et se complètent mutuellement à la manière d’une partition musicale. Une coda vive et venimeuse avec une cinquième partie (et même une sixième !) pour conclure. Ainsi, la variété des points de vue sur les mêmes événements, complétés par l’histoire personnelle de chacun, les représentations et la sensibilité des divers narrateurs, donne lieu à des diégèses tout à la fois parallèles et interdépendantes.
La construction du roman est chorale et polyphonique. Elle renouvelle totalement la narration linéaire classique. Les divers récits s’enchevêtrent les uns aux autres, les points de vue sont multiples, le narrateur lui-même change régulièrement. Les genres narratifs se succèdent : discours, anamnèses, mise en abyme, récits mythiques ou légendaires, rêves, visions, journal intime, lettre et clins d’œil au lecteur contemporain… La narration est ainsi fondée sur une matière et une manière mouvantes complètement assumées.
Ce faisant, l’auteur montre une autre voie au roman historique et au roman tout court. Il renforce sa capacité à décrire la complexité du monde. Il souhaite libérer ainsi la littérature de son carcan pour faire de l’histoire mémoriale une œuvre d’art à part entière, fondatrice et éducative, exemplaire et universelle, plutôt que le simple réceptacle d’une saga familiale qui aurait été racontée, de manière univoque, du seul point de vue des pionniers.
III. Périples et déplacements
Le voyage, notion-clé du roman, constitue à lui seul un personnage, un franchissement nécessaire qui permet les rencontres, l’expression et l’opposition des désirs et des rêves. C’est le fil qui tisse la trame intime de Quintet.
C’est lui qui déplace Maria et Heinrich de Hambourg vers la Nouvelle-Calédonie, via l’Australie : « Malgré la ruée vers l’or, la crise économique avait durablement ébranlé le pays et les affaires tournaient au ralenti. Alors, quand Ferdinand, l’un de leurs fidèles clients, leur avait proposé de venir s’établir en Nouvelle-Calédonie, ils avaient cédé. » (p. 17).
C’est lui qui propulse, à ses risques et périls, l’instituteur Gustin depuis Namur jusqu’en Mélanésie, via l’île de Sainte-Catherine au large du Brésil.
C’est lui qui projette ici le gouverneur Guillain, nommé à un poste éminemment politique depuis la Métropole. Suivant les instructions de l’Empereur, il va initier l’établissement du bagne et fera venir les premiers transportés.
Lui encore, qui fait errer Fidély, entre passions, geôles, improbables rencontres aux Nouvelles-Hébrides, à Sydney ou en Nouvelle-Calédonie, et même jusque dans ses rêves ! Lancé sur les routes maritimes, l’adolescent suit son destin. S’accomplir soi, en respectant sa mission séculaire, ou s’aliéner ? Fidély sera-t-il fidèle ? Trahira-t-il son peuple et sa fonction véritable en se mettant au service des « Moissonneurs » ?
Un déplacement mental, un geste coutumier qui pousse aussi les Kanak à fonder une nouvelle alliance, à reconnaître officiellement l’adoption de Thiosse par Maria, ou qui, au contraire, les contraint à l’offensive pour s’emparer du « Camp aux Français », un embryon de ville qui focalise toutes leurs convoitises.
La Nouvelle-Calédonie, principale toile de fond du roman, est une terre riche de promesses, une terre qui fascine et qui exprime bien haut ses appétits de puissance et de jouissance. Les hommes qui modèlent son visage peuvent être des arrivistes sans scrupules, qui utilisent, pour paraître et s’imposer, tous les trafics et toutes les facilités qu’autorise le règne du plus fort et du plus malin. Ils peuvent être aussi, bien sûr, des gens humanistes et visionnaires, tels Heinrich ou Maria.
La Nouvelle-Calédonie n’a jamais cessé d’exercer une étrange fascination sur les hommes qui y vivent et sur tous ceux qui voudraient y demeurer. Vivre en Nouvelle Calédonie, c’est un rêve, une revanche, un impérieux besoin ; c’est la terre du recommencement, d’un nouveau départ, la terre de la seconde chance, parfois de la fuite en avant. Et, de fait, ni Maria ni Heinrich ne seraient partis sans le grand incendie qui les a descellés et blessés.
Courir, se sauver, échapper aux flammes, ranimer la petite Maria, rechercher son ami polonais Tadeusz, tels sont les ressorts qui motivent d’abord Heinrich, traumatisé à vie par le drame de Hambourg. Il y perdra sa foi. De cet épisode tragique date également son recrutement par la franc-maçonnerie et le projet d’école qui lui est associé.
Gustin, de son côté, obtient « de tels résultats à l’école qu’on [le] voyait déjà normalien… » Le voici instituteur. « Et puis, je reçus une lettre, cachetée à l’ancienne… » Un courrier d’Heinrich, mûrement réfléchi, datant du 5 août 1862, pour l’inciter à accepter un poste à Gadji.
Quant à Fidély, capturé par des esclavagistes, il sera libéré par Naïtani, sa compatriote, et se mettra librement au service du négociant James Paddon, puis des colons, se voyant même confier le rôle d’agent de colonisation. Après son évasion, il voguera seul vers d’autres aventures.
Paddon City, hameau fondé par le controversé James Paddon, ne fait pas que des heureux : les allocataires de parcelles, venus d’Australie, surtout des Allemands, « sont arrivés sur le Speck en provenance de Sydney. » D’autres sont repartis, écœurés par la rudesse de la vie en brousse. » (p. 117)
Cette volonté de peuplement à tout prix et d’émigration sera maintenue et ne fera que prendre plus de force au cours des deux siècles qui suivent, drainant condamnés de droit commun, communards, révoltés kabyles, travailleurs engagés volontaires de l’Asie du sud-est, de la Réunion, des Antilles, de l’Océanie en contingents plus ou moins organisés. Le boom du nickel, la perspective d’un enrichissement rapide dans le café ou le santal, la position stratégique du Caillou installeront durablement en Nouvelle-Calédonie des structures étatiques fortes et d’autres populations par définition fidèles à l’Empire puis à la République.
Après lecture des deux premiers chapitres de Quintet, d’Heinrich retenons cette phrase : « N’est-il pas dans l’ordre même de l’Esprit de se diffuser ? » Étymologiquement, esprit renvoie au souffle qui s’échappe : il ne peut rester sur place. Il est donc légitime de se référer à l’esprit pour justifier un déplacement. Heinrich incarne le désir fort de se rendre à l’étranger, d’y refaire sa vie. Des raisons économiques certes, mais surtout philosophiques le poussent à venir s’établir ici après une assez fructueuse période en Australie.
Maria a, quant à elle, la nostalgie de sa terre natale et cette nostalgie s’exprime dans un chant populaire qui fait partie d’un recueil publié entre 1805 et 1808 par Arnim et Brentano, une berceuse qui commence par ces mots : Guten Abend, guten Nacht. Beaucoup de textes de cette époque expriment cette tension entre l’attachement à ce que les Allemands appellent Heimat (le lieu où l’on se sent chez soi) et l’attirance pour l’Ailleurs et les voyages sans retour. « Maria ne s’était jamais imaginé finir ses jours ici, entre les vols des sauterelles et les incendies. » (p. 17) À Gadji, au lieu-dit Paddonville, les colons impriment leur marque mais restent ainsi hantés par leurs séjours précédents, tant en Australie qu’à Hambourg.
IV. Le feu et ses réminiscences
De tragiques incendies, tels ceux de Rome sous Néron, de Londres en 1666 ou d’Alexandrie, qui détruisit, quant à lui, un immense patrimoine littéraire, ont marqué les esprits depuis l’Antiquité. On se souvient de ce récit homérique dans L’Iliade, la destruction dans un gigantesque brasier de la ville mythique de Troie, au terme de la guerre qui aurait opposé au XIIe siècle avant J.-C., les Grecs menés par Agamemnon aux Troyens du roi Priam.
Depuis cette date fort reculée, la liste est longue des cités ou des monuments détruits par les flammes. On ne peut omettre d’évoquer cet épisode tragique et déterminant pour la ville allemande de Hambourg, berceau de Maria et d’Heinrich. En effet, l’histoire moderne retient parmi les faits majeurs du XIXe siècle l’important incendie de 1842, qui aurait détruit plus de 25 % de cette ancienne cité-État.
Les deux premières parties du roman sont émaillées de réminiscences de cette période. Le feu poursuit Maria et Heinrich de ses images destructrices ; ils le retrouvent dans les révoltes kanak, dans les fusils brandis, dans la peur de tout perdre, une fois encore.
On peut constater la permanence du thème du feu, surtout chez le couple Ohlen. Maria se remémore avec effroi les circonstances de sa fuite avec sa tante Gerta. Petite fille asphyxiée, évanouie dans la rue, elle doit la vie à l’intervention diligente d’Heinrich, qui la ranime de son souffle : « Ah… Le feu ! Sa phobie. Ça la poursuit. Une folie de vingt ans en arrière, qui l’emporte quand on enflamme une allumette. Une peur animale. Absolue. Qui surgit à l’improviste. La réduit à l’état de chiffe. La ramène à cette nuit-là, cette nuit du 4 au 5 mai, quand tout a commencé. Sinon, bien sûr, elle serait restée. » (p. 17) Ce feu-là rend tout retour en arrière impossible. Il faut partir, pour enlever cette « écharde » (p. 16), tenter d’éloigner les vieux démons. Pourtant, elle se revoit sans cesse « à Hambourg dans la fumée… » (p. 16) « Autour d’elle le monde entier brûle. » (p. 16). Dans son présent résonnent toujours les « cris d’une ville en flammes. » (p. 37).
De même, Heinrich éprouve un véritable malaise à l’évocation du passé et de la mort atroce de son ami polonais Tadeusz (p. 80). Sans parler de ses poumons brûlés.
V. La ville au XIXe siècle et les conditions de vie des colons
Nouméa n’est pas encore une ville. C’est une simple garnison militaire. En plus des marins, soldats et autres officiers, elle est peuplée d’arrivistes ou d’épaves, de rêveurs venus chercher là un monde meilleur, au péril de leur santé ou de leur liberté, comme le petit peuple de servants : ramasseurs de crottin, portefaix… On y trouve « moins de quatre cents civils, la plupart cantonnés dans la capitale, si l’on pouvait appeler ainsi une ville aux rues non pavées, sans port aménagé, sans eau potable. »
Le tableau topographique est peu réjouissant : « une cité puante, montueuse et marécageuse » (p. 38). Le désenchantement accompagne la misère des laissés-pour-compte : « Ils forçaient sur les brancards de leur brouette, s’arrêtaient soudain pour souffler, puis reprenaient leurs charrois grinçants. La plupart, anciens marins devenus bêtes de somme, n’avaient guère de chair sur les os. » (p. 68)
Entre le fort Constantine, qui deviendra l’hôpital Gaston-Bourret, l’île Nou et ses entrepôts privés, la résidence du gouverneur impérial qui tenait du Crystal Palace de Londres et de l’atelier d’un peintre, des cabanes érigées en toute hâte qui deviennent des hôtels-restaurants, tel celui de Maximilien le Hambourgeois, la ville offre un aspect bien disparate.
La brousse n’est pas épargnée et s’adapter à la vie rurale constitue un véritable défi : « Au début, nous avions si peu d’outils qu’il fallut imiter nos voisins mélanésiens, défoncer le sol avec des pieux de gaïac durcis au feu. Puis la situation s’améliora : il y eut de belles récoltes de haricots rouges et de luzerne, tous ces légumes que la baleinière venait chercher, une fois par semaine, depuis la capitale. Vous n’ignorez pas, non plus, comment mes deux grands chenapans de fils se sont très vite rapprochés des tribus de la région, et comment Maria, mon épouse, a souvent payé de sa personne en allant sur sa jument accoucher les patientes jusqu’à Tontouta et Tomo.
« Deux années ont passé. Nous voici maintenant durablement installés, malgré les sauterelles et les incendies, la sécheresse qui toujours menace et ces maladies infantiles que peinent à guérir les herbes, celles que partagent avec nous les mères indigènes. » (p. 50).
Gustin lui aussi, s’adapte à ces lieux, y trouve peu à peu son compte : « L’installation est sommaire, mais je m’y sens bien. Des conduites en bambou déversent les eaux de pluie dans une cuve maçonnée… » (p. 120)
VI. Les personnages féminins
MARIA est sans doute la grande figure emblématique du livre. Épouse d’Heinrich, elle a été sauvée par lui du grand incendie de Hambourg. Elle n’était alors qu’une fillette apeurée, et lui étudiant en théologie. Elle fera montre de finesse et de tact ; elle est celle qui apaise les tensions du corps et de l’esprit et qui redonne confiance. Les Kanak la renomment, ils la muent en « Kadamè » (Celle-qu’on-ne-peut-tuer) et lui remettent, en même temps que l’enfant adopté, les symboles du clan (perche, monnaie de perles). Une alliance est née qui rendra impossible les agressions entre Kanak et colons. Femme de confiance, elle conclut un pacte avec les natifs qui l’acceptent parmi eux, en la reconnaissant mère adoptive de Thiosse, le bébé qu’elle est parvenue à sauver (p. 33-40), se révélant plus forte que les esprits de la Mort.
C’est une femme dynamique, appliquée, rigoureuse, une femme de devoir et de courage : « Maria savait ce qu’elle devait faire. Chaque mouvement s’inscrivait déjà dans ses muscles : se lever, s’habiller, prendre son sac, sortir dans la nuit noire ne pas allumer, se déplacer au jugé, […] seller la jument, se hisser dessus. » (p. 15) Du fait de son expérience de soignante, elle exerce en Australie et s’est depuis longtemps tenue au fait des gestes à faire et des médications à employer : « Il y a bien des années, quand je fréquentais l’hôpital de Hambourg, j’avais lu le Kreuterbuch de Lonitzer, un livre ancien avec des planches magnifiques où il parle des pierres noires, la panacée contre la vermine. » (p. 127) Il n’est donc pas étonnant que ce soit elle encore qui sauve Gustin de l’empoisonnement par un coquillage à la piqûre mortelle. L’acte manqué, et pas totalement assumé, d’un Fidély jaloux et humilié (p. 123-125).
Elle aime chanter les berceuses de Brahms (p. 24-25) pour l’enfant kanak qu’elle vient de sauver, des comptines pour appeler le soleil (p. 26-27), des chansons héritées de son enfance et de sa tante Gerta pour bercer le nourrisson (p. 31). Souvent ses paroles suffisent, paroles d’apaisement, de délivrance ; elle assiste et aide à partir, quand les médicaments manquent et que le temps presse, voulant, par sa seule volonté et sa seule présence, repousser le moment de la mort : « Pas grand-chose pour les soigner. Ceux qui se vident de leurs eaux. Ceux qui toussent ou reniflent. Souvent, elle est juste là. Pour leur dire de revenir. De se battre. Cela ne suffit Pas. Maria s’entête. Elle insiste. Et toujours on vient la chercher. »
NAÏTANI, « reine » néo-hébridaise d’Anatom, n’a pas démérité non plus ; sous le faux prétexte d’acheter des îliens en piteux état, elle sauve en fait toute une cargaison esclaves et leur redonne la liberté. Elle est mise en lumière dans le chapitre consacré à Fidély, qu’elle arrache aux blackbirders, et surtout, dans la séquence finale où le juge De Rieu la jauge à sa juste mesure, tandis qu’elle suit les traces de son amant Fidély, arrêté pour tentative de meurtre sur la personne de Gustin, un Fidély maltraité et hospitalisé, évadé enfin.
Fille de chef néo-hébridais, elle est donnée en mariage et en garantie à James Paddon qui, sans l’aimer pour autant, s’assure ainsi de ses entrées et de sa sécurité dans la zone, lui déléguant peu à peu les pouvoirs de gestion de son comptoir commercial. C’est donc une femme puissante, un atout stratégique et diplomatique. Grande amoureuse, elle n’abandonnera cependant jamais tout à fait le jeune Fidély, qui est le père de sa première fille.
ELENA METZGER est femme de colon, catholique pratiquante et s’oppose, dans un premier temps, au mécréant Heinrich ; une rivalité larvée s’installe entre eux, résolue par le sens diplomatique du grand-père Ohlen. Elle obtiendra, à la toute fin, gain de cause en ouvrant une école-presbytère.
VII. Les personnages masculins
A. Le gouverneur Charles Guillain et le saint-simonisme
Charles Guillain fut nommé Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par Napoléon III le 17 mars 1862. La Nouvelle-Calédonie, érigée en colonie autonome, est alors dégagée de la tutelle de Tahiti. Tout est à faire : organiser la transportation, la colonisation pénale, la colonisation libre, créer l’Administration, développer l’économie et conduire une « politique indigène ».
Guillain prend en charge l’assainissement de Port-de-France, l’ouverture des premières voies de circulation (route de Païta). Il crée le service des Affaires indigènes, de l’enregistrement, de l’État civil, le service postal à pied, ouvre les écoles primaires de Gadji et de Napoléonville (Canala) et décide, treize ans avant la Métropole, que l’enseignement doit être, ici, obligatoire et gratuit.
Guillain est un saint-simonien, c’est-à-dire qu’il est favorable aux idées du comte de Saint-Simon, qui propose, au nom du Progrès, de la Justice et de la Paix sociale, un partage des richesses dégagées par le travail de tous. Selon lui, les gens qui possèdent le savoir ont l’obligation morale de le partager avec les ouvriers. Les talents de chacun devaient ainsi pouvoir servir à l’ensemble. En Nouvelle-Calédonie, Guillain rêve, à l’instar de son inspirateur, d’un métissage des populations qui formerait une nouvelle humanité, assimilée à la famille universelle.
Pour mettre en application les idées de Fourier et de Saint-Simon, Guillain tenta de créer un phalanstère à Yaté, une collectivité où l’on vivrait en autarcie et où l’on partagerait tout. L’expérimentation se solda par un échec au bout de deux ans. Toujours avec l’idée de regrouper et d’éduquer les futurs colons, Guillain encouragea la création de fermes modèles (Yahoué), de centres agricoles (Fonwhary, Néméara). Il souhaitait également favoriser la réhabilitation des condamnés et la colonisation pénale en attribuant des terres aux forçats libérés.
Il avait imaginé des armoiries où figuraient un bagnard à la chaîne brisée (passé douloureux) tenant une charrue, et un Kanak au casse-tête brisé (guerres tribales), remplacé par un filet de pêche. Les deux personnages sont placés derrière deux rameaux de coton et de café. La devise était « civiliser, produire, réhabiliter ».
Apprécié des colons qui requièrent ses services, il est regardé ironiquement par le juge De Rieu, qui le surnomme « Sa Majesté » ou « l’Imperator ».
B. Les Kanak
a) Kuindo
Kuindo, grand chef kanak du Sud de la Grande Terre, est présenté comme un stratège qui gagne en assurance, s’enhardit et élabore des opérations de plus en plus fructueuses contre les Men-oui-oui. Discrets, rapides, disposant d’un efficace réseau de guetteurs, « les guerriers de Kuindo se dérobaient sans cesse ». « Au départ… Kuindo se souciait fort peu de Port-de-France, simple camp de toile où ne résidaient jamais plus de cent cinquante personnes, sinon pour y dérober à l’occasion des marchandises ou des espèces. Cent cinquante âmes, autant dire rien au regard du millier de guerriers qu’il pouvait, lui, réunir. Puis il s’enhardit, profitant de ses bonnes relations avec James pour cacher ses pirogues à l’île Nou et mener, depuis cette base avancée, des raids en ville. » (p. 185). Les troupes coloniales organisent la contre-attaque, et, grâce à l’appui, de Waton, ennemi de Kuindo, parviendront à s’emparer du chef rebelle.
Après avoir négocié les termes de sa reddition avec les White men, Kuindo [qui sera, dit-on, exécuté plus tard par Nondo, son ancien chef de guerre], renonce ainsi à une partie de ses terres et à ses attaques. « Il promettait notamment de ne plus s’en prendre aux établissements de Saint-Louis et de la Conception. » (p. 188)
b) Medjamboulou
Sorcier d’Aliki-Kai à Canala, il aide le commandant de la Bayonnaise à mener une expédition punitive d’une violence aveugle après la disparition suspecte d’un groupe de chercheurs d’or. Grâce à son entregent et à ses pouvoirs, il s’engage ensuite à retrouver les vrais coupables. Au terme de ces recherches et de ces combats, il est récompensé par le don d’un fusil précieux, propriété de M. Pannetrat. Medjamboulou exerce, par ailleurs, un ascendant certain sur Fidély. Il hante ses rêves, lui enseigne l’art de voyager par l’esprit dans le temps et dans les consciences, vampirise son énergie pour se régénérer, quitte à lui apparaître même après sa mort pour piller la sacoche, selon lui forcément maléfique, du premier facteur kanak !
C. Les colons
Outre Heinrich Ohlen et son épouse, Maria Dohrn, on trouve MM. Anton Metzger, Abel, Blair, James, Lynch, Gaertner et Human. À côté de ces personnes, dont les noms ont tous des consonances germaniques et anglo-saxonnes, d’autres familles, les absents (p. 47), ont regagné l’Australie, découragées par la dureté de la vie en brousse : manque d’outils aratoires, de semences, incendies, vols de criquets, épidémies…
a) Heinrich Ohlen
Fort de sa situation d’hôtelier, il s’est, au départ, entremis à Sydney pour recruter des familles volontaires. Heinrich possède donc une certaine influence sur la petite communauté de colons établie à Paddonville. Visionnaire, il a la stature d’un urbaniste, d’un politicien bâtisseur, qui souhaite avant tout faire progresser l’esprit humain, enseigner, transmettre, loin de toute superstition, les Lumières. « Quand nous sommes arrivés ici, en mission de reconnaissance, nous n’avons pas débarqué à Gadji. Nous avons dû bivouaquer à la dure sous les banians qui bordent la baie de la Moselle à Port-de-France, ceux que nos descendants pourront sans doute admirer un jour entre – pourquoi pas ? – une bibliothèque et un commissariat, quand la ville sera devenue autre chose qu’un dédale de rues sales et de fossés malodorants. » (p. 49)
Fondateur d’une loge maçonnique, avec Dominicus Lynch, il va jusqu’à creuser, une chambre de réflexion, destinée à accueillir les nouveaux initiés, tel Gustin ; un lieu où les futurs Maçons se doivent de méditer et de mourir à eux-mêmes, avant de rédiger leur testament spirituel. Heinrich est un intellectuel, un meneur d’hommes, avec de la prestance (sa mise est toujours soignée) et beaucoup d’assurance dans ses discours : « Puis il les convoqua tous. (p. 47) Heinrich était en verve. » Il emploie volontiers le ton d’un général haranguant ses troupes et sait susciter adhésion et enthousiasme : « Sans plus tarder, rédigeons et signons une pétition en ce sens. Je mettrai mon meilleur habit et j’irai la porter moi-même au gouverneur Guillain. Je plaiderai notre cause. » (p. 51)
Il sait fédérer les colons et ménager habilement la chèvre et le chou. Laïque et franc-maçon, il respecte autant que possible cependant les croyances et les susceptibilités d’Elena Metzger : « Permettez-moi de créer librement mon école et j’autoriserai ce lieu de culte et ce catéchisme si contraire à mes convictions. Elena hocha imperceptiblement la tête. Marché conclu. Elle chanterait les hymnes, enseignerait son credo. Lui, ferait de son côté ce qu’il voudrait. » (p. 49)
Cela n’empêche pas sa détermination farouche et son scepticisme à l’endroit d’une religion et d’un dieu cruel incapable d’épargner, au jour du grand désastre, sa ville bien-aimée et son meilleur ami. D’où son amertume à l’évocation de l’incendie de Hambourg : « Le chœur des cantiques qu’entonnaient chaque soir les Metzger sous leur véranda lui soulevait le cœur. Le dévorait comme un acide. Il aurait préféré renoncer à entendre sa langue, plus le moindre mot en allemand plutôt que la ronde de ces ritournelles inutiles. Cela ne les avait pas sauvés à Hambourg. » (p. 47).
On se souvient qu’Heinrich était étudiant en théologie. Son initiation à la franc-maçonnerie apparaît, dès lors, comme un engagement philosophique dans le droit fil de cet épisode douloureux qui a transformé sa vie en l’empêchant désormais de croire.
Heinrich a encore des certitudes, des principes et des valeurs. Il ne doute pas et fonce, droit au but, négligeant les difficultés, confiant dans son projet éducatif : il lui faut absolument construire une école, laïque, pluriethnique, c’est-à-dire la base de cette société nouvelle qui s’installe et qui va croître. « Conforté dans son entreprise, Heinrich s’entêta. » (p. 45). Le personnage prend à force la figure d’un démiurge ou d’un prophète. Paradoxe pour un franc-maçon qui s’érige presque en créateur divin et se complaît dans une autosatisfaction sujette à caution.
Évoquant le laborieux et fructueux chemin déjà accompli en deux ans, Heinrich justifie aux yeux des autres colons son rêve humaniste et ambitieux. L’homme de bien, l’homme responsable doit dépasser les contingences matérielles et faire rayonner l’Esprit : « Pourtant, à mes yeux, tout cela n’est rien. L’Homme ne vit pas seulement de… fayots, avec des tâches à accomplir, un métier juste et honnête, assez dans son assiette et un toit sur la tête. Il lui faut davantage pour grandir et espérer surpasser sa nature et ses instincts, en un mot, d’homme devenir humain ! » (p. 50)
L’apologue d’Hiram Abif – l’architecte assassiné du roi Salomon, tué certes par ses mauvais disciples, mais immortalisé et réincarné sans cesse par chaque génération d’initiés reconstruisant, symboliquement et concrètement, par leurs saines actions, le temple intérieur – exprime ici la permanence des valeurs qui fondent l’homme universel.
Car tout homme de bien se doit d’interpeller son semblable, pour lui proposer un chemin vers une forme supérieure d’accomplissement, en contradiction souvent avec les contingences quotidiennes d’un groupe qui déjà peine à survivre. Fier de son obédience maçonnique, Heinrich n’hésite pas à fédérer, quitte à bousculer : « Non, James, ne vous fâchez pas ! Désormais les chèvres apprendront à se garder toutes seules ! Et le petit Jemmy, j’en puis jurer, saura ses tables et sa conjugaison ! Vous saurez vous passer, vous aussi, je l’espère, du concours de votre progéniture pour le travail des champs. Que valent, je vous le demande, un épi de maïs ou un chou de Chine à l’aune d’une récitation bien sue ou d’une preuve par neuf ! » (p. 51)
L’art de bâtir, la détermination, la tension vers la réalisation du grand Œuvre, le mènent à Nouméa, où il obtient à demi-mot la bénédiction du gouverneur. Bien avant cet adoubement, Heinrich s’était déjà mis en quête de celui qui deviendra l’instrument de son Rêve : Jean-Baptiste Gustin, jeune instituteur belge venu de Namur.
Seul bémol à sa réussite : l’empoisonnement – raté – de Gustin par Fidély. Par la magie d’abord, toute une série « boucans » placés sous le lit de l’enseignant (sans résultat), par la collecte d’un coquillage mortel (Conus geographus) ensuite. Il s’agit, a priori, d’une véritable trahison, aggravée par l’ouverture tardive d’une école-presbytère. Après l’attentat et la déstabilisation du maître, petit à petit les maristes regagnent, en effet, du terrain.
b) Jean-Baptiste Gustin
C’est le premier instituteur laïque en poste en Nouvelle-Calédonie. Il est d’abord évoqué, sans être encore nommé, dans la seconde partie consacrée à Heinrich. Mais c’est dans la troisième séquence, que Gustin raconte, par un récit à la première personne (qui est, en réalité, un testament philosophique en épanadiplose, rédigé dans la « chambre de réflexion » souterraine préparée par Heinrich), son enfance batelière, sa vie au Grognon, quartier de Namur entre Sambre et Meuse. Né d’un père, propriétaire d’une péniche, assez tôt disparu, et d’une mère retirée dans un ermitage flamand, il est élevé par sa tante Mizi, personne fantasque et libre tentée par l’ésotérisme et l’épicurisme. Une enfance assombrie de mystères et pourtant heureuse : « Ma tante avait le cœur vaste, le corps et l’esprit aussi déliés que sa bourse. » (p. 90)
Sa formation éclectique et sa générosité le conduisent à chanter dans une troupe de saltimbanques qui se sont donné pour mission de venir en aide, en toute discrétion, au plus démunis (p. 93). Parmi eux, il s’essaie à l’art du mentir vrai (p. 94), devient instituteur, et reçoit enfin la lettre comminatoire d’Heinrich l’invitant à rejoindre sans délai son nouveau post en Nouvelle-Calédonie : « Je vous attends. » (p. 95-97)
Vite initié, il entrera dans le tumulus creusé par Heinrich comme on entre en chevalerie, dépouillé de ses possessions, de son métal, de ses savoirs, de sa technologie, entouré des symboles de son état mortel (crâne, pain moisi), vanités de rigueur en pareil cas. Il se rappellera alors de tout ce qui lui est advenu, et fera part de ses erreurs, de ses doutes sur la nature et la portée, pour les natifs, de son enseignement. « Je devrais être content. L’inspecteur est venu. Le gouverneur aussi… C’est décidé, ils nous aideront. Des crédits seront votés. » (p. 134) Car il a refusé, entre autres, la présence d’un étrange Néo-hébridais, sur les bancs de sa classe. Sans doute parce que Fidély, avec son crâne déformé, ses intuitions inexplicables, n’est à ses yeux qu’un monstre, un sujet voire un objet d’étude. Une double faute qu’il semble devoir payer de sa vie ! L’affaire passe en justice et ébranle le pouvoir : toucher à l’instituteur, c’est attenter à la politique impériale !
D. Fidély, la Tête-pointue…
Il apparaît dès la première partie du roman consacrée à Maria. Il y traduit (p. 33) les propos du chef de clan venu « faire la coutume » à l’infirmière héroïque, pour la confirmer dans son rôle de mère adoptive. Jeune a priori, aussi difforme qu’un hydrocéphale, il est un peu l’homme à tout faire : interprète, cultivateur, agent de Paddon, nounou et « cheval » de Thiosse, le fils kanak des Ohlen. Mais c’est dans la quatrième partie qu’il prend toute son ampleur, rappelant à cet égard le Figaro de Beaumarchais. Ce personnage a de la densité à plusieurs titres.
C’est un Néo-Hébridais à la tête allongée, comme la coutume l’impose dans son archipel. Serrée dans des fibres végétales dès leur plus tendre enfance, la tête de ces enfants-là est étirée lentement, ce qui leur confère un statut particulier : gardien de la paix en vertu d’accords très anciens, truchement avec les esprits des morts et ceux des animaux-totems, marins notamment, conservateurs aussi d’une millénaire mémoire. Les « Têtes-pointues » ne portent pas d’armes et imposent le respect. Au grand désespoir de Fidély lancé, un peu malgré lui, sur les routes terrestres et maritimes, sa tête, libérée de son carcan initial, s’arrondit de savoirs nouveaux et de pratiques nouvelles. Ne s’est-il pas renié lui-même ? Pourra-t-il conserver longtemps intacts sa fierté, son libre accès au Rêve, avec ses voix ou ses voies diverses, animales et humaines ?
La révélation du malheur et de la souffrance des autres lui est insupportable. Tels ceux de son ami Paunchy Billy, bagnard évadé hanté par ses souvenirs. Très tôt cet éternel jeune homme aspire au repos. Mais les héros ne meurent jamais tout à fait et Fidély semble avoir neuf vies comme les chats ! Au début, le whale-boulouk, son dugong totémique et son âme-sœur, le sauve de ses idées suicidaires : « Beaucoup disent que le whale-boulouk est idiot parce qu’il ne se bat pas. Il est si facile à tuer. Ce n’est pas une proie pour un homme. Mais le whale-boulouk rêve aussi bien qu’il nage. D’un seul coup de nageoire il passe comme moi aisément du clair à l’obscur, d’un océan l’autre. Pas plus que l’eau, la nuit ne nous sépare. Nous sommes liés. Où que je sois, il est aussi. »
Une fois sauvé des esclavagistes par un mammifère marin mystérieux (une baleine ? nommée plus tard, p. 271, la « Toute-Bonne »), puis par Naïtani, il jouit de privilèges spéciaux dans le comptoir d’Anatom, aiguise sa soif de savoir, découvre pages et images, se familiarise avec l’écriture, devient amant et père, et finit homme de confiance de James Paddon, le mari officiel de Naïtani. L’ambiguïté de ce trio amoureux réside sans doute dans l’union, d’abord de pure forme, de James avec son épouse morganatique et dans l’habileté du négociant à entraîner un Fidély curieux de tout dans son sillage, et donc à l’éloigner de facto de Naïtani. « À la demande de James, j’allai à Gadji rencontrer Kuindo. » (p. 187) « James joue, une fois de plus, les tentateurs. Pour me changer les idées, il me propose d’accompagner Ferdinand à Sydney. » (p. 189) En dépit de son goût prononcé pour l’aventure, Fidély n’est pas dénué de scrupules : « En voulant bien faire, par amitié pour mon employeur, n’avais-je pas hâté la disparition des tribus ? N’étais-je pas devenu une sorte de blackbirder bis ? » (p. 188)
Attaché à la paix, Mélanésien comme les Kanak, il se retrouve pourtant en complet porte-à-faux entre le marteau et l’enclume, au cœur des négociations qui tournent souvent au désavantage des natifs. Choc des civilisations… Sa sensibilité et son empathie, sa tradition et ses antiques connaissances se heurtent à sa fidélité instinctive, celle qu’il voue aux colons qui l’emploient, le distraient et l’instruisent. Par ailleurs, on le devine plein de commisération pour le chercheur d’or rescapé d’un massacre : « C’est un homme brisé. Amnésique. Qui se nourrit à peine. Qui marche à petits pas, droit devant lui, sans savoir où il va. » (p. 182)
C’est enfin la force de ce personnage, capable d’ébranler le rêve d’Heinrich, la base du gouvernement Guillain, la carrière du juge Rieu, la jurisprudence elle-même. Chassé par Ferdinand Knoblauch, il sera accueilli par la famille Gaertner, puis « piégé » par Heinrich, car le petit Thiosse, inexplicablement, lui ressemble : même crâne allongé, même capacité à passer d’une rive à l’autre, de l’Occident à l’Océanie. Fidély s’attachera donc à lui, deviendra son gardien permanent et son compagnon de jeu. Avide d’apprendre, le jeune homme essaie de se glisser dans les rangs des écoliers, mais il est vite repoussé par l’instituteur Gustin, qui le craint. S’ensuit une sourde rancune, du fait qu’on lui refuse aussi l’initiation maçonnique, dont il a pourtant parfaitement compris le sens. Même en proie à un vif ressentiment, « l’enfant de la paix » pourrait-il devenir un tueur ?
Accusé d’avoir fomenté l’empoisonnement de Gustin, il est attaché, maltraité, emprisonné. Du fond de sa geôle, il racontera au juge De Rieu, par écrit, son histoire : sa confession, avant de s’ouvrir les veines. Fidély pense, en effet, que les jeux sont faits et qu’on va le fusiller. Il sera hospitalisé suite à sa tentative ratée. Plus tard, à son chevet, nombre de visiteurs, logiques ou incongrus, tenteront, durant la même nuit de folie, de lui redonner espoir et de le faire évader. Parce qu’il sait entrer en sympathie avec tous, Fidély bénéficie d’une aura exceptionnelle qui fait oublier son aspect effrayant et son âge apparent.
E. Paunchy Billy
D’origine anglaise, c’est un runnaway convict, un bagnard évadé, recueilli par des trafiquants et débarqué de son navire parce qu’il est dans le coma, en proie à la fièvre. Il est soigné, tout à la fois de ses cauchemars et de sa maladie, par Fidély, assisté des esprits marins. Une solide amitié naît entre eux. Pas assez « élastique » pour apprendre la langue locale, Paunchy Billy, s’exprime plus volontiers en anglais. Par un reste de coquetterie, il tient à sa dignité de sujet britannique. Ainsi, il ne veut pas aller nu et conserve donc ses oripeaux d’origine. Profondément irrité par l’esclavage, il va lutter quasiment seul contre un débarquement de blackbirders et donner sa vie pour sauver Fidély et tous les siens.
F. James Paddon
C’est le créateur de Paddonville. « Il vient d’obtenir de l’État une concession de quatre mille hectares à Païta, dans le bassin formé par les rivières Karikouié et Katiramona. Il a chargé Ferdinand d’aller recruter des colons en Australie.Une vingtaine de familles. Elles signeront un contrat de cinq ans et pourront ensuite disposer d’un lopin. » (p. 189)
G. Ferdinand Knoblauch
Tout à fois magasinier et comptable, c’est l’homme de confiance et le régisseur de Paddon. Arrivé en Nouvelle-Calédonie avec Pannetrat, il se joindra plus tard à l’équipage de la Bayonnaise et aux hommes d’Aliki-Kai lors du raid de représailles contre les supposés assassins des prospecteurs disparus. Il ira au combat avec un pistolet sans percuteur, puis sera le premier Européen à traverser de part en part le pays pour se rendre à pied à Port-de-France. Il y sera fêté en héros, engagé par Paddon, puis missionné pour attirer des migrants.
Depuis son expédition pédestre, Fidély ne le quitte plus. Il l’accompagne même à Sydney pour le seconder dans sa mission. Grâce à Ferdinand, il découvrira une pièce de théâtre : La Douzième Nuit de Shakespeare. Expérience non concluante pour Fidély, qui, au retour, se brouille avec son ami, opiomane de longue date, en essayant de le sauver de son addiction.
H. Le juge Charles De Rieu
Homme d’un haute conscience morale, il estime n’avoir pas grand-chose à reprocher au prévenu Fidély, mais se révèle fort gêné face à l’institution, qui réclame tout à la fois « justice » et sanction. Il reconnaît vite la force mentale exceptionnelle et le charisme du Néo-Hébridais. L’empathie n’est pas loin. Le corollaire immédiat : une attitude très critique vis-à-vis de Guillain dont il ne partage pas vraiment les idées. Refusant l’excès de zèle, il essaiera de faciliter l’évasion du détenu de son hôpital-prison en lui fournissant billet, papiers et argent. Mais c’est, au final, son subalterne Russier qui fera émerger, en lui comme en Fidély, une autre part de lumière : sensibilité, simplicité, retour aux rêves d’enfance, aspiration à la paix. La ville coloniale et la Justice, toutes de contradictions, mettront le magistrat au pied du mur. Comme Russier, en Indochine puis à Port-de-France, le juge fera son choix, au risque de tout perdre.
VII. La traite des Mélanésiens
Le mot blackbird, d’origine anglaise, signifie merle noir. C’est dire toute la symbolique de la proie, présumée forcément naïve et sans cervelle, que ce terme raciste révèle (à rapprocher aussi de pidgin english, qui vient, lui, du mot français pigeon…).
Durant des décennies, des aventuriers sans scrupules, des blackbirders d’origine européenne, ont trompé les îliens en arborant l’insigne des missionnaires : la croix du Christ, en leur offrant des présents (vivres et effets personnels), puis en les invitant à bord. Confiants, les Océaniens s’approchent alors dans leurs pirogues, montent sur le pont. À ce moment précis, les hommes d’équipage coulent par le fond leurs frêles esquifs en les bombardant avec des pierres de lest. Ceux qui veulent s’enfuir à la nage pour rejoindre le rivage sont tirés à vue. Pire, les malades, les femmes et les enfants seront plus tard jetés à la mer, car ils n’ont pas ou plus de valeur marchande.
On les vendra dans les mines d’argent péruviennes ou dans les grandes plantations australiennes de coton ou de canne à sucre – cinquante dollars-or par individu. Une plus-value énorme qui pousse les blackbirders à continuer leur trafic, malgré la menace de mort qui pèse sur eux, puisqu’ils sont assez mollement pourchassés par les marines anglaise et française, censées les condamner ipso facto, s’ils les appréhendent en flagrant délit, à la peine capitale.
Même à Port-de-France, un magasin ayant pignon sur rue propose aux colons et aux commerçants des boys indiens ou néo-hébridais. Sous couvert de contrats de travail réguliers, d’accords officiels avec les chefs mélanésiens et les autorités administratives, les négociants, déguisés en agences de placement, se livrent ici aussi à une véritable traite. Pas de vrais salaires car les écarts de conduite sont sanctionnés, à la libre appréciation de l’employeur, par de fortes amendes défalquées des sommes dues. Pas de droit réel au retour. Une nourriture insuffisante. Des châtiments corporels. Bref, des conditions de travail atroces, indignes des Lumières…
VIII. Mythes et croyances
On pense au placenta de l’enfant orphelin, enterré par Maria au sommet d’une colline au-dessus de la maison Ohlen. Ce fragment de l’œuf primordial nourrira plus tard un pin colonnaire, symbole de l’homme chez les Kanak. Ainsi, une promesse est faite, matérialisée par ce rituel. L’enfant adopté sera grand et fier. Il vivra toute sa vie chez les Men-oui-oui.
Le cérémonial du deuil et de la mort chez les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie (autodestruction des cultures, veille des dépouilles mortelles jusqu’à leur complète putréfaction, arrêt par sortilège de l’alizé…) n’entre pas en conflit avec les barouds d’honneur de Maria, qui tente, coûte que coûte, de sauver chaque malade, passant elle-même sans dommages à travers toutes les épidémies. Les Kanak reconnaissants lient avec elle un pacte d’alliance et d’assistance réciproque (p. 34 et suivantes), garantissant par là une trêve et une volonté d’entraide destinée à perdurer sur des générations. Sa pratique d’infirmière, sa générosité et sa témérité, son caractère bien trempé l’érigent alors de facto en ambassadrice politique. Elle est reconnue plus forte que la Mort : « Toi, gloussa-t-il, l’Obscur ne te rattrape pas. Trop dure, ta tête… » (p. 37)
On pense également à l’animal-totem de Fidély : le whale-boulouk, un dugong appelé aussi « vache marine », qui le guide dans le rêve comme dans le réel, quand il veut, par exemple, prendre conseil auprès de ses ancêtres ou apaiser un esprit tourmenté. Le passé (très) antérieur et le monde des esprits ne sont jamais loin. Fidély, poussé et manipulé par Medjamboulou, les invoquera pour contrer l’intrusion de Gustin, qui apporte un autre savoir, destructeur par essence, s’érige en savant (phrénologue) et lui refuse l’accès à l’école. L’« emboucanement » du maître est dès lors programmé. En vain. Il faudra bien plus pour l’abattre et le désorienter…
Car le « pacolet » de Gustin, un talisman antique donné par sa tante, le sauve apparemment de toutes ces avanies, neutralisant boucans maléfiques et venin. Magie d’Europe contre magie noire océanienne… Là aussi, l’Occident conserve le dessus.
IX. Intérêt de l’œuvre
Aimé Césaire évoquait souvent le devoir de mémoire ; on peut aussi parler de droit à l’histoire. Cet ouvrage me paraît être un essai réussi de recréation de l’émotion, une incursion dans le courage et dans l’épopée, mêlant autochtones et migrants dans un même univers hostile, en totale construction-déconstruction, et donc, une sorte de saut volontaire et subit dans l’inconnu et le défi. Les personnages, quels qu’ils soient, relèvent tous une véritable gageure : le bouleversement des valeurs établies, la décomposition-recomposition avec l’autre, une tentative désespérée de vivre ensemble en (r)attrapant la marche du monde.
Heinrich fait figure de visionnaire : il a apporté l’école moderne, rivale de celles des missionnaires, une fondation sous-tendue par ses valeurs maçonnes. Fidély, c’est celui qui sait, qui passe d’une rive à l’autre, qui embrasse les cultures sans jamais se perdre. Gardien des valeurs anciennes, traducteur et messager, il s’agrège langues et non-dits.
Maria est une belle figure d’abnégation. Elle transcende aisément préjugés et quant-à-soi, dispensant soins et remèdes aux aborigènes, aux kanak, aux colons. Ses prénom et nom coutumier la positionnent comme la personne idéale pour lier les peuples, tout en échappant elle-même à l’Abîme. Elle est bénie entre toutes les femmes.
Le positionnement non-dualiste de l’auteur peut faire grincer des dents. Il a le mérite de casser les préjugés et, partant de sa tradition familiale, de bâtir une histoire citoyenne. Plus qu’un bref hommage à ses ancêtres, dont il ne nie pas les limites, il évoque une Calédonie complexe, riche d’humanité, où les combats et les victoires pour la dignité ont forgé une identité locale. Le vivre ensemble, leitmotiv d’aujourd’hui, avait donc commencé bien avant que le terme n’existe.
Frédéric Ohlen semble être conscient d’une lacune : nous n’avons plus la notion de la distance, du temps, de la proximité avec l’histoire. À l’ère de la communication immédiate, via les nouvelles technologies, nous oublions tout l’intérêt d’hier pour comprendre notre époque, comme si le passé allait de soi, ou pire, comme s’il n’avait jamais existé. Cet ouvrage nous incite à en savoir plus, avec une documentation solide et un ressenti de natif.
Certes, la subjectivité de Frédéric Ohlen transparaît, notamment dans la dénonciation du bagne à venir, dans la charge constante contre les White Men, qui « déplaçaient les tribus, modifiaient sans vergogne des équilibres précaires » (p. 187), dans le parti-pris de Maria, pro-kanak, et surtout pro-humaine, dans les positionnements de Fidély et de Naïtani contre la cruauté des blackbirders (p. 148-166). Les personnages Frédéric Ohlen deviennent tour à tour ses avatars et ses porte-parole, nous montrant clairement qu’il ne s’agit pas là d’une histoire de vainqueurs ni de vaincus : chacun y laisse des plumes, chaque clan fait des erreurs, et des efforts aussi. C’est plutôt une histoire de gens embarqués sur un même navire avant que d’être enfermés dans une identité étriquée d’Allemand, de Kanak, de Métropolitain, de Néo-Hébridais ou de Belge.
Sources et bibliographie
– www. axl.cefan.ulaval.ca/pacifique/ncal3.hist.htm et www.kronobase.org
pour l’histoire de la Nouvelle-Calédonie
– www.latlon-europe.com/hambourg/histoire-T06.ht
sur la ville de Hambourg
– Association Témoignage d’un Passé : atupnc.blogspot.com
sur le gouverneur Charles Guillain
– conversations avec Frédéric Ohlen
– Dauphiné (Joël) : Scolarisation des Canaques sous le Second Empire : échec d’un gouverneur saint-simonien, 1990, Journal de la Société des Océanistes, vol. 91, p.183-187.
– Traductions des passages en allemand et culture de l’Allemagne par Augustin Isch
– fr.wikipedia.org/wiki/Franc-maçonnerie pour un bref éclairage sur les francs-maçons
— N O T E —
La franc-maçonnerie, principes et valeurs
Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l’art de bâtir.
Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l’aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l’Humanité, tout en laissant à chacun le soin de préciser à sa convenance le sens de ces mots. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes d’organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques.
Elle s’est structurée au fil des siècles autour d’un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d’une multitude d’obédiences, qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l’objet de nombreuses critiques et oppositions, aux motifs très variables.
Source : Wikipedia