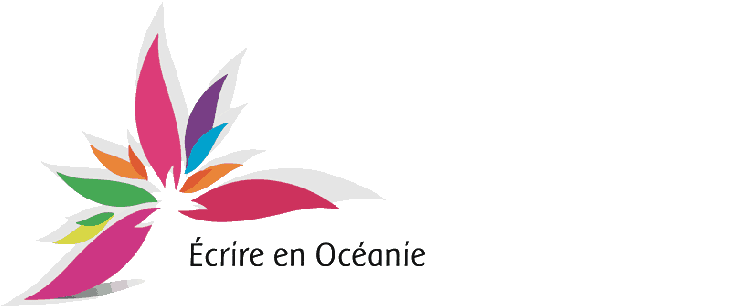Les promesses du Niaouli de Nicole Chardon-Isch
Les promesses du niaouli (Nouvelle) PaÏta 2014
I
Sur le chemin du retour Paulo traîne les pieds et racle la route ; il revient de l’école, fatigué. Peu lui importe de se faire astiquer, voilà déjà trois paires de chaussures trop tôt usées par sa mauvaise habitude ; c’est comme s’il portait le poids du monde, après une chaude et dure journée. La maîtresse, mademoiselle Tafili, avait donné plus de travail à cause de la fin du trimestre, et parce qu’elle voulait rattraper le retard dû à ses absences récentes ; elle avait été malade, puis des décès dans la lointaine Wallis l’avaient obligée à voyager vers Alofi où un vieil oncle s’entêtait à vivre seul parmi les cultures de taros et d’ignames. Elle n’était plus toute jeune, et les enfants, débordant d’énergie, la fatiguaient davantage ; c’est qu’ils avaient changé, pensait-elle. Les enfants d’aujourd’hui lui paraissaient plus vifs, plus insoumis et sans pitié pour ses pauvres nerfs.
Paulo, quant à lui, songeait avec excitation à l’année prochaine ; il irait au collège. Pourtant, ce désir était mêlé à de l’appréhension ; il était attiré par l’inconnu mais inquiet tout de même ; il fallait attendre encore quelques semaines, après les vacances d’été, quand les flamboyants éclateraient de toutes leurs pétales et donneraient d’immenses gousses sonores ; alors, à la mi-février, il rejoindrait le collège Baudoux et de nouveaux camarades ; peut-être se sentirait-il mieux alors ? Qui sait, il pourrait se faire un, ou deux ou même toute une bande d’amis, qui l’accepteraient tel qu’il était ; impatient et malheureux, Paulo ne supportait plus ses camarades qui se moquaient de lui et le raillaient ; ni blanc, ni noir, mi-kanak, mi-wallisien, il se sentait la risée de tous. Il avait beau se regarder dans le miroir, il ne se voyait pas si différent des autres. La Nouvelle Calédonie était une terre de passage, de pionniers et de colons, de métissage et d’échange, une terre riche de promesses humaines. Et puis, que signifiait tout cela, n’avait-il pas le droit de vivre, de s’épanouir ? Peut-être était-il trop sensible, voire susceptible ? Il songeait à la différence et se comparait à ses camarades : avaient-ils les m^mes problèmes d’identité que lui ? Un élève de son école, un jeune wallisien, avait le teint cuivré, allait aux cérémonies coutumières au Fale Fono de Païta et rendait un culte à Saint Pierre Chanel. Il semblait épanoui dans une classe interculturelle. Une jeune fille kanak, à la peau foncée et aux longs cheveux luisants, sa voisine à Nouville, rentrait à chaque vacance à Lifou, dans la tribu de ses parents ; elle revenait avec des trésors à raconter, la chasse au notou, le tonton qui a capturé tant de roussettes, les coquillages récoltés sur les patates. Equilibré et toujours joyeux, hacun semblait avoir une apparence et un espace culturel coordonnés.
Paulo le déraciné rêvait d’un monde où les variétés humaines seraient si mélangées qu’on ne les distinguerait plus ; âgé de onze ans il était solidement bâti, un peu inquiet, la tête pleine d’étoiles et d’espoirs. Intelligent, sensible et rêveur, il se posait des questions sur son statut, entre deux chaises. Ses yeux couleur noisette, rieurs et profonds, laissaient deviner un cœur pur.
Il n’était pas un enfant compliqué ; devenu vite indépendant, il faisait la fierté de ses parents qui, accaparés tous deux par leur travail, se reposaient sur lui pour la gestion des tâches ordinaires à la maison et à l’école ; ils contrôlaient peu, en toute confiance. Son frère, âgé de dix-neuf ans, était parti pour ses études à Paris, dans la lointaine métropole. Accueilli à la maison de Nouvelle Calédonie, il voulait devenir ingénieur pour travailler dans la nouvelle usine du nord. Paulo l’imaginait seul, perdu dans l’immensité de la ville tentaculaire, privé d’air pur et de verdure, transi de froid. Cette lointaine contrée recelait maint mystère ; grande dévoreuse d’argent, elle exigeait des envois réguliers de mandats à l’OPT pour le logement, la nourriture et les livres de son frère ; il savait combien ses parents, qui travaillaient tous deux, faisaient de sacrifices à cet effet. Aussi était-il un des meilleurs élèves de sa classe, il avait à cœur de ne pas peiner ses parents déjà très sollicités.
Et puis sa vie était pleine du bonheur d’avoir Papinet, son grand-père kanak ; il vivait à Nouville non loin de chez lui, dans une petite case à laquelle il tenait beaucoup ; deux chambranles représentant les ancêtres enveloppés dans leur natte ornaient la case de part et d’autre ; l’un tirait une langue épanouie, l’autre arborait un oiseau et des hibiscus ; c’était la plus belle case de l’endroit. L’enfance de Paulo était pleine de cette case, qui entendait fuser les contes, les généalogies, les conseils des anciens ; il se souvenait des soirées de danse où le kava se partageait dans l’amitié. Blotti contre Papinet, il n’aurait échangé sa place pour rien au monde. Il le comprenait et était le compagnon muet de ses douleurs et de sa solitude.
Il savait rester discret, comme perdu dans la contemplation du paysage et savait attendre les confidences ; Paulo aimait son odeur ; il se dégageait du Vieux un persistant parfum d’essence de niaouli, malgré les ablutions à grand renfort d’eau de la source de Plum, conservée dans d’immenses réservoirs derrière la case, ou les multiples bains de mer face à la baie proche. Papinet travaillait la semaine à la distillerie de Boulouparis dont il était le plus ancien employé et il ramenait avec lui, le week-end, des fragrances épicées et entêtantes qui se mêlaient à ses cheveux, à sa peau et qui l’auréolaient de mystère.
– Tu as bien travaillé à l’école ?
Leur rencontre du samedi commençait rituellement par cette question du grand-père.
– Assez bien, répondit l’enfant.
– Parle-moi plus, c’était comment ?
– Comme ci, comme ça. C’est comme tous les jours.
– Bizarre ; en fait tu n’as pas très envie de me raconter tes journées ; tu t’es fait des amis ?
– Non, pas vraiment, dit brièvement Paulo.
Papinet avait soixante- cinq ans et malgré son âge, l’épuisement des coupes de branchages et de bois, l’âcreté des fumées des fours à distiller, il se maintenait au travail, vigoureux et opiniâtre ; son savoir-faire acquis au cours des décennies et son sérieux lui valaient l’estime de son patron, qui tenait à le garder. Il était inquiet pour son petit-fils, qu’il trouvait original mais trop solitaire ; il en était fier en même temps : l’enfant possédait une intelligence et une maturité rares, et il lui rappelait, tant physiquement que par le caractère, son fils Kiki.
– Assieds-toi là, que je te raconte l’histoire de la vieille Madeleine.
– Raconte, dit Paulo avec empressement.
La vieille Madeleine avait un chien qu’elle aimait beaucoup ; elle était veuve sans enfants, sa famille de Tiga ne venait pas la voir, et l’isolement lui pesait. En revenant un jour du marché elle a trouvé au bord du chemin un chiot apeuré, qui l’a suivie ; elle l’a nourrie et aimé, trouvant en lui de quoi satisfaire son besoin d’affection ; elle lui prodiguait beaucoup d’amour, le nourrissait de lait, lui inventait des recettes culinaires à base de viande et de légumes ; elle l’appela Wao.
Or un jour Wao disparut, il avait déserté la case, et son bol à croquettes resta désespérément plein. Elle ameuta les voisins, on fit une battue, on appela : Wao ! Wao ! Rien. Elle essaya les aboiements, fit claquer sa langue et courut en tous sens : Wao ne revenait pas. La brave dame erra par le village, scrutant chaque trottoir, chaque jardin. Un jour elle crut reconnaître son Wamo auprès d’une haiede cordylines, dans le jardin d’une maison ; elle lui tendit des croquettes, l’appela ; il l’ignora et dressant la queue, s’éloignait déjà ; alors, écartant le grillage mal fixé, elle se glissa dans le jardin et bondit sur le chien qui la mordit. Le maintenant de toutes ses forces, elle le fourra dans un sac et se rendit tout droit chez le vétérinaire : il fallait castrer la bête pour qu’elle ne s’enfuie plus vers des aventures dangereuses ; il fallait éviter d’être de nouveau abandonnée. Plus d’amours vagabondes !
La pauvre bête, opérée, regardait tristement et sans comprendre sa nouvelle maîtresse, son nouveau logis. Car la vieille Madeleine s’était trompée ! Elle le comprit quand le véritable Wao réapparut, amaigri et boitillant ; il ressemblait en tous points au chien opéré. La vieille voulait rendre le chien à son propriétaire, qui n’en voulut plus ; alors elle le garda, ils s’entendirent à merveille et la vieille dame, éperdue d’émotion, eut désormais une famille élargie.
Cette histoire fit beaucoup rire Paulo, qui la trouvait émouvante et comique ; son désir d’avoir un animal de compagnie s’éveilla. A défaut d’un copain humain, il lui plairait bien d’avoir une bête. Un chien ? Un cochon sauvage ? Un canard ? L’idée lui plaisant fort, il s’endormit la tête pleine d’espoirs.
II
Cette nuit-là cependant Paulo dormit mal.
– Sais-tu à quoi je pense, Papinet ?
– Dis-moi.
– Je voudrais un chien ; peut-être un chien bleu. Un animal bien à moi qui serait mon ami.
– C’est bien, tu te sentiras moins seul ; mais tu devras demander la permission à tes parents.
– Tu vas m’aider, Papinet, à les convaincre ?
– Ce sera facile avec Kiki, ton père ; mais je doute que ta mère accepte un chien dans sa case ; ce n’est pas qu’elle déteste les animaux, mais elle est très attachée à la propreté et puis qui s’en occupera quand ils seront au travail et toi à l’école ? Tu ne peux pas le laisser attaché, pauvre bête !
– Je vais le dresser pour qu’il reste près de la maison.
– Il y a des inconvénients, les voisins…
– Quels inconvénients ? Paulo trépignait d’impatience.
– J’ai bien l’impression que tu n’as pas écouté ! Hé bien, je vais te l’avouer : Riki, la chienne du patron est enceinte, elle va bientôt avoir ses petits ; le problème c’est que cette chienne est devenue sauvage depuis qu’elle sent son corps se transformer ; je n’arrive plus à l’approcher, elle gronde et elle mord ; j’espère au moins qu’on pourra la séparer de ses petits dès qu’ils seront sevrés. Je lui donne son repas vers six heures : elle avance en rampant jusqu’à son bol, elle dévore le repas et disparaît dans les bois ; je ne la revois qu’au repas du matin, je ne sais pas où elle va se cacher. Sois patient, dans quelques semaines Riki va mettre bas et tu pourras choisir ton ami à quatre pattes.
Paulo se sentait déçu ; attendre… Encore attendre ! Pour tromper son ennui il prit congé de son grand-père et reprit le sentier qui séparait leurs logis ; il eut envie de marcher encore, ses parents n’étaient pas rentrés, il aurait le temps d’explorer la colline de Nouville qui surplombait la mer ; il gravit le chemin bordé de faux mimosas et entra dans un taillis épais de faux-poivriers et de jeunes bouraos, se frayant un passage avec ses bras écartés ; il entra dans un bois de niaouli dense et serré ; la récolte de ces feuilles pour la précieuse essence aurait bientôt lieu, elle serait précédée d’un brûlis pour éclaircir le feuillage, chasser les insectes piqueurs et les scolopendres dorés. Le vent de la mer s’engouffrait sous la frondaison et faisait murmurer les feuilles ; brusquement il s’intensifia, des vagues et des ondulations à perte de vue secouèrent la forêt ; on dirait un océan vert, pensa Paulo. La forêt sèche étendait son autorité sur le versant et se déployait en une splendeur crépusculaire orangée.
A ce moment il eut la curieuse sensation d’être épié : on le suivait ; se retournant, il crut apercevoir une ombre mouvante qui s’enfuyait entre les troncs serrés. Les basses branches vibraient à son passage et l’enfant entendit distinctement le crépitement des feuilles sèches en aval. Paulo reprit sa route vers le sommet, mi-rassuré ; il voulait contempler la mer. Déjà, en août dernier, du haut du promontoire il avait contemplé ravi les voltiges de deux baleines, qui semblaient ne penser qu’à lui dans leurs prouesses aquatiques. Il s’était senti le roi du monde.
L’ascension fut difficile par endroits : rochers et crevasses le freinaient, quand ce n’était pas la densité de la végétation. Quand il arriva, au terme d’une trentaine de minutes, le soleil déclinait doucement. La vue, semi-circulaire, était masquée par endroits par des arbres épais mais il pouvait apercevoir les contreforts du fort Tereka, les nouveaux bâtiments de l’Université, les vestiges du bagne et, au-delà, les contours de Dumbéa ; il devinait les baies et les plages fréquentées par les riverains. Depuis qu’elle avait été reliée par un pont à la ville de Nouméa, la presqu’île de Nouville abritait un squat joliment aménagé. Pour rien au monde les habitants ne quitteraient cet espace mi-rural, mi-citadin qu’ils avaient pacifié et patiemment aménagé. De nombreux déracinés y avaient trouvé un ancrage, des broussards descendus du nord, des gens des îles venus travailler à Nouméa ; tous formaient de nouveau, à défaut d’une tribu, une communauté interethnique qui vivait en paix .La plage, pas moins de deux nakamal, des chèvres et des cochons dans des parcs bien entretenus scellaient la cohésion de ce quartier auto-construit aux portes de la ville.
Tout en méditant sur cette douceur de vivre, Paulo s’apprêtait à redescendre, une nuit claire commençant à s’installer. Soudain un craquement proche le fit sursauter.
– Qui est là ? cria-t-il.
Point de réponse. Pris de peur il se mit à dévaler tant bien que mal la pente abrupte. Hors d’haleine, il courait, se griffant, s’écorchant au passage, toute précaution devenant inutile. Quand sa maison fut en vue, il s’affola dans les derniers cent mètres. Vais-je avoir le temps ? La chose est-elle derrière moi, va-t-elle m’attaquer ? En une fraction de seconde il franchit le seuil et se calfeutra dans la maison ; il écouta : il était seul, « on » ne l’avait pas suivi. Tout était calme mais une nouvelle crainte s’empara de lui : la solitude ; et si « on » s’approchait en se glissant derrière la maison ? Il vérifia par la fente d’une persienne, fit le tour, scruta les interstices de la tôle ondulée qui fermait l’arrière ; personne. Les cordylines balançaient doucement leurs panaches rassurants. Les ancêtres étaient ses meilleurs alliés, foi de Papinet, ils le protègeraient. Il s’enhardit peu à peu, alluma les lumières et tourna le bouton de la radio, tentant de calmer ses émotions jusqu’au retour de ses parents.
Il s’interrogea. Devait-il leur raconter ? Peut-être se moqueraient-ils de lui, le traitant de froussard ; alors il décida de garder le silence. Il lui faudrait vérifier, en plein jour, et s’en ouvrir à son grand-père ; lui au moins le comprendrait. Il se montrait toujours disponible et disait souvent :
– Mon Paulo, tu es la lumière de ma vieillesse.
III
Les semaines passèrent, monotones ; la chienne n’avait pas encore eu ses petits. Paulo n’avait pas osé remonter sur la colline, faute de temps, ou de courage, escomptant les vacances de décembre pour reprendre son enquête. Un jour en passant devant le nakamal, face à la plage de Nouville, Paulo entendit parler d’une histoire qui l’intéressa beaucoup ; prêtant l’oreille, il entendit raconter qu’une association chargée d’accueillir des jeunes du nord et des îles, descendus à Nouméa, s’était établie dans le squat ; il le savait déjà, passant quotidiennement près du restaurant kanak qu’ils avaient installé à l’entrée du village ; le drapeau kanak flottait fièrement au-dessus du bâtiment qui ne désemplissait pas le midi ; le bougna et les boulettes de taro à la viande étaient les spécialités fort apprécies. Mais le plus intéressant et le plus incroyable, c’est que les membres de l’association avaient amené pour égayer la fête du quartier, une famille de cerfs : un grand-mâle, deux faons et une biche. Le troupeau, par un hasard curieux, s’était échappé : la biche et le grand cerf ont été rattrapés le soir-même Place des cocotiers, près de la fontaine Céleste, l’un des faons, désorienté, est entré dans une case d’où on l’a aussitôt délogé avec un filet. Manquait à l’appel le deuxième faon.
Cela mit Paulo en émoi. Pauvre bête ! Elle était traquée et pour sûr, sa tête finirait accrochée au mur d’une riche demeure, ou bien sa mâchoire pourrirait au milieu d’un sentier, triste trophée. Cette chasse au cerf indonésien, venu malgré lui de contrées lointaines pour le plaisir d’une riche bourgeoise, était encouragée par le gouvernement. Outre la nécessité d’équilibrer une population devenue dangereuse pour l’écosystème, elle était aussi pourvoyeuse de ressources pour nombre de gens du nord et du sud ; les mâchoires de cervidés étaient rémunérées en espèces sonnantes et trébuchantes. Le sort du faon était scellé. A moins que … ?
Sa nuit fut hantée de cauchemars. A son désir de sauver le faon se mêlaient des scènes affreuses où il était poursuivi par un monstre emboucané sorti du bois. Il eut du mal à se lever et appréhendait d’affronter ses camarades à l’école ; il avait plus que jamais besoin de paix et d’équilibre, il fallait réfléchir au calme.
Le jour pointait ; il entendit son père se lever et avancer vers sa chambre. Il avait l’air gai.
– Déjà debout ? Comment vas-tu, mon fils C’est la dernière semaine de classe ?
– Ecoute, Papa, je vais bien. Je voulais te dire…
– Ecoute, va, je n’ai pas le temps ; parle à ta mère.
Kiki tapota l’épaule de son fils et fila se préparer ; il travaillait à la chambre d’agriculture, à l’entrée de la ville et faisait le chemin à pied. Il partit pressé, le téléphone à l’oreille. Il n’était pas disponible.
– As-tu bien dormi, Paulo ? s’enquit sa mère ;
Elle était en train de se brosser les cheveux afin qu’ils soient le plus lisse possible ; mais Paulo la trouvait belle et aimait les frisottis de ses cheveux. Elle semblait pressée, le thé à peine avalé elle
– A plus tard, mon chéri, j’ai une réunion importante ce matin ; allez, à ce soir ! N’oublie pas de te brosser les dents après manger !
Malia déposa un baiser sur la joue de son fils et partit en toute hâte ; Paulo, resté seul, huma un instant le parfum laissé dans son sillage et songea à l’école ; c’étaient les derniers cours, rien ne l’obligeait à s’y rendre, d’ailleurs les parents n’en sauraient rien. Il se décida vite. Au besoin il inventerait un prétexte, comme une rage de dents. Il voulait en avoir le cœur net ; qui se cachait dans la colline, un faon devenu un jeune cerf, ou bien un monstre ?
Puis il fut pris de scrupules. C’est trop facile, pensa-t-il, de mentir ; j’irai après l’école. Il n’aimait pas avoir la conscience inquiète ; Papinet lui avait enseigné des valeurs importantes, comme agir selon sa conscience et ne pas avoir peur. La peur, mauvaise conseillère, est un fruit qui pourrit l’esprit et empoisonne celui qui la porte. Le vieux avait une immense sagesse en lui et le garçon essayait de toujours suivre ses conseils. Bien lui en prenait car chaque fois qu’il en tenait compte, les choses se passaient bien. Paulo se demandait avec admiration comment le vieux savait tant de choses. Et Papinet lui avait répondu :
– Mon fils, ce sont les coups de la vie, les expériences pénibles et un peu de bon sens qui m’ont appris tout cela.
Paulo n’avait compris qu’à moitié, c’était à l’époque des paroles complexes, mais aujourd’hui il comprenait mieux. Il se prépara pour l’école. En vélo ce serait mieux, mais le flot de voitures l’effrayait un peu et Malia préférait qu’il attende un ou deux ans de plus. Soyons prudents, disait-elle.
Avant de partir pour l’école il ferma avec soin la maison et prit la route ; son regard était irrésistiblement attiré vers la colline où rien ne bougeait. Il devait y remonter ! La tâche s’avérait rude et longue : pas moins de soixante-quinze hectares à explorer, car la bête-ou le monstre- se déplaçait à coup sûr ! Il passa devant la case de Papinet et s’engagea sur la route. Guilleret il cheminait en pensant à son expédition du soir quand il aperçut Marion ; c’était une camarade de classe, qui marchait fièrement avec une longue natte se balançant dans son dos. D’origine caldoche elle avait les traits fins, les yeux clairs tirant sur le vert et s’était toujours tenue à l’écart des détracteurs qui se moquaient de lui. Il l’appréciait beaucoup, peut-être accepterait-elle de faire le chemin avec lui ?
Il courut pour la rattraper.
– Ça va, Marion ? fit-il essoufflé.
– Ça va bien, et toi, dit-elle en se retournant.
– Oui, très bien. Tu sais que je vais avoir un chien, un chiot qui va naître bientôt ?
– Il va dormir dans ta chambre ?
– Non. Mon grand-père doit me le ramener de Boulouparis et il va lui fabriquer une caisse ; je le laisserai sur la terrasse.
– J’ai peur des chiens, mais je crois que c’est parce que je ne les connais pas assez ; s’il est petit, je veux bien le caresser. Tu as déjà un nom ?
– Non, je n’y ai pas réfléchi ; comment l’appellerais-tu ?
– Mon oncle a un chien qui s’appelle Husky. C’est un bon gardien. Mon oncle a une station à Bourail, les stockmen ont toujours un chien.
– Husky, c’est fin joli, ce nom me rappelle les chiens de traîneau au pôle nord. On va voir quand il sera né s’il accepte ce nom.
Marion souriait, heureuse de cette perspective ; c’est choc, se dit Paulo le cœur gonflé de joie. J’ai une amie.
Il l’observait sur le chemin. Elle portait un collier de coquillages de sa fabrication, des coquillages roses arrondis et nacrés intercalés avec d’autres, coniques et bruns.
– Il te plaît, demanda-t-elle. Si tu veux je peux t’en faire un.
– Avec plaisir ! Je le garderai toute ma vie.
En classe ils n’étaient pas à la même table et Paulo attendit la cantine avec impatience. Mais à l’heure du repas, il ne s’installa pas à la table de Marion ; par timidité et par prudence à la fois, il préféra la discrétion et se délecta du plaisir de la voir de loin. Il ne voulait pas attirer l’attention et supporter les sarcasmes devant elle. Il voulait lui épargner l’embarras d’avoir publiquement un ami empoté et différent, même s’il savait qu’elle pouvait se défendre.
IV
C’est en rentrant de l’école le lendemain que Paulo entendit un bruit épouvantable. L’air vibra et un bruissement de feuilles se fit entendre, comme si un monstre préhistorique s’avançait dans la forêt. Il pensa avec force à ses parents, à son grand-père et à Marion. En longeant l’allée de cordylines et de frangipaniers devant chez elle peu avant, il l’avait saluée et elle lui avait fait un grand signe de la main ; il espérait qu’elle entendait comme lui le fracas et qu’elle viendrait au besoin à son secours. Devait-il rebrousser chemin, continuer et prendre ses jambes à son cou ? Waouh ! Pris de panique, il resta pétrifié quelques secondes puis l’instinct de survie l’emporta ; il reprit courage et se mit à courir à perdre haleine. Quand il estima être assez loin, il se retourna et se jeta dans l’herbe à la lisière du bois ; c’est alors qu’il le vit.
Un faon, tout tremblant, gisait sur le bas-côté. Ses yeux implorants et terrifiés fixaient Paulo ; il tenta de se relever mais retomba ; l’enfant vit alors du sang sur sa patte ; peut-être était-elle brisée ? Elle faisait en effet un coude bizarre. Paulo s’approcha et caressa le museau et le flanc de la bête, puis il palpa la patte ; il sentit son cœur battre à grands coups et n’hésita pas : il fallait la sauver ! Il respira profondément et chercha des yeux un morceau de bois. Au cours de sciences naturelles et de secourisme Mademoiselle Tafili lui avait appris à faire une attelle, c’était le moment de pratiquer. De sa poche il sortit une friandise et un bout de ficelle trop courte. La bête apeurée tremblait, mais elle ne cherchait plus à s’enfuir ; il approcha doucement la main ouverte et la bête huma la douceur du sucre au creux de la paume ; le faon détourna la tête ; tétanisé, il restait coi et, manifestement, il souffrait.
Paulo s’affaira. A l’aide d’un bout de planche, de la ficelle et de quelques herbes, il maintint la patte du faon dans une position qui lui parut adéquate ; il le caressa un instant et le recouvrit de branchages. Le temps de prévenir Marion, il ne s’enfuirait pas. Paulo, pressé mais soulagé, se hâtait vers la maison de son amie. Soudain il se mit à rire, jovial ; il venait de se rappeler une fable de La Fontaine apprise en classe. Il était comme ce Lièvre peureux qui tremblait au moindre souffle, qui craignait même le floc des grenouilles dans une mare.
– Alors, c’est un faon qui me terrorise depuis des semaines ? Mon devoir est de le sauver, il deviendra mon ami.
Il se rappela aussi son grand-père, qui lui enseignait comment surmonter ses peurs. Il arriva chez Marion, ragaillardi.
Il raconta sa trouvaille à son amie ; cela l’amusa et comme il s’y attendait, elle le suivit immédiatement ;
– Il faudrait que tu m’aides, Marion.
– Attends, je prends quelque chose.
Elle revint avec du coton et de l’alcool.
– On ne peut pas le laisser là, les chiens, les chasseurs…
– Tu as raison, il faudrait une couverture, pour le transporter.
– Oui. Mais j’ai une idée. La brouette de Papinet, elle est derrière la case !
– On va le soigner et puis le cacher. Il ne faudrait pas qu’on le trouve.
– Vite, allons-y !
Ils se dépêchaient, faisant profil bas quand ils croisaient un passant ; ils bifurquèrent par un petit sentier, discrètement. Le fracas avait repris, plus lointain, on aurait dit un vrombissement.
– C’est à cet endroit que je l’ai trouvé.
– Tu ferais un bon vétérinaire, tu sais.
Le faon était toujours là, camouflé sous des branchages ; ils le hissèrent tant bien que mal dans la brouette et le réchauffèrent avec une couverture. Sa tête fatiguée émergeait seule et il avait les yeux mi-clos, les narines frémissantes. Blessé, il se savait en sécurité et toutes ces courses vagabondes l’avaient épuisé. Il s’en remettait désormais aux soins des deux amis.
L’animal fut installé dans un vieil enclos qui servait de porcherie, non loin de la case du grand-père ; chaque jour, ensemble ou à tour de rôle, Marion et Paulo venaient le nourrir et soigner sa plaie ; il se remettait vite et dans les trois jours il se redressa, boitillant dans son enclos ; il se régalait d’herbe fraîche soigneusement cueillie et d’eau changée quotidiennement. Il avait le poil doux et fauve ; une tache circulaire blanche ornait son front ; c’était une jeune femelle, et l’adulte se devinait sous sa toison. Elle deviendrait grande et forte. Malgré leur appréhension sur son avenir, ils étaient en extase. C’était leur secret, il avait été décidé qu’ils attendraient le retour de Papinet le week-end suivant pour annoncer leur trouvaille. Qui sait ? Les adultes trouveraient bien une solution permettant de le garder.
V
Ce matin, dans la salle de classe, mademoiselle Tafili a mis l’école en émoi : elle s’est coupé les cheveux, très courts, et les a plaqués autour des oreilles et derrière avec du gel ; quelques- uns ont ricané, mais Paulo a trouvé cette coiffure très classe, d’autant que l’encolure de la maîtresse, agréablement dégagée, s’ornait d’un gros collier de graines ramassées sur la plage et plies par la mer.. Ses collègues lui firent compliment et elle rougit de plaisir ; aussi fut-elle agréable toute la journée, sauf en fin d’après-midi où Aléus dut ramasser les boulettes de papier qu’il avait lancées sur ses camarades. Ce fut l’événement de la journée. A Ikenasio, qui lui demandait : Maîtresse, pourquoi t’as coupé tes cheveux ? » elle répondit : « C’est pour faire parler les gens ! » Cette réponse plut à Paulo qui trouvait que décidément, on devrait imposer ses choix et ne pas faire comme tout le monde.
De retour, Paulo songea à la biche ; un coup de chasse se préparait dans la famille, l’oncle Petelo en tête. C’était une menace de plus, on ne pouvait relâcher de sitôt Laka, la petite biche.
Son oncle Petelo avait été chassé de Saint Louis lors d’événements particulièrement agités et avait réussi, grâce à un prêt de la province Sud, à acheter une terre pour sa famille au lotissement Beauvallon à Païta ; désormais il défendrait son bien à la force du fusil, disait-il avec détermination. Grand amateur de coups de chasse, il régalait régulièrement la famille de viande de cerf ou de cochon sauvage, chassés à la course ou à l’affût dans les coins reculés de la Chaîne ; il ne dédaignait pas non plus un butin plus délicat et raffiné, et un notou savoureux ou un plat de roussettes au goût de poulet garnissait parfois la table. Tous étaient invités et la bière coulait à flots ; l’oncle Petelo, grisé, entonnait alors les chansons de son enfance à grand renfort de cris exubérants et de gestes guerriers.
La nuit tomba d’un coup sur la chaîne tel un rideau opaque et le ballet sonore des margouillats commença ; Laka était assoupie, sa patte guérissait.
Dans sa chambre Paulo fit des recherches sur le régime alimentaire des cerfs : il faudrait varier l’apport d’herbes et donner des vitamines. Papinet, mis dans la confidence, promit détourner l’attention de l’oncle Petelo car dans le squat on n’avait pas oublié l’affaire du faon échappé.
Au petit matin le réveil fut difficile. De la maison déserte émanait une sensation étrange ; ses parents étaient partis travailler mais la cuisine embaumait encore le café et le pain grillé ; il lava les bols restés dans l’évier et rangea dans son cartable un nem et l’eau de coco préparés par sa mère ; des gestes mécaniques et quotidiens.
Cela aurait été comique si l’amitié avec Laka n’en dépendait pas. Il était perdu dans ses pensées quand une mouche affolée échoua sur sa joue et le rappela à la réalité ; il se rendit compte que quelque chose dans l’air avait changé. Il ne savait encore quoi. C’est alors que des cigales, des mouches, des insectes inconnus affluèrent vers lui, certains le percutant avec un bruissement paniqué. Une odeur d’essence de niaouli lui parvint aux narines et le crépitement de bois brûlé devint distinct ; la forêt brûlait ! Les bois noirs et les niaoulis étaient en feu. »Laka ! laka ! » cria-t-il, épouvanté. Une fumée âcre et dense flottait lourdement dans l’air.
Instinctivement, Paulo se précipita dans le bois, plongeant dans les taillis de faux-poivrier, au risque de se blesser ; la récolte de feuilles et brindilles niaouli allait débuter et les ouvriers agricoles avaient mis en place des brûlis pour dégager le pied des arbres, ménager des éclaircies pour faciliter leur travail de coupe, éloigner les insectes. Comment avait-il pu oublier cette technique qui se répétait chaque année à la même période ? Il aimait pourtant voir la peau du niaouli s’embraser les soirs d’été et chasser les moustiques affolés ; l’odeur âcre et parfumée des feuilles craquant sous la flamme lui procurait d’habitude un bien-être infini. Mais là, pour l’heure, sa biche était en grand danger ; il courut et l’appela à pleins poumon, errant de ci, de là sans repères et plein d’espoir. Où pouvait-elle être ? Derrière ce taillis de faux-mimosas ? Non. Il s’imaginait la jolie bête au fond d’une tanière, tremblant de frayeur. Peut-être se sentait-elle un peu à l’abri, espérant la venue de son ami ?
Paulo s’était perdu, escaladant au hasard les racines traçantes, les contreforts d’arbres vénérables, les rochers épars ; la nuit tombait, l’enveloppant insidieusement. La fumée rampait, insidieuse et âcre, précédant les flammes dévoreuses. Insensiblement, elles encerclaient l’enfant ; la chaleur se faisait suffocante ; quand il s’aperçut du danger, il essaya de revenir sur ses pas, la gorge et les yeux en feu ; la fumée dense empêchait toute orientation, désormais. Dans un effort désespéré il fonça à travers les escarbilles et les volutes sombres et menaçantes, forçant le passage du fond, dans une course de survie. Il atterrit sur un brûlis, une couche de terre encore fumante, visitée par le feu.
A bout de force il s’effondra sur le sol chaud, protégeant tant bien que mal ses jambes des braises ; il se sentait étourdi, désorienté ; de la cendre lui emplit la bouche ; la frondaison se mit à tournoyer, il serra ses genoux maculés de ses mains tremblantes et pria les ancêtres de préserver la vie de son amie Laka ; elle a dû s’enfuir, pensa-t-il encore avant de sombrer dans une torpeur comatique.
En amont de l’incendie un vrombissement se fit entendre. Un énorme tracteur approchait, sa herse élevée au niveau des arbres ; elle fauchait les branches de niaouli et s’approchait en vrombissant ; à la lisière du feu l’énorme machine s’arrêta, évitant de justesse le petit garçon inconscient qui gisait au sol.
La biche avait tout vu ; elle avait observé la machine agricole qui grimpait la colline, étêtant les arbres, ébranchant sans ménagement les niaoulis les plus touffus. L’engin gigantesque et effrayant grondait en soufflant et s’approchait dangereusement de l’enfant dont le corps inerte gisait en bordure du bois, caché par la broussaille et la fumée. Le conducteur, perché dans la cabine, avançait à l’instinct et ne pouvait le voir. La biche comprit et courageusement elle galopa follement devant l’engin, au risque de se faire broyer par les énormes chenilles ; elle lança des brames désespérés, tel un cerf en rut ; le conducteur, absorbé, ne la voyait pas ; elle se mit alors à courir autour de la machine, allant de Paulo aux chenilles. Il la vit enfin à travers un écran bleuté.
– Qu’est-ce que c’est ? Un cerf, attends que je t’attrape !
La biche continua à faires de grands cercles, sautant par-dessus les mottes de terre, flairant Paulo qui reprenait lentement conscience.
– Allez, laisse-moi faire mon travail ! hurla le bonhomme qui avait passé la tête par la portière.
Laka léchait le visage de Paulo quand le conducteur descendit de sa machine et vit la scène.
– Mon Dieu, mais c’est un enfant ! Qu’est-ce que tu fais là ? J’aurais pu te passer dessus avec ma machine !
Il s’approcha, se pencha et vérifia le pouls de Paulo qui s’agitait en gémissant ; la biche s’était éloignée.
– Tu es le fils de qui ? Quel est ton nom ? Tu te sens bien ? Mon Dieu !
Le conducteur n’en revenait pas ; il était passé si près d’une tragédie ! Reprenant ses sens, Paulo pensa à sa biche ;
– Laka, où est Laka ?
– C’est cet animal qui t’a sauvé, tu sais. Elle a attiré mon attention et t’a réveillé. C’est une brave bête. Tu la connaissais ?
– Oui, c’est mon amie, je l’ai adoptée quand elle était toute petite ; maintenant, elle s’est sauvée, et les chasseurs vont la tuer.
Il en avait les larmes aux yeux. Le chauffeur d’engins promit d’intervenir et reconduisit Paulo chez ses parents. De là-haut, dans la cabine, Paulo se trouvait à hauteur des frondaisons. Eclaircie par l’élagage avancé et les feux de broussailles, la visibilité était meilleure, mais quel spectacle ! La forêt était muette, mi-calcinée, les oiseaux envolés. Il comprit mieux le travail de son grand-père et des distillateurs, mais à quel prix ! Il scruta le sol mais ne vit pas Laka. Qu’importe, il savait où la rencontrer le lendemain.
L’histoire racontée par le conducteur d’engins au village fit sensation ; chacun voulut l’entendre maintes fois. Il ne fut personne qui ne songeât à protéger l’animal. Paulo et Marion permirent à qui voulait de caresser Laka. Elle s’intégra si bien au squat, allant et venant à sa guise, recevant qui du sucre, qui une friandise, qu’elle devint tout à fait apprivoisée, frayant avec les chiens, les chats, les cochons et les poules qui lui picoraient les pieds. On aimait se faire photographier avec elle ou prendre un bain de mer en sa compagnie; elle sautillait sur le bord et léchait ses pattes mouillées de sel. Ce fut un grand réconfort pour Paulo, qui grandissait, plus confiant, fort de l’amitié de Marion et de sa biche et de son joli chiot nouvellement rapporté de Boulouparis. Voici comment Laka devint la mascotte du squat ; si vous allez à Nouville, passez donc la voir sur la colline.
Glossaire
Astiquer : battre
Chambranle : pilier latéral de porte représentant un ancêtre dans sa natte ; a une vertu protectrice
Cordyline : plante souvent rouge violacée, utilisée pour la décoration, la protection des maisons et la magie
Emboucané : qui a subi un sort, un châtiment maléfique
Niaouli : arbre calédonien à essence médicinale
Notou : gros pigeon à bec rouge et à plumage noir
Roussette : chauve-souris frugivore
C’est choc : expression d’admiration et de satisfaction
C’est fin joli : C’est très beau
NICOLE CHARDON-ISCH est Professeure certifiée de Lettres
et Dr en lettres et en sciences du langage (FLE)