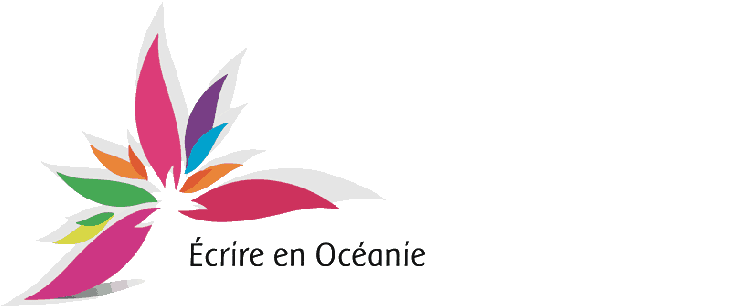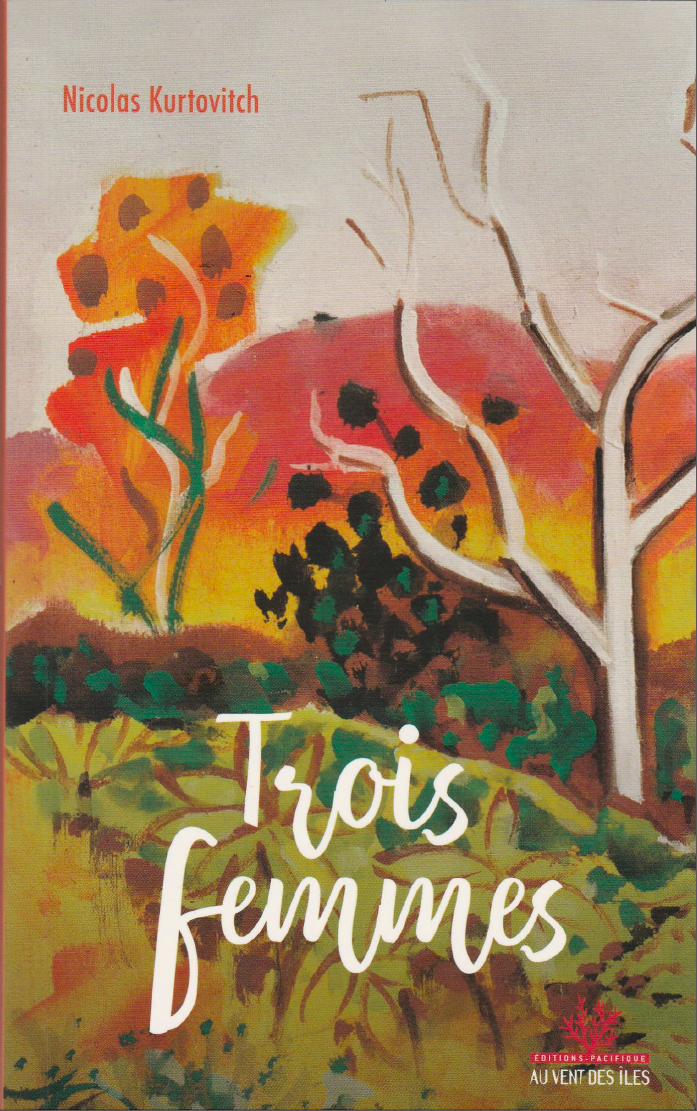TROIS FEMMES, Nicolas KURTOVITCH, étude de Nicole CHARDON-ISCH
TROIS FEMMES, Nicolas KURTOVITCH, étude de Nicole CHARDON-ISCH
Objectifs
Comprendre les ressorts de l’intrigue et la psychologie des personnages
Répondre aux besoins des lecteurs
Approfondir la lecture de l’œuvre
Cerner les rapports entre Moi et le monde
S’interroger sur l’exil et la notion d’identité
Aborder la résilience à travers des exemples de vies brisées et recomposées
Montrer le rôle fondateur de l’écriture
Comprendre la notion taoïste d’impermanence
Introduction
Hors du temps, délivré des contingences attachées au quotidien, un auteur en résidence, à l’étranger, absorbe de tout son être ce qui est donné à voir, à entendre. L’inspiration trouve là un espace où se déployer, un endroit de renouvellement de soi et de son écriture. Ce recueil en témoigne. Mais il comporte aussi des récits d’inspiration calédonienne ou des réflexions sur l’Histoire et les guerres universelles. Tableaux pris sur le vif, hypotyposes à Nouméa ou à Shangai, voici de quoi sustenter le lecteur avide.
Convoquer le passé et relier les chaînons du temps sont deux thématiques souvent abordées en littérature. La recherche d’un paradis perdu, le maintien du souvenir d’un âge d’or, en partie disparu permet de s’interroger sur la notion d’identité. Faire revivre le passé, donner à entendre les sans voix, fussent-elles des femmes, raviver l’importance fondatrice de figures féminines aimantes, tel est le propos de Nicolas Kurtovitch dans ce recueil polyphonique intitulé Trois femmes. Une importance primordiale est donnée à la généalogie et les rapports de filiation sont perçus comme essentiels. Comment les divers portraits tissés à travers le temps sont-ils montrés comme fondateurs et constructifs chez l’auteur ? Quel rapport au monde se dessine au fil des textes ? Comment assumer l’idée que tout est de passage ?
Nous allons analyser le texte éponyme « Trois femmes » sans exclure le reste du recueil ; ce choix se justifie par la longueur de cette nouvelle -elle est nettement plus longue et dense que les autres- et l’auteur y attache une importance fondamentale par les relations qu’il entretient avec ses personnages, si particuliers. Très fondateur et personnel, il reste en résonnance avec le reste du recueil, reflet des engagements et de la sensibilité de Nicolas Kurtovitch. Il fait le lien entre les terres ancestrales, parfumées au thym des garrigues et la terre d’accueil, la Nouvelle-Calédonie. Il englobe les scènes vues et vécues en Chine. Il n’exclut pas la réflexion illustrée sur l’Humanité.
Structure et genres : récits et intermèdes
Il y a une double cassure dans le récit principal et dans l’oeuvre ; l’une concerne la structure globale du recueil, fait de récits par divers narrateurs, à la première ou à la troisième personne et d’interruptions réflexives de l’auteur sur son époque. Ce sont des intermèdes personnels ou récits/réflexions intercalaires pour témoigner à son tour de l’état du monde. Numérotés en chiffres romains ils montrent l’engagement de l’auteur et la dénonciation des imperfections du monde. Les constats sont parfois amers et l’intention polémique, mais il arrive que les récits aient une connotation optimiste. « Pas de titre aux textes intercalaires car souvent le titre induit la lecture, ce que je ne souhaitais pas en écrivant ces courts textes. J’espère une immersion du lecteur dans le texte et dans son propre intérieur, sa propre lecture. » (Nicolas Kurtovitch)
Dans le premier récit on aborde tantôt progressivement, tantôt brusquement d’autres personnages, par un effet de concaténation. Il s’agit de passer en revue plusieurs générations et de les relier par le souvenir et les évocations. D’où ces retours en arrière, ces va-et-vient entre moment de la narration, présent et passé. Des relais de narration s’enchaînent, de manière interne et externe. Puis il y a ces intermèdes de l’auteur, qui interroge le monde, brisant les différentes diégèses. C’est une manière originale de déconstruire une structure classique.
Le regard est acteur : c’est souvent en regardant vivre autrui que l’auteur écrit, puisant dans son imagination, ou dans l’Histoire, le terreau propice à ses développements.
Pour ce qui est des genres, ils sont divers : narration, poème, théâtre, réflexion sociologique, interpellation.
Personnages dans Trois femmes page 9 à 56
L’aïeule, qui est la narratrice, occupe une place prépondérante ; il s’agit de H, la principale voix : elle habite la maison et elle y retourne aussi en rêve et en pensée.
Elle est escortée par sa belle-fille et son arrière- petite-fille J.ou Juliette.
Second personnage -clé, V. ; cette dame n’est pas née dans le pays mais y est venue et souvent sa pensée est ailleurs, d’où l’hésitation à prendre un billet -avec retour ou sans- elle finit par choisir le retour.
Enfin il y a cette autre femme, nommée I. qui est de Lifou. C’était la nounou des enfants et elle est restée personne chère dans la famille. On l’entend parler page 21 paragraphe V, s’extasiant sur la beauté du lagon vue d’avion, puis page 25 paragraphe VII où elle se décide à aller à Paris visiter sa petite-fille ; et enfin page 34 paragraphe X ; c’est elle qui envisage le voyage en France, et V. décide de l’accompagner et en profitera pour voir ses frères. I. déroule le fil de ses pensées en déambulant dans Nouméa, en évoquant son champ à Lifou, les secrets de famille, l’affection qu’elle porte à tous ses membres, sa mission à Paris.
Sont aussi évoqués, gravitant autour de la protagoniste H :
Son fils (grand-père de J.)
Les petits-enfants de la belle-fille, dont Juliette
La mère de la belle-fille
La maman de la narratrice (évocation de son troisième accouchement, la naissance d’un fils)
La tante de J., L.
La généalogie présente donc cinq générations d’êtres humains reliés par le temps et le sang : la narratrice et sa mère évoquée, son troisième fils et sa belle-fille, leur enfant (son petit-fils), Juliette, son arrière- petite-fille, des amies.
La narratrice principale tâche de remonter le fil de ses souvenirs. Elle part sur les traces de Jérémie et de sa mère, elle essaie de reconstituer la vie de son frère, ancien géomètre enfermé dans les camps. En délibérant sur sa vie, soixante ans après être arrivée en Nouvelle-Calédonie, elle imagine ce que sa vie aurait pu être, si elle était retournée dans sa patrie d’origine. Sa descendance calédonienne n’étant plus exilée, elle a dû renoncer à partir. Le voyage, le souvenir, les rencontres et le renoncement auréolent la protagoniste de cette première nouvelle.
Quant à I., elle hésite à partir définitivement. Cette délibération interne s’accompagne de réflexions sur son attachement à son île, Lifou.
Ainsi les rencontres gratifiantes, l’interrogation sur l’identité sont des corollaires qui transcendent les personnages.
Techniques d’écriture
Dans Trois femmes
Le statut même de la narratrice principale appelle les réminiscences ; le temps et l’espace, convoqués, sont imbriqués. Analepses, prolepses et ellipses rythment la nouvelle. On assiste à une alternance d’histoires :
Celle de l’ancêtre-la mère- avec son fils Jérémie qui arrivent par bateau en Nouvelle-Calédonie.
Celle de Juliette et de son arrière-grand-mère.
Celles de la famille, reconstitués par I. la nounou de Lifou.
Celle de V., l’amie décédée.
Les récits sont enchâssés et se donnent à lire comme un palimpseste déroulé progressivement. Le dédale des noms et des générations peu à peu prend sens, invitant le lecteur à recomposer l’aventure familiale, à l’allure d’odyssée. Ainsi le lecteur est invité à une reconstruction généalogique progressive et les aléas et bonheurs de la dynastie s’organisent peu à peu.
La délibération, le soliloque et les dialogues alternent car l’aïeule compose avec la communication avec sa famille et ses pairs et la solitude de ses pensées. L’appel du pays natal traverse la nouvelle.
Dans le recueil
Les témoignages, les récits de vie occupent une place importante. La douleur de l’abandon, la perte d’un être cher, l’emprisonnement, la misère matérielle ou morale, les exécutions arbitraires sont fréquemment des troubles récurrents qui exigent un exutoire ; pour celui qui reste, il faut composer avec les aléas, faire semblant, trouver un asile propice à la sérénité d’un moment, réfléchir et anticiper, bricoler. La littérature, la méditation restent des échappatoires et des exutoires nécessaires et efficaces. Mais parfois la misère des squats et les expédients de ses habitants laissent pantois.
L’observation de ses pairs est une source inépuisable d’inspiration pour N. Kurtovitch et l’occasion de faire oeuvre de compassion, de dénonciation, de manifester son empathie ou bien de capter l’esthétique de l’instant, comme dans l’intermède 11 page 195.
Nombre de nouvelles et résumés ; liens avec la nouvelle principale
On trouve dix-huit nouvelles dont une à quatre épisodes (« L’allée couverte de graviers blancs »). Chacune met en situation l’humain et se charge d’enseignements.
Intermède I page 57 (ou récit/réflexion intercalaire)
Installé sur une île et hébergé dans une maison le narrateur constate l’état d’inachèvement des choses : construction en cours, jardin laissé pour compte, à l’image de toutes les maisons et de tous les jardins. Aucune permanence, aucune complétude, tout est dans l’inachèvement. Peu à peu il comprend pourquoi : l’essentiel sur l’île n’est-il pas de laisser couler le temps, de vivre ensemble et de « toujours nouer les fils de la parole, de l’amitié, du cœur et de l’esprit ? »
« Rentrée de nuit » page 59
S’inspirant de sa propre expérience, l’auteur met en scène une surveillante Y, ancienne pensionnaire de l’établissement où elle travaille, à Bourail ; le moment de la nuit est propice à la réflexion, les douleurs de l’abandon répondent au sentiment du devoir à accomplir.
Intermède II page 71
Idée récurrente chez N.Kurtovitch, le passage provisoire sur terre, l’origine et l’identité traversent ce récit intercalaire. Repassant au château de son enfance, il se remémore un rituel qu’il accomplissait alors : retrouver la sensation bienfaisante de la terre à travers les dalles de béton de la cour, grignotées par de l’herbe. Apercevant plus loin un Vieux heureux de rejoindre son champ, il ressent de l’empathie, une proximité avec lui, partageant le même bonheur simple de pouvoir jouir de la nature.
« Une femme à sa fenêtre «
La guerre du Vietnam dans les années soixante a conduit nombre de familles à se séparer de leurs enfants pour les préserver. C’est le cas de la petite Hoami N’Guyen. Soixante ans après elle se remémore la douleur de la séparation, son adoption et, pour la première fois, elle est confrontée à la vérité. Ses parents ne reviendront jamais, ils sont morts.
Intermède III page 83
La métaphore de la navigation en pirogue polynésienne est filée pour exprimer le plaisir de lire et l’isolement gratifiant par le voyage littéraire. La baie d’Uro, où se fabriquent encore les pirogues traditionnelles, est si propice à la rêverie procurée par le livre, que l’on croirait voguer.
« Rendez-vous » page 85
Sur une station d’élevage des broussards et des ouvriers se rencontrent régulièrement pour les travaux ruraux ; mais cette fois la rencontre est particulière, divers partis vont tenter une conciliation. F., V., M., autant de personnages et de tranches de vie qui s’insèrent dans un territoire en marche. Rester ou partir ? S’accommoder de la dureté de la tâche ou retourner en tribu, Des choix mettent les personnages face à leur destin.
Intermède IV page 95
Toute l’ambiguïté du dieu Nickel se révèle dans ce récit intermédiaire où, mi-heureux, mi-cynique et ironique, le narrateur est conduit sur les hauteurs de la mine, en camion. L’usine métallurgique est assimilée métaphoriquement et ironiquement à la montagne taoïste. Au plaisir né de souvenirs enfantins se mêle la dénonciation des générateurs de nuages gris.
« Si tu vis, tu as quelque chose à dire »
Un vieil homme est décédé ; il avait coutume de venir raconter des histoires à un jeune handicapé. Resté seul, le jeune homme applique la devise du Vieux « si tu vis tu as quelque chose à dire » et se met à écrire.
Intermède V page 107
Un objet légué au narrateur retient toute son attention : une fronde, faite d’une racine de banian découpée en lanières et en paume devient symboliquement le catalyseur des émotions du donateur. La description et l’imagination sont à l’oeuvre dans ce texte.
« L’allée couverte de graviers blancs » page 111
L’évocation du château Hagen, où le narrateur-auteur a passé les premières années de son enfance est manifeste ; cette maison, propriété de sa mère, a eu du mal à être apprivoisée par son frère et lui, prisonniers de leur vie passée à Paris, dans la banlieue nord de Paris, à Stains, à portée de vue du Bourget (Par-delà la banlieue).
Puis après le départ de leur mère c’est l’internat à Bourail pour cinq longues années et des efforts d’adaptation à la vie de pensionnaire (Une rentrée).
Le lyrisme se déploie dans le récit suivant avec l’évocation d’une tragédie, un éboulement suivi de l’enfouissement d’une maison où son camarade de pension fut enterré et jamais retrouvé. Cet événement terrible à Poé hante le narrateur et imprime en lui une douleur indélébile (La route n’est plus en terre).
La figure de la grand-mère Marthe, les parties de cartes avec elle dans la Grande maison sont l’occasion pour le narrateur d’évoquer son enfance et l’évolution de la ville de Nouméa (Parties de cartes).
Intermède VI page 129
Ce texte poétique intercalaire dit la finitude, l’impermanence. Tout change et tout est voué à disparaître, ce que l’on ressent, ce que l’on donne, ce que l’on construit. L’énergie en mouvement régit l’univers qui se vide et se renouvelle.
« Les amis retrouvés » page 131
Ce beau poème narratif, sans concession et engagé, est empreint d’émotion ; il dit l’absurdité de la guerre et la fraternisation de soldats de camps opposés ; l’inéluctable survient : un obus, « les corps déchiquetés ne sont pas rendus ». L’affreuse machine guerrière broie les hommes à l’envi et en fait des marionnettes.
« Approvisionnement libre » page 141
Les Viandards, selon une expression tirée du dernier recueil de Claudine Jacques, sont des braconniers sans scrupules qui abattent un bétail facile – qui ne leur appartient pas- et s’en vont le négocier avant l’aube à Nouméa ; la nouvelle donne le point de vue de l’un de ces braconniers sans vergogne ; il attend ses comparses. Mais un accident survient, relayé par la radio.
« Un oiseau » page 145
Ce conte allégorique raconte, à travers l’amitié d’un oiseau et d’un homme soucieux d’écologie, l’évolution dans l’occupation du sol par les humains et le secret des plantes.
Intermède VII page 155
Paysage de squat, décroissance et récupération pour dénoncer un espace péri-urbain fait de bricolage et d’expédients ; boue, marécage et misère. Dans ces eaux stagnantes règne un paradoxe : c’est l’univers de jeu des enfants.
« T. est déjà libre » page 157
Etre intervenant auprès de détenus du camp Est n’est pas chose facile ; le narrateur -auteur a dû s’y préparer. C’est l’occasion de découvrir des perles sous la brute, la résilience et le désir de liberté déjà là chez des prisonniers méritants, accrochés aux séances d’écriture comme à une bouée.
Intermède VIII page 165
La banalité de la vie chez un vieux couple routinier attire l’attention du narrateur, qui éprouve de l’empathie à chaque rencontre fugitive avec ces personnes. Balayer, regarder les passants sans y avoir l’air est une façon brève pour eux d’adoucir leur vie désoeuvrée, en marge des activités sociales.
« Une rencontre » page 167
Pur produit de sa résidence en Chine, cette nouvelle rend compte d’un épisode fortuit entre l’auteur, attablé à une terrasse de café et un homme surgi de la foule, venu écrire rapidement, penché près de lui, sans le voir, quelques idéogrammes. La rapidité de la scène, son caractère improbable donnent l’occasion de s’interroger sur l’étrangeté de la situation, sur le mystère de l’écriture, sur l’Autre, sur l’instantanéité : sommes-nous faits pour durer, pour rester, ou ne sommes-nous que de passage ? Un sentiment de frustration demeure, le scripteur est parti, fondu dans l’anonymat de la foule.
Intermède IX page 171
L’observation d’une scène privée- un couple heureux rentre chez soi- permet à l’auteur de retracer le portrait d’une femme heureuse au bras de son époux. Une complicité implicite s’instaure entre elle et le passant qui les observe. Le bonheur se transmet, comme une onde s’élargissant. C’est une des rares nouvelles positives où le bonheur règne en partage.
« Contre la montre » page173
Focus sur trois femmes de ménage qui travaillent tard la nuit dans de grands immeubles impersonnels. Leur vie est rythmée par les tâches peu épanouissantes, l’attente du dernier autobus vespéral, la solitude. Une lueur d’espoir naît cependant, propice à la rupture du quotidien : l’une d’entre elle sait conduire, elles pourront partir faire le tour de l’île. Opportunément la solution au désir d’évasion s’offre à elles.
L’auteur a su capter ce moment d’espoir et de résilience qui embellit le quotidien de gens simples.
« A l’ombre » page 179
Prosopopée d’un arbre qui s’indigne de la présence à son pied de musiciens trop superficiels, insouciants des grands débats sociaux, contents d’eux-mêmes et du plaisir de leur art.
Intermède X page 185
L’observation d’un jeune cycliste habile et courageux se faufilant dans la circulation permet au narrateur une réflexion sur la densité du trafic, la jeunesse insouciante, et de jeter un regard d’identification en arrière ; il revit sa propre situation, jadis.
« Un passant vint à croiser… » page 187
Le narrateur attablé devant un café près du centre des arts assiste à une scène curieuse : un passant est fasciné par le débit oratoire d’un clochard, qui semble s’adresser non à un pair présent, mais à une troisième personne absente.
Le passant l’interpelle pour lui faire part de son admiration et l’incite à faire du théâtre. S’ensuit un échange oratoire insolite. C’est l’occasion pour le clochard d’affirmer l’espace voulu de son propre théâtre : la rue.
Intermède XI page 195
Réflexion sur une scène bucolique en plein Nouméa : un petit vieux cueille des piments et les range dans une petite boîte. La beauté du geste et ce qu’il implique séduit le narrateur, qui n’est pourtant pas amateur de piment. Un instant, fugitif, lui apporte un bonheur simple et profond.
« Un amour » page 197
La voiture est arrêtée ; un homme se penche à la fenêtre vers la conductrice et lui déclare son amour ; mais elle doit faire avancer la voiture et partir. Trente ans après, ce souvenir la hante. Aurait-elle manqué l’occasion de sa vie ?
« Deux hommes » page 201
Une fraternité insolite s’établit entre un prévenu et un juge. Bousculant les conventions ils se rapprochent et partageront désormais le même destin. La vie est si simple !
Intermède XII page 207
Etre à soi et au monde s’exprime dans la méditation, assis en tailleur sur un petit balcon. L’esprit ainsi se concentre et ramène le narrateur vers l’essentiel, les lieux de sérénité connus de lui seul.
« Un journal » page 209
La nouvelle « Un journal » prend le visage de la solidarité, lorsque le directeur du Service des Archives tombe sur sept cahiers abandonnés destinés au pilon. Il va en publier la majorité sauf un extrait qu’il réserve à un usage ultérieur. Sous une forme poétique l’extrait évoque des exécutions massives qui eurent lieu fin XIX, début du XXème siècle : une auteure y témoigne de manière poignante de l’exécution de son frère. La jeune femme rentre seule et, sur sa véranda se dessine en filigrane le portrait de son frère, qui aurait pu avoir un autre destin.
« Les Papillons » page 217
C’est un morceau d’argumentation ; la dialectique oppose deux voyageurs dans un autobus et traite de la lecture-écriture. La forme théâtrale permet ce jeu d’opposition très visuel et découpé en trois actes, susceptible d’être dramatisé sur scène.
Acte 1. L’un des voyageurs prône la lecture, porteuse d’espoir, d’intelligence, d’angoisse, d’amour, bref d’humanité, à l’image du Jeu d’échecs. L’autre rétorque la vanité de la lecture et préconise l’action, le concret, l’utilité et le pragmatisme. L’acte s’achève sur une possibilité de conciliation même si les personnages se séparent et vont dans des directions symboliquement opposées.
Acte 2. Quinze ans plus tard les personnages se retrouvent dans l’autobus et changent de position physique et de point de vue.
Le règne de l’intelligence et de l’évolution spirituelle a prévalu. C’est un plaidoyer pour la lecture-écriture. Le non-lecteur de jadis concède son tort. Il a écrit, à la faveur des contingences de sa vie. Enfermé, il a fait de la résistance politique et mentale et a réécrit Le Jeu d’échecs, à sa façon.
Acte 3. Le lecteur repenti fournit d’amples explications. Il a écrit une monographie, « Papillons de Nouvelle-Calédonie ».
Attrapé pour son engagement politique il a subi des sévices et fait de la prison jusqu’à la libération. Les couleurs lumineuses et allégoriques des lépidoptères, orange, jaune, bleu, illuminent sa vie, servant d’exutoire pour échapper à la folie. La démonstration est faite de l’efficacité existentielle et thérapeutique de la lecture-écriture. L’enseignement est clair : laisser faire la parole, le verbe salvateur, l’écriture qui chemine dans les esprits, seraient-ils les plus rétifs.
Axes fédérateurs
Ce sont essentiellement la pratique de la réflexion et celle de l’écriture qui unissent formellement toutes ces nouvelles. Elles sont érigées en techniques suprêmes pour équilibrer la vie et trouver du sens à sa finitude.
La généalogie, la famille, les portraits de femmes, l’exil (« Une femme à sa fenêtre »), le lieu de la prime enfance, l’affection (« Trois femmes ») le voyage intérieur/physique (« Une femme à la fenêtre », « Trois femmes »), la solitude et la souffrance, la littérature comme exutoire pour échapper à la folie, le théâtre (Les Papillons »), l’écriture salvatrice comme mission (« si tu vis, tu as quelque chose à dire » ; « T. est déjà libre »), la beauté de l’idéogramme et la poésie (« Une rencontre ») sont des thèmes récurrents, évoqués ensemble ou diversement.
La discontinuité dans le temps est manifeste ; elle révèle l’habileté de l’auteur qui nous enseigne les mondes parallèles, juxtaposés ou imbriqués : il y a une autre vie que celle de ces femmes ou de ces hommes ; Il y a la vie du dehors, le monde imparfait, les infrastructures insuffisantes ou inexistantes, la guerre, la violence, l’exclusion et le déni de l’Autre. Ces intermèdes faits de constats amers sont là pour nous le rappeler et susciter la réflexion sur un meilleur avenir ensemble.
Cette discontinuité est faite de ruptures, d’abandons, d’évanouissement : tout est passager, fugitif, furtif et fugace. Nous sommes des êtres de passage, il convient de capter l’instant. (Intermède IV page 95 ; Intermède II page 71 ; Deux hommes page 201 ; Une rencontre page 167 ; Un amour page 197…) Profondément influencé par le taoisme, l’auteur du Dit du cafard taoiste écrit pour dire l’impermanence du monde et des choses.
Espaces et symbolisme dans le recueil
Pas de description statique ; rien de très précis en fait sur le cadre, qui voit évoluer les personnages, leurs pensées, leurs activités et leurs relations. Ils se révèlent petit à petit. L’auteur montre à la fois l’isolement de la demeure, lieu privilégié, et les liens qui l’unissent au reste du monde.
Le bateau emmène Jérémie et sa mère ; c’est un lieu de non-retour, propice à la réflexion sur soi et au rapprochement. Il indique une perspective de recommencement pour ces deux êtres abandonnés.
La véranda, comme le toit-terrasse ou chez H. est l’espace idéal de relaxation ; elle procure la fraîcheur, l’isolement, la paix de l’âme et accessoirement l’accueil de la famille et des amis. Elle permet des parties de cartes avec la grand-mère Marthe et l’observation réciproque entre l’aïeule et son petit-fils.
L’allée mène majestueusement au château et est le théâtre de jeu des deux frères ; c’est une enfance à la fois insouciante et chargée des souvenirs parisiens.
L’école, le pensionnat sont vécus comme des lieux de douleur et d’abandon par les pensionnaires isolés de leur famille ; une fois devenue surveillante, l’héroïne, ancienne pensionnaire, se raccroche à une photo et aux règles d’accueil pour supporter son sort. Quant au narrateur, qui a lui-même expérimenté la vie au pensionnat, il en sort meurtri d’avoir perdu son âme-sœur, un ami mort tragiquement dans un éboulement.
L’autobus est le lieu de la rencontre des contraires et un espace d’échange ; la dialectique y a cours et permet la réflexion, à court ou à long terme ; le voyage physique est suivi d’un cheminement intérieur et de l’adhésion aux thèses de l’adversaire.
Le pays au climat méditerranéen, fait de garrigue, de senteurs de thym et de romarin, donne la nostalgie à la narratrice qui se sent déracinée parfois, comme passée à côté de sa vie ; le « heimat », la demeure familiale la hante malgré le bonheur apporté par sa descendance enracinée en terre calédonienne.
L’avion est l’espace convoité pour rentrer chez soi et échapper à l’insularité. L’aïeule en s’informant pour un billet manifeste la tentation du grand retour.
Le café est le lieu d’un certain voyeurisme : on est abrité, occupé et l’on glisse un regard subreptice vers l’extérieur. A la fois témoin et interprète, l’on est en bonne place pour retranscrire sans en avoir l’air. Le café fait de l’écrivain un voleur d’instants, un caméraman discret de scènes extérieures, l’œil pour voir et décrire le Monde.
La rue est propice à l’inspiration : espace public elle permet l’émergence d’un acte privé, l’écriture. Elle donne naissance à l’étincelle génératrice d’expression. Elle construit l’écrivain et le nourrit. Ouverte, elle aboutit à l’intime. C’est le paradoxe de la création, qui part du dehors pour s’exprimer au-dedans.
Le squat suinte la misère et rayonne de rires d’enfants heureux d’évoluer parmi les racines de palétuviers.
Autant de théâtres pour le spectacle du monde, autant de postes de surveillance et d’observation, autant de tours de guet pour capter l’essence du vivant et magnifier le souvenir.
Le temps dans le recueil
Il est relié comme un fil qui refuse de se rompre ; hier conduit à aujourd’hui qui à son tour convoque le passé. Le temps est métaphorique et allégorique d’une continuité. Les discontinuités ne sont qu’apparentes car l’être d’aujourd’hui est fait de toutes les contingences de maintenant et de tous les aléas d’hier. C’est le grand enseignement de ce recueil : la construction identitaire est étroitement liée à l’histoire : les autres et moi, moi parmi le monde. Si je suis jeté au monde, c’est que d’autres y ont contribué. D’où une forme de reconnaissance et un hommage à ces personnes du passé, proche ou lointain, qui demeurent présentes. La petite histoire s’insère dans la grande Histoire.
Maintes nouvelles font se télescoper la chronologie pour faire renaître les victimes du passé et considérer un vécu d’exception, qu’il s’agit de clôturer dans la dignité et l’espérance. Ainsi soixante ans séparent l’aïeule de « Trois femmes » de son pays natal et ce n’est pas sans conséquence sur sa propre construction mentale et identitaire. A la fin du XIXème siècle des exécutions massives et sommaires ont décimé des familles, comme l’atteste « Un journal », familles aptes cependant par le souvenir et l’espoir, à se reconstruire. De la guerre à la résistance en passant par la Libération, des gens ont été blessés, meurtris, amputés de tout, et pourtant prêts à la résilience.
Intérêt
Un des charmes du livre est certainement la vie intérieure et les échanges que mènent les personnages, soucieux de maintenir des liens familiaux et affectifs, tout en étant traversés par la nostalgie et les désirs inassouvis. Souffrance et sérénité cohabitent, instant présent et souvenirs coexistent.
C’est le temps de la narration et de la réminiscence des jeux à la Robinson dans ce grand jardin et cette demeure ancestrale, magnifiée par le souvenir et les personnes qui y ont vécu, ou qui ont gravité autour. C’est aussi le moment de récapituler la vie, d’imaginer ce qu’elle serait sans les contingences parfois graves ou dramatiques (exil, deuil, abandon, séparation, emprisonnement …) Le recueil fonctionne à la manière d’une photographie faite d’instantanés, d’incursions ou de regards sur des lieux et des époques, rappelant le film « Fenêtre sur cour ». Le regard scrute et témoigne. Fidèle au tao il observe la nature et le monde.
L’idée de permanence temporelle est questionnée, les notions de filiation et de transmission posent la question de l’identité : qui suis-je ? D’où je viens ? Comment me positionner dans le temps et dans mon temps ? A ces questions sur son origine N. Kurtovitch mêle une préoccupation sur l’aujourd’hui. La vanité des conventions, la vacuité des existences, la finitude de l’être et des sentiments sont illustrés et déclinés.
Ce recueil donne une impulsion. En mettant en scène divers personnages dans leur environnement, Nicolas Kurtovitch part en quête de sens souvent absent dans le monde et suscite réflexion et envie d’agir. Comme pour les personnages de la nouvelle « Les papillons », la littérature crée un réseau et impulse la réflexion sur Moi et le monde, imparfait par essence, mystérieux sans explication.
On ne peut refermer le livre sans réfléchir à la finitude de l’être, à sa propension au bonheur et à l’impossibilité de l’atteindre, en dépit des tentatives. Ecrire pour échapper à la touffeur de la ville avec ses miasmes et ses rumeurs ; évoquer le passé pour mieux s’ancrer dans un présent imparfait. Retracer des portraits blessés et montrer les limites de la résilience.
Un pessimisme relatif domine le recueil que ne désavouerait pas Schopenhauer.