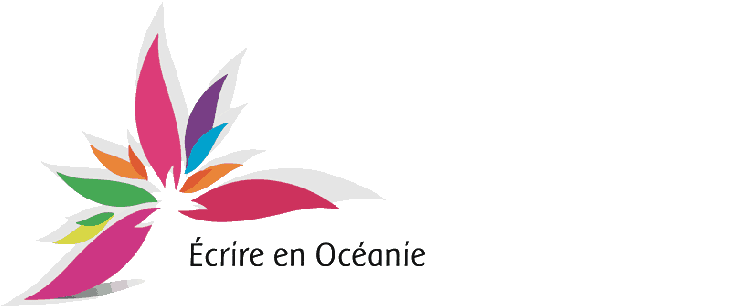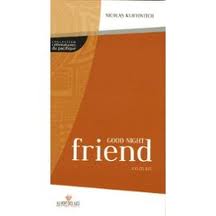Good Night Friend, par Florence Rouillon, professeur de Lettres modernes
Du titre du roman à l’esthétique de l’œuvre de Nicolas Kurtovitch
Good Night Friend est le premier roman de Nicolas Kurtovitch et le premier volet d’un triptyque romanesque en cours de rédaction. Tout en étant d’une facture qui renouvelle son œuvre, ce roman se structure autour de thèmes chers à l’auteur, ainsi l’amitié, la marche, l’errance, la rencontre avec autrui ou avec soi-même. L’amitié apparaît dès le titre, ce qui confère à ce thème une résonance particulière. C’est l’énigme de ce titre que nous voudrions interroger dans un premier temps. Afin de mener à bien notre interrogation sur le titre, nous étudierons le parcours de chaque personnage et essayerons de comprendre le sens de leur quête.
Ce faisant, nous voudrions montrer que les personnages ne sont pas seulement des êtres qui ont une histoire, mais qu’ils témoignent également du regard que porte l’écrivain sur son monde, ce monde insulaire caractérisé selon lui par une « interface culturelle ». Le tressage des points de vue dans le tissu du texte rend compte en effet de cette volonté de l’écrivain d’inscrire son œuvre dans la réalité de la Nouvelle-Calédonie : « ce que j’écris s’inscrit dans l’histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie » . Mais au-delà même de cet aspect social et historique, le tressage des points de vue participe d’un projet esthétique : il s’agit de raconter une terre, de rencontrer les êtres, de les écouter afin de rencontrer l’humain. Par l’enchevêtrement des points de vue, la rencontre avec l’autre est autant un thème qu’une structure.
Good Night Friend est une œuvre profondément littéraire : les récits dans le récit, les mises en abîmes, mettent en lumière les conceptions philosophiques et artistiques de Nicolas Kurtovitch. Les personnages, par leur parcours, leurs gestes ou leurs propos, sont des doubles du romancier ; en effet, non seulement ils dévoilent son point de vue sur le monde mais encore ils refont ses gestes de romancier, comme si l’écrivain se tendait un miroir pour se voir au travail à travers eux. Certes, Nicolas Kurtovitch réfute toute idée d’autobiographie dans son œuvre et de fait, si autobiographie il y a, elle ne saurait être dans les thèmes. Mais la négation semble un aveu ; une problématique personnelle à l’auteur semble là, bien présente, à l’œuvre dans le roman lorsque, par exemple, l’absence devient l’enjeu d’une reconstitution romanesque : « Je ne peux pas être schizophrène au point de ne pas être moi-même quand j’écris », déclare savoureusement l’écrivain après avoir réfuté l’idée de toute autobiographie . Cette oscillation entre un refus autobiographique et un engagement authentique de l’écrivain dans son œuvre est riche de sens. Ainsi, après avoir évoqué les doubles du romancier, étudierons-nous dans un troisième temps le personnage du père. Le roman se partage entre art poétique –s’il est vrai que l’écrivain y inscrit son art, ses conceptions de la création romanesque- et confession masquée : le personnage du père, l’absent, le silencieux, retiendra toute notre attention.
La rencontre avec l’autre est indissociable d’une rencontre avec soi. Le surgissement du monde, et de l’autre en tant que monde dans l’univers romanesque est indissociable d’une réappropriation de l’identité. A propos de l’écriture, Nicolas Kurtovitch n’écrit-il pas qu’il est certain de « trouver de quoi (le) faire vibrer et de quoi mieux connaître le monde autour de (lui) et en (lui) » ?
I- La justification du titre. Un passage dans le roman :
a- L’extrait :
Le titre propose une énigme. En effet, « Good night friend » est une parole bienveillante, la parole bienveillante que quelqu’un adresse à quelqu’un d’autre. Mais le roman n’a pas de personnage principal, les narrateurs sont multiples et les récits violents parfois. Est-ce donc un paradoxe?
Le titre est donné au roman par un épisode du texte; un personnage trouve son chemin dans un squat, mais son aventure le conduit sur un chemin symbolique qui nous mène, nous lecteur, précisément, à une compréhension plus profonde du texte et, nous y reviendrons, de l’œuvre de son auteur. Ce passage nous permettra d’accéder à la poétique de Nicolas Kurtovitch.
Manuel est à la recherche de Moueaou, il est mis sur le bon chemin par « un gars » qui tient une « boutique » (p.95), aussi désignée par le terme de « cabane » (p.94). Cet épisode, qui aurait pu paraître anecdotique, ne l’est pas puisqu’il justifie le titre de l’œuvre.
« En marchant il me parle du Vanuatu, où il a passé six mois l’année dernière :
– Tu vois, le soir, à Port-Vila, tu marches dans la ville, tu croises des gens, des Blancs ou des Kanaks. Ils disent tous : Good night. Ils te dissent : Good night friend. Des mecs qui croisent un inconnu, qu’ils ne connaissent pas, qui n’est pas comme eux et qui lui dissent : Good night friend! C’est pas rien. C’est ce que nous sommes en train de perdre, nous tous, la faculté, l’envie, surtout l’envie de dire à un inconnu : Good night en toute simplicité. Lorsque le jeune homme de Port-Vila, cette nuit-là, m’a souhaité la bonne nuit, j’ai marché plus légèrement, j’aurais pu marcher ainsi des heures, j’étais heureux. C’est quelque chose qui devrait être naturel et simple, de recevoir un geste de sympathie, et pourtant ça m’a percuté comme un baiser, comme un geste d’amour. Tu réalises dans quel vide nous vivons.
Je ne lui ai rien répondu, nous étions arrivés (…)
Il m’a planté là, en quelques secondes il avait disparu par un chemin qui contournait la cabane. »
(pp.95-96)
Cette rencontre constitue un récit dans le récit, une mise en abîme. Manuel, qui marche dans la nuit, rencontre un homme qui, il y a un an, marchait dans la nuit, et à qui un homme, un passant comme lui, a offert un salut amical. L’aventure de Manuel se trouve reflétée par l’aventure du jeune homme. Il s’agit bien d’une mise en abîme, ainsi que la définissait Gide dans son Journal en 1893:
« J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre par comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à mettre le second en abyme. »
Le sujet de l’œuvre est « transposé » dans cet épisode ; cependant, il y a une forme d’accomplissement qui se lit dans l’aventure du Vanuatu, alors que les aventures des personnages principaux ont un aspect inachevé. En quoi ce récit spéculaire peut-il receler le véritable message de l’œuvre ?
b- Le lieu et la parole :
La rencontre de Manuel et de cet homme est fugace. On ne sait rien de ce jeune homme, ou peu de choses, seulement qu’il « fréquentait encore le lycée malgré son âge » « après une longue interruption de trois ans » (p.95). Ces détails renforcent l’illusion de réel ; on ne sait de ce personnage que ce qu’il dit de lui-même à Manuel. Fugace, cette rencontre n’en est pas moins importante puisqu’elle met Manuel sur le bon chemin. D’une cabane à l’autre, Manuel trouve son chemin dans un squat parcouru de nuit, mais il s’agit également d’un trajet symbolique qui montre à Manuel le droit chemin. Sur ce chemin Manuel découvre non pas un lieu, mais une parole : « good night friend ». Le lieu, cet espace que traversent Manuel et le jeune homme, permet de trouver un nom : « good night friend » (en jouant sur les mots, nous pourrions écrire que « good night friend » est un nom, puisqu’il est le titre du roman, il est son nom). L’espace est toujours l’espace du nom chez Nicolas Kurtovitch.
Le passage du texte est fortement structuré ; il s’ouvre sur la rencontre énoncée abruptement avec le jeune homme et se clôt sur la disparition soudaine de ce dernier, ce qui renforce l’aspect symbolique de cette aventure : Manuel rencontre un guide. Le monde s’ouvre à une dimension humaine plus profonde, l’errance prend fin, un sentier est trouvé, un propos prononcé. Il est à noter que le jeune homme n’a pas de nom. Ce n’est pas ce nom-là qui importe au narrateur, c’est un propos, la parole humaine du jeune homme dans le court lapse de temps du voyage, de la marche symbolique. Le lieu –la bonne route- est intimement lié au mot –le bon mot, la bonne parole presque, le droit chemin. Tout se passe en fait comme si l’espace était la parole elle-même. Par une inversion qui structure le roman, ce n’est pas le lieu qui permet de trouver une parole, c’est la parole et le langage qui deviennent le lieu de la rencontre avec les hommes et avec soi-même dans le même temps. Une dialectique entre le nom et le lieu est à l’œuvre dans l’univers romanesque et poétique de Nicolas Kurtovitch. Léa, au début du roman, cherche son nom et sa mère, à la fin de l’œuvre, accomplit sa quête en retrouvant son nom et sa terre. Mais le rapport entre le nom et la terre est d’une infinie complexité, puisque tantôt la terre permet à l’homme d’avoir un nom, tantôt il lui faut sonder l’espace de la parole pour rencontrer tous les hommes, ainsi que l’y invite la formule « good night friend », sorte de formule magique qui ouvre les portes d’un monde fraternel. Le nom est le lieu de la rencontre ; ce qui est vrai pour les personnages s’énonce également pour le narrateur : le langage est le lieu de la rencontre avec l’autre –les personnages, toutes ces autres consciences. Laissons pour le moment cette analyse en suspens, nous y reviendrons en abordant la question des points de vue.
c- De l’inconnu au lien fraternel :
Les répétitions sont multiples : « good night » est répété deux fois, de même que « good night friend » ; l’oralité est ainsi restituée, la surprise du jeune homme recevant ce propos est traduite par ce biais. « Un inconnu, qu’ils ne connaissent pas, qui n’est pas comme eux », restitue la maladresse du discours du jeune homme, mais dans le même temps décline la définition du mot « inconnu » : un inconnu, ce n’est pas seulement celui que l’on rencontre pour la première fois, c’est surtout celui à qui l’on n’est attaché par aucun lien, et que l’on ne rattache à aucun lien. Dans le contexte historique et social d’une île, la Calédonie comme le Vanuatu, l’individu est lié à un clan ou à une famille, et finalement, il est identifié par ce lien. En ce sens, on peut rencontrer quelqu’un pour la première fois, sans pour autant que cette personne soit « un inconnu » puisque précisément, il est identifié par ses liens de filiations, et par la même par ce qui le relie à un espace commun : l’inconnu n’existe pas. Il est loisible de comprendre ainsi cette maladresse, révélatrice : « un inconnu, qu’ils ne connaissent pas ». L’inconnu ici est celui qui ne rappelle rien de connu, celui dont on ne connaît ni le clan, ni la famille, celui qui n’a pas ses racines sur l’île, la terre ancestrale, c’est celui « qui n’est pas comme eux ». Au-delà de ce contexte historique et social cependant, l’inconnu s’abolit dès lors qu’il appartient à la communauté des hommes, dès lors que les liens fraternels sont tissés.
Cette parole, « good night friend », libère, rend léger, elle fait entrer celui qui la reçoit dans un espace où tous les hommes sont amis, liés donc par un lien fraternel ; autant que de l’amitié, c’est l’amour du genre humain qui s’énonce : « ça m’a percuté comme un baiser, comme un geste d’amour » (p.96).
d- Le Vanuatu :
Il convient maintenant d’interroger ce détour par le Vanuatu.
Le texte se construit par un jeu d’échos : Manuel, marchant dans la nuit, rencontre un homme qui, ailleurs, il y a peu de temps, marchant dans la nuit, a rencontré un homme qui lui a dit quelque chose qui s’est inscrit en lui –comme le titre s’est inscrit sur le roman. Le détour par le Vanuatu offre un voyage symbolique dans ce court extrait, où Manuel n’a pas le temps de voyager autrement que par ce biais. Voyage symbolique puisqu’il est vrai que le Vanuatu ne permet pas de faire un exposé sur une société mais bien de faire le récit de l’expérience de la fraternité. Le narrateur donne à lire au lecteur sa conception des liens sociaux.
Dominique Jouve remarque que nombre d’auteurs calédoniens font référence au Vanuatu : « Il est frappant de voir que les liens entre l’actuel Vanuatu et la Calédonie sont extrêmement développés dans (les) demi-fictions » . La société calédonienne ne se regarde pas comme dans un miroir dans la société vanuataise car une fracture est apparue, celles des « indépendances (qui) mettent des frontières politiques entre les archipels voisins ». Dominique Jouve étudie ensuite les stéréotypes liés à la référence au Vanuatu, mettant en lumière, par exemple, le stéréotype du rapport conflictuel entre une société dite primitive et le « développement capitaliste et marchand ». Rapports de ressemblances et de différences qu’exploite également Nicolas Kurtovitch. Si le propos de l’auteur n’est ni social ni politique, il est intéressant de constater qu’il fait ce détour par le Vanuatu, comme nombre d’auteurs calédoniens. Cet archipel est semblable à la Calédonie, et cependant différent. Le détour ne vaut que par ce qu’il nous apprend. Manuel, puis le lecteur à sa suite, apprend qu’un propos peut combler : « good night friend » est ce propos qui comble l’être ; mais ici et maintenant, dans la réalité de la société calédonienne, il n’y a pas ce lien social : « Tu réalises dans quel vide nous vivons », dit le jeune homme à Manuel (p.96). Si nous ne voyions dans la référence au Vanuatu qu’une comparaison sociale, nous limiterions et bornerions notre compréhension du texte, et cette obstination nous dérouterait. L’aventure de Manuel revête l’aspect du conte, Manuel entre dans une cabane perdue au milieu des brousses (un peu comme les personnages des contes entrent dans des cabanes négligemment perdues au milieu des bois), rencontre un guide, chemine et parvient à une autre « cabane », celle qu’il cherchait. Le monde s’est un peu dépouillé de ses broussailles, il a trouvé son sens. Le Vanuatu permet un détour symbolique vers un ailleurs, qui n’est pas tant une autre terre qu’une autre manière d’appréhender le monde et les autres. Manuel entend parler d’un monde où existe la formule parfaite qui rend l’homme heureux, qui fait que l’inconnu même s’abolit dans l’énoncé de l’amour fraternel. Il faut marcher pour entendre ces mots, croiser la personne qui les dira, et continuer à marcher ensuite en étant métamorphosé en profondeur. Le véritable lieu de la métamorphose, c’est l’être. Un être qui n’arrête pas de marcher sur un chemin clair, bien tracé.
e- Léa et Manuel :
L’aventure de Manuel s’oppose rigoureusement à celle de Léa. Manuel fait une bonne rencontre qui lui évite d’errer dans le squat, son guide lui parle de fraternité ; il trouvera Moueaou. Léa s’égare (elle « se rendit dans un autre squat sans vraiment réaliser comment elle y était parvenue », p.66), elle rencontre des hommes qui tentent de la violer, qui l’appellent « frangine » (p.69) « soeurette », « petite sœur » (p.70), des hommes dont elle dira qu’elle n’est pas la « sœur » (p.76). Elle sera sauvée par un autre personnage mais ne trouvera pas Moueaou.
Les propos tenus s’opposent de manière caractéristique : « Good night friend » résonne dans toute l’œuvre par le désir du lien d’amitié qu’il énonce ; « On ne te demande pas ton avis » p.70, « Tu vas fermer ta gueule et tu vas te tenir tranquille » p.71, où le langage grossier rend compte de la brutalité des gestes, « Elle ne crie même plus », « elle a compris qui sont les maîtres ce soir » (p.75), traduisent le désir de réduire l’autre au silence, de le réduire à l’état d’objet. Ces assertions témoignent de rapports au paroxysme de la violence. Dans l’aventure de Léa, les rapports humains sont en parfaite déliquescence ; or, le lieu de son aventure se situe près d’un marais putride:
« L’odeur nauséabonde d’un petit marigot y dominait, mais le gérant du nakamal installé là savait choisir ses bois et les trois feux dégageaient discrètement de bonnes odeurs de gaïac » (p.66).
Léa dans ce passage cherche Moueaou, mais nous savons qu’elle cherche aussi son « nom d’avant ». La quête de Léa est en rapport avec la recherche d’une origine. Or, ce qui l’accueille dans ce lieu où elle s’arrête, c’est la musique de Bwanjep : « Si on écoute Bwanjep, l’ambiance doit être bonne » (p.66). Ce musicien est à l’origine du kaneka. Même s’il est vrai qu’elle n’est pas venue chercher son nom dans ce lieu, même si elle n’est pas ici en quête d’une origine, son personnage est accompagné par une musique aux origines du kaneka. Un peu comme dans un opéra, les personnages sont accompagnés, parfois, par des thèmes qui les caractérisent. Cette sensibilité à l’opéra apparaît également à la fin du roman. Cependant, la musique qu’apprécie Léa sera remplacée par une autre musique, médiocre, quand l’aventure de la jeune fille tournera au drame. La scène se veut cinématographique.
Léa se laisse gagner par « La magie de se sentir présente au monde végétal », (p.67), mais elle se trompe et ne voit pas tout de suite venir ce qui l’attend : « (Kaoua) n’a pas pu remarquer les quatre individus surgis d’un chemin que Léa n’avait pas encore aperçu » (p.68). Il n’y a pas que de bons chemins qui mènent à ce lieu. Lorsque le feu s’éteint :
« L’odeur fétide du marais, derrière les arbres, entre la lagune et la mer, supplante l’odeur des restes de bois en combustion » (p.72).
L’haleine des hommes saouls charge l’atmosphère ; la musique, comme cette haleine, devient « merdique » (p.72) ; alors le paysage se métamorphose, la clairière est « suspendue entre terre et boue » (p.70) :
« Le feu, de plus en plus faible, que personne n’alimente, jette une vilaine lumière sur la clairière. Il craque encore, ultime sursaut avant de mourir, le froid pénétrant s’insinue entre les branches depuis la mer toute proche. Le couple restant s’est enfui sans se faire remarquer, les arbres, les arbustes chétifs sur le point de disparaître dans la nuit, laissent leurs ombres couvrir le sol de terre et de sable. Ils ne sont plus ni beaux ni protecteurs, ils sont, alliés du mal, douleur et appréhension imbriquées. Ils isolent ce triste lieu de la ville, à peine distante de cinquante mètres » (pp.71-72).
Entre « terre et boue », cette expression rappelle en l’inversant celle que Léa énonce à propos de son père pour qui l’homme « se tient entre le ciel et la terre » (p.16). Les arbres, comme le couple qui s’est enfui, enfouissent leurs ombres dans la boue : ils voudraient disparaître. Dans le même temps, ils deviennent le double fantomatique et inquiétant des hommes auxquels ils s’allient dans le mal et se souillent de boue dans la lie de l’humanité, a-t-on envie d’écrire.
Ce paysage est un paysage intérieur –Léa a peur, elle vit un cauchemar est demeure longtemps « incapable d’imaginer une issue, une fuite » (p.68). Mais il est aussi une image donnée aux relations humaines. Les deux métaphores se construisent conjointement. Léa avouera dans sa lettre à son père, après cette aventure :
« Après il faudra que tu m’aides à trouver mon chemin au milieu de tout ça. J’ai l’impression d’errer à l’aveuglette dans une partie de ma vie. Une partie est lumineuse, il y a Camille, Manuel (…), mais le reste ? » (p.76)
Léa semble perdue en elle-même, bien qu’elle ait pris conscience de sa force. Les relations humaines, en dépit de la présence de Kaoua, se détruisent de par leur violence même. Le paysage se vide, comme dans cette phrase que prononce le jeune homme : « Tu réalises dans quel vide nous vivons » (p.96) :
« La clairière est vide, sans lumière on n’y distingue rien. Aucune étoile, plus de feu, pas un souffle de vent, rien. Même les arbres n’ont plus d’ombre. Il est très tard, Léa a froid, fatiguée elle ne pense plus qu’à une seule chose : quitter ce lieu et découvrir qu’il y a une autre vie, derrière les arbres, une fois la voie de dégagement traversée. Chez elle peut-être, où chez Camille » (p.77)
Léa n’a pas trouvé son guide : il n’y a plus d’étoiles, plus de feu, plus de vent, la métaphore est celle d’une navigation sans point de repère. Le monde s’abolit, se dissout : « même les arbres n’ont plus d’ombre ». Il disparaît et devient le néant, comme sont anéantis les espoirs de Léa, comme les liens humains devenus inexistants. Les termes qui qualifient le paysage qualifient ce que ressent Léa –le froid, l’obscurité, le désir de trouver une « voie de dégagement ». Comme en une métaphore à fondement métonymique , les lieux inscrivent leur empreinte sur les êtres (le froid venu de la mer et le froid intérieur, l’obscurité, le champ lexical des odeurs du marais et des beuveries, le caractère fétide du marigot et du marais des relations humaines) : un rapport de contiguïté et de continuité existe entre les espaces extérieurs (les squats) et les espaces intérieurs (la vie intérieure des personnages et le sens de leur aventure). Ce rapport d’analogie met en lumière, comme l’écrit Genette, « le rôle de la métonymie dans la métaphore » . La clairière, qui par essence devrait être claire, est paradoxalement sombre, comme une partie de la vie de Léa est lumineuse, ce qui sous-entend que l’autre est sombre. Cette partie lumineuse, elle la trouvera en rentrant chez elle ou chez Camille, en se rencontrant elle-même ou en retrouvant, « derrière les arbres », l’amitié de Camille.
Léa ne trouvera pas Moueaou, de même elle ne se trouvera pas dans sa nuit d’errance. Elle se trouve grandie, certes, mais il reste une part d’obscurité. Ce n’est pas elle qui accomplira la quête du nom, qu’elle avait pourtant amorcée. Est-ce à dire que Manuel réussit là où Léa échoue ?
La réponse n’est pas aisée. Si Manuel entend bien le propos du jeune homme, tout se passe en fait comme s’il n’en tirait aucun enseignement : « Je ne lui ai rien répondu, nous étions arrivés » (p.96). Manuel trouve Moueaou, mais ce sera trop tard car il ne reste plus suffisamment de temps à vivre au père. Un peu comme Perceval lorsqu’il se trouve face au Graal dans le château du Roi Pêcheur, Manuel ne pose aucune question, peut-être ne retient-il rien de son aventure, qu’il conclue par ces mots :
« Je marchais sans faire de bruit pour ne pas (…) déranger (le silence), cet habitant, jusqu’à ce qu’en sortant de la vallée, je réalise que je ne voulais pas enfreindre mon propre silence intérieur. J’avais peur de ne jamais retrouver ce silence » (p.101).
Le monde extérieur s’offre en écho au monde intérieur par ce vibrant silence. Manuel est l’homme des livres, non de la communication. L’objet de sa quête, c’est Moueaou. Le discours du jeune homme n’aura laissé en lui qu’un souvenir, peut-être ; le jeune homme a disparu pendant la nuit, comme le Roi Pêcheur et son château. C’est bien le discours du jeune homme, autant que Moueaou, qu’il lui a pourtant été donné d’entendre et de prendre avec lui.
La rencontre de Manuel et de ce jeune homme a lieu dans un univers ordonné, bien qu’il s’agisse aussi d’un squat, clair et dont les chemins sont bien tracés. Le squat est donc, comme l’écrirait Genette, un squat-camélon puisque ce lieu est tantôt positif, lorsque les relations humaines sont fraternelles, tantôt négatif, lorsque les relations humaines énoncent leur violence. Le paysage n’est pas, il ne peut pas être, ce que l’on a « sous les yeux » ; il commande tout au contraire un « rapprochement analogique » , c’est-à-dire la ressemblance entre les lieux et le lien humain ou ce qu’éprouve un personnage. Le réalisme de Nicolas Kurtovitch ne fait pas fi des espaces symboliques.
Les noms et adjectifs qui désignent et qualifient le squat que parcourt Manuel s’opposent à ceux qui désignent et qualifient le lieu dans lequel Léa se trouve piégée. Léa ne peut plus avancer alors que Manuel poursuit sa route. Manuel évoque la beauté du lieu en observant les habitations entre les flamboyants : « j’imagine qu’en été, lorsqu’ils sont en fleurs, ça doit être vraiment beau » (p.94). Leur ombre doit être rassurante et source de fraîcheur. Ils s’opposent ainsi aux arbres « alliés du mal ». Au monde de terre et de boue s’opposent les chemins secs (« Tant qu’il ne pleut pas », dit Manuel). A l’odeur du marais s’oppose l’odeur du café (p.94). Le café s’oppose aussi à la bière comme la convivialité à la beuverie, comme un accueil bienveillant à la brutalité des personnages imbibés d’alcool. A l’obscurité s’oppose la lumière. Quand Léa s’enfonce dans l’obscurité, Manuel marche vers la lumière :
« Après avoir quitté ce qui est la rue principale du squat, on ne trouve plus que des chemins, dans toutes les directions, et aucune lumière publique, même si le courant arrive. Certaines familles ont installé des ampoules dehors, devant leur porte, ça éclaire le passage en plus de la maison. Je suis passé devant un nakamal très éclairé, il devait y avoir une petite fête, avec de la musique, les gens entraient avec des gâteaux et de la nourriture » (p.94).
Lumière non pas publique, mais privée, en quelque sorte, propre à chaque maison, à chaque habitant. Le monde n’est pas vide, il palpite au rythme des échanges. Il y a une « rue principale », les chemins sont bien tracés: « J’ai pris un chemin qui montait un peu, je suis arrivé devant une cabane toute simple » (p.94), « en quelques secondes il avait disparu par un chemin qui contournait la cabane » (p.96). Le lecteur oublie qu’il est avec Manuel dans un squat tant ce monde est ordonné, paisible et chaleureux, Léa n’oublie pas qu’elle est à quelques mètres de la ville, antithèse du squat qui l’a piégée, cette misère. Enfin, la brièveté et la clarté de la description du squat traversé par Manuel s’oppose à la complexité de la narration de Léa. Les paysages dessinent des espaces de relations sociales, ils en sont les représentations imagées, les métaphores . La manière dont les personnages habitent, ou au contraire traversent les lieux, énonce leurs rapports aux autres. La description des lieux offre une image du lien social, à moins que ce ne soit subjectivement l’expérience intime vécue par chaque personnage qui ne vienne teinter de sa couleur singulière la description du lieu. Ces deux compréhensions ne sont pas antinomiques : elles sont complémentaires.
Nicolas Kurtovitch dit qu’il a cherché « à faire ressentir ce que vit et ressent le peuple calédonien, qui oscille entre espérance et découragement au quotidien ». Il existe autant « d’attitudes positives », incarnées par le « gars du squat », que « d’attitudes décourageantes », confie-t-il lors de l’entretien du 25 mars 2008. Des « périodes d’exaltation » sont suivies de « périodes de replis communautaires, de xénophobie ». On reconnaîtra en cela même le souci du géographe : les lieux inscrivent en eux l’histoire des hommes. « Les espaces (que parcourent Léa et Manuel) sont différents et pourtant distants d’un ou deux kilomètres ». L’espace que traverse Léa est unique, et cependant duel, « accueillant puis terrifiant ». « Les espaces, dit Nicolas Kurtovitch, sont transformés par le comportement des individus ». Ainsi en va-t-il de la société calédonienne. Cette tension est un leitmotiv dans les écrits théoriques de l’auteur qui avait affirmé en 2002, un an donc avant la genèse de Good Night Friend :
« Ce que j’écris n’est pas politique au sens pamphlétaire, tract, partisan d’un parti, mais c’est politique au sens de l’interpellation des gens de pouvoir (à la seule condition qu’ils me lisent et tâchent de comprendre !), interpellation de la pensée de chaque citoyen à propos de son vécu quotidien dans une Nouvelle-Calédonie si particulière, véritable Interface Culturelle, qui peut-être soit une chance de vivre quelque chose d’enthousiasmant, soit un piège de vivre dans l’illusion et l’aveuglement d’une population plusieurs fois subdivisée. J’essaie d’écrire pour éveiller le regard et le cœur, l’esprit et l’intelligence. »
f- Des rencontres :
Les rencontres que font les personnages s’inscrivent tout logiquement dans l’espace et dans le temps. La fraternité se trouve au cœur de la réflexion de Nicolas Kurtovitch et de nombreux thèmes traversent son œuvre afin de bâtir la définition de cette fraternité ; ces thèmes sont autant de chemins qui mènent au cœur de l’œuvre. Ainsi en est-il des thèmes de la marche, de la rencontre et de l’amitié. Le jeu des oppositions fait sens également, et ces dernières divisent les lieux et le temps : il y a des lieux où l’on fait de bonnes rencontres et des lieux où l’on en fait de mauvaises, il y a le topos du squat, avec ses chemins qui partent « dans toutes les directions » (p.94), qui s’écartèle en des sens multiples, il y a le Vanuatu et la Calédonie, l’opposition de l’ici et de l’ailleurs, de ce qui est maintenant et de ce qui a été un instant.
Les personnages de Nicolas Kurtovitch sont des marcheurs, jusque dans ce jeu de mots : « Oh oh, on marche à l’intuition ! » dit le jeune homme à Manuel (p.95). Les personnages marchent, souvent, longtemps, ils traversent des lieux, mais lieux et temps sont intimement imbriqués, les personnages ne cessent de marcher mais c’est le temps qui ne cesse de les traverser. Temps et lieux sont consubstantiels. Les personnages deviennent dès lors le lieu des changements. Le temps s’inscrit dans l’être profondément changé par une rencontre et un propos. Ce qu’entend le personnage au Vanuatu, « Good night friend », le rend différent. L’inconnu est reconnu comme ami : il devient un ami. Par ce mot, il a rejoint la communauté des hommes, dans laquelle communauté il avance le cœur léger : « j’ai marché plus légèrement, j’aurais pu marcher ainsi des heures, j’étais heureux » (p.95-96). Hors de toute topographie réelle, le guide de Manuel fait découvrir à ce dernier un espace où les hommes sont amis ; cet espace participe d’une ontologie. L’auteur n’oppose pas la société du Vanuatu à celle de la Calédonie. Il ne s’agit pas d’anthropologie mais bien d’ontologie, d’une réflexion sur l’être. Avançant dans un espace vide (son vide intérieur), le personnage se trouve soudain comblé par la parole qu’il reçoit. Cette aventure qui permet à ce personnage de connaître la plénitude dans l’expérience de la fraternité s’est produite sur une autre terre, dans un passé proche (« l’année dernière »), grâce à une parole énoncée dans une langue étrangère, pourtant compréhensible par tous. L’opposition du proche et du lointain est complexe. Le Vanuatu est une île voisine, fort semblable à la Calédonie, l’expérience faite par le jeune homme est récente, l’anglais est une langue étrangère mais ce qui est dit peut être aisément traduit, comme si « good night friend » eut constitué un langage universel. Cependant, ici et maintenant règne le vide : « Tu réalises dans quel vide nous vivons ». A bien des égards, le présent peut être compris non pas tant comme un présent d’actualité (par rapport à ce que dit le jeune homme, dans le cadre temporel du roman), mais comme un présent de vérité générale : par cette fable, l’auteur du roman définit sa vision du monde, révèle son désir d’un lien social respectueux de chaque individu. Vœu, désir, idéal : la fraternité est définie, elle est un geste d’accueil, une parole si facile qu’on peut rêver se l’approprier, et cependant elle demeure dans le lointain, irréalisée –ce qui est le propre du désir. Une parole fraternelle est difficile à dire et difficile à recevoir : « C’est quelque chose qui devrait être naturel et simple, de recevoir un geste de sympathie, et pourtant ça m’a percuté comme un baiser, comme un geste d’amour » (p.96). L’opposition se maintient en chaque mot, l’antithèse oppose, et unit dans le même temps, le verbe percuter au complément circonstanciel de comparaison comme un baiser. La fraternité par sa douceur ébranle la roideur du voyageur, mais l’expérience est singulière ; la société n’a pas résolu ses contradictions. Simple et naturelle, la fraternité ne définit pas le monde actuel ; à portée de main, elle est inaccessible. Elle demande à chaque individu et à la société qui l’habite un long cheminement. C’est en cela que la mise en abîme recèle le message profond de l’œuvre.
Comme une fable, cet extrait dispense une leçon de morale. Comme en un conte aussi, cet épisode tend au lecteur un miroir, mais un miroir magique où ce que l’on découvre n’est pas tant ce qui est que ce qui est désiré. Dans le miroir s’offre à voir ce que la société pourrait être, se découvre le lien qui pourrait unir les hommes entre eux. Ainsi le jeune homme énonce-t-il bien ce que la société n’est pas. Le miroir disparaît avec le jeune homme. Par ce procédé du détour révélateur, Nicolas Kurtovitch rejoint une tradition littéraire ; de la Renaissance au siècle des Lumières, de nombreux écrivains ont pratiqué ce détour par des mondes lointains, curieusement semblables au leur malgré leurs bizarreries, afin de mieux définir la société qui est la leur. L’aventure du jeune homme, cette fable, devient le miroir de ce que la société n’est pas : « Tu réalises dans quel vide nous vivons ».
Qui accomplira ce geste fraternel ? Léa ne le connaît pas; Manuel, auditeur attentif, semble ne pas donner suite au propos de son guide. Par quel geste, par quels mots, les hommes pourraient-ils être liés entre eux ? Sur quelle terre pourraient-ils se parler, tous ? Ces interrogations rappellent la quête de Léa, qui cherche son nom, celle de Moueaou qui cherche sa terre, celle du père qui cherche à rétablir le lien avec la famille dont il est l’agresseur, après en avoir été la victime. Un nom, des mots, un lieu, un lien : qui accomplira la quête de leur unité ?
Au seuil de cette nouvelle étude, souvenons-nous de ce qu’écrit Luc Baranger pour la quatrième de couverture du Piéton du Dharma. Le locuteur, dans ces trois recueils de poèmes, marche et mène une quête, comme les personnages de Good Night Friend. Or, voici l’objet de sa quête :
« Habiter le monde dans son universalité, dans un contact intuitif et y rencontrer l’humain.
Habiter ce monde en mettant ses pas dans tous ceux qui donnent naissance à la parole et à l’histoire.
Habiter cette terre pour que, chaque jour, un pas soit fait vers les autres : les amis, les inconnus, les événements qui font la vie d’un pays. »
Du Piéton du Dharma à Good Night Friend, il s’agit toujours d’habiter le monde en parcourant le langage, devenu terre sensible. Dans l’œuvre de Nicolas Kurtovitch, le langage n’est pas seulement ce qui permet de découvrir l’espace, de s’adresser aux autres, d’ouvrir le monde en découvrant de nouveaux horizons ou en partageant des expériences. En ouvrant sur le monde des autres, en y donnant accès, la parole devient elle-même un espace à parcourir. Le langage est lui-même un lieu, le lieu d’une expérience poétique et humaine.
II- Des récits dans le récit
Parce que tout livre est un recueil. Parce que l’accueil est bienveillant.
En devenant titre, l’expression « good night friend » qualifie l’ensemble de l’œuvre. Aussi le lecteur est-il tenté de trouver d’autres destinataires à cette salutation nocturne. L’épisode de la rencontre de Manuel et du voyageur est si anecdotique –en apparence, à première lecture- que l’esprit résiste, il veut savoir à qui s’adresse ce propos. Certes, l’entreprise semble être hasardeuse et la méthode peu judicieuse : après avoir écrit que le titre trouvait sa valeur en lui-même, en tant qu’énoncé d’un désir de fraternité –ce qui est bien le sujet du roman-, nous voudrions désormais lui trouver un émetteur et un destinataire, selon la terminologie peu élégante consacrée par la grammaire de discours. En étudiant les rapports entre les personnages, en posant la question des points de vue, nous chercherons à parvenir à une autre définition de l’amitié dans le roman. Or, la question de la narration est ici épineuse car les personnages prennent en charge le récit, les points de vue se juxtaposent puis se mélangent, le récit progresse, ce qui est une prouesse narrative, dans cet enchevêtrement de récits singuliers et pluriels. Au-delà même, un autre narrateur existe, un narrateur omniscient qui n’est pas un personnage du texte, un narrateur à qui l’on voudrait prêter le visage de l’auteur.
a- L’interface culturelle :
L’enchevêtrement des points de vue est autant la caractéristique formelle des récits de Nicolas Kurtovitch, leur aspect le plus littéraire, que l’énoncé du point de vue de l’auteur sur le monde. Il témoigne de ses préoccupations de géographe -Nicolas Kurtovitch est en effet licencié en géographie. Comme dans l’œuvre de Nicolas Ratzel, géomètre calédonien, quoique d’une manière radicalement différente, il convient pour comprendre de rendre indissociables les hommes de la terre. Le géographe, comme le géomètre, parle de terre, de terrain, de parcelles et des hommes qui les habitent, entretenant avec elle une relation conflictuelle ou une relation de symbiose. Le portrait des hommes se dessine toujours en filigrane du portrait brossé de la terre, et inversement, c’est dans la définition donnée à la terre que l’homme se définit.
Il est vrai que dans Good Night Friend, pas plus que dans Astral Weeks, les lieux ne sont nommés ; cependant, pour peu que l’on connaisse Nouméa, ces lieux sont clairement identifiables : la carte du géographe est inscrite dans ses romans. Ce « refus de nommer les lieux » permet de maintenir « l’ambivalence entre le particulier et l’universel », écrit d’une manière lumineuse Ysabelle Martineau . La carte du géographe n’est pas seulement un décor dans lequel évoluent les personnages ; de par les rapports qu’entretiennent ces derniers avec les espaces qu’ils traversent, aménagent ou fuient, l’espace permet la définition des personnages, représentatifs de groupes humains et, ainsi que le veut l’auteur, de la société calédonienne toute entière et au-delà encore, de toute société. L’œuvre romanesque porte en elle cette part de géographie humaine.
Ainsi Nicolas Kurtovitch avance-t-il l’idée d’une « interface culturelle » définissant les relations entre les hommes en Nouvelle-Calédonie. Le mot interface est complexe ; il est ainsi défini : « 1. chim. Surface de contact entre deux milieux. 2. Fig. Elément commun à deux ensembles, permettant des échanges entre eux. 3. Informat. Jonction permettant à deux systèmes informatiques d’échanger des informations grâce à des règles et des conventions communes. » La terre, tout espace, si petit soit-il (aussi petit que la cuisine de Dila par exemple), peuvent-être cette « surface de contact » entre deux milieux, voire entre des multitudes de milieux, de communautés, d’individus différents. Mais les communautés sont elles-mêmes des milieux qui ont établis leurs règles d’échanges avec les autres communautés qu’elles côtoient, sans réellement se métisser avec elles. Nous voudrions citer ici longuement l’article d’Ysabelle Martineau qui est fondamental ; Ysabelle Martineau cite par extraits l’article de Nicolas Kurtovitch : « Ecrire en pays dominé lorsque sa culture, sa langue, sont les outils de la domination » . Elle l’introduit ainsi :
« Dans les contextes littéraire et universitaire actuels, où le métissage et l’hybridité sont des valeurs sûres, «sexy», Kurtovitch est un dissident. En effet, selon lui, ce métissage culturel est le luxe des cultures fortes, hégémoniques, ayant des appareils de légitimation institutionnelle puissants, pouvant justement se permettre les emprunts, les assimilations, sans se mettre en danger elles-mêmes… (…)
C’est au nom de ce respect pour la culture kanak, afin de lui laisser son intégrité, sa logique interne, par respect pour le lent développement d’une nouvelle culture qui pourrait éventuellement devenir calédonienne, que Kurtovitch refuse le terme de métissage et lui préfère le terme d’ «interface culturelle». Il s’explique ainsi, et cette longue citation servira d’introduction aux textes que j’ai choisi de vous lire afin d’enfin faire entendre sa voix de ce côté-ci du monde :
En tant qu’écrivain, que créateur donc, mais également de chercheur de sens, chercheur de beauté et de vérité, je préfère penser et dire que je suis dans une interface culturelle, terme que j’emprunte à la géographie économique, à la fois pour l’espace d’échange et de rencontre qu’il nomme, à la fois pour l’espace mental propre à chacun, qu’il peut engendrer. J’ai le sentiment d’évoluer dans un lieu d’emprunts, de rencontres, d’affrontements, d’amitiés, d’amour et de rejets. Un espace qui est celui d’une page blanche, d’une scène de théâtre ou de danse, une voie où deux ou davantage de cultures se donnent rendez-vous. L’attitude de l’écrivain mais une attitude que l’on peut croire être celle de tout créateur, ne peut être que le mouvement. Le métissage culturel à l’inverse du biologique n’est jamais atteint. Ce ne peut-être qu’une perpétuelle création, des alliages, des alliances se font, se défont, des emprunts des rejets des retours sur soi sur sa culture maternelle, historique, des échanges libres, indépendants. […]
Cette voie est celle de la pratique de «l’interface culturelle» qui s’oppose, pour les années présentes à l’idée trop répandue et trop facilement acceptée du «métissage culturel», association rapide et pratique de termes, formant un tout indéfini, fourre tout, sac à pain où l’on découvre, au fond, plus de croûtons moisis que de pain frais. La pratique de l’interface culturelle, la pratique par les créateurs, artistes, peintres, musiciens, écrivains, architectes, poètes, de la reconnaissance, de la vision que nous existons dans un espace aux frontières par bonheur imprécises, où se rencontrent et s’enrichissent les cultures océaniennes et occidentales.
Alors que l’idée de culture métisse, de définitivement métisse, conduit l’artiste à vouloir créer quelque chose de métis, définitivement métis, [comme si ce qui se passe génétiquement pouvait se passer, ex-abrupto, sur simple décision, dans la peinture, la poésie…] l’idée de la pratique de l’interface culturelle conduit à créer quelque chose de personnel, résultante ponctuelle d’énergies provenant d’horizon divers. C’est l’énergie créatrice qui peut être métisse, pas la création. – Je rêve de ne plus voir dans des expositions des œuvres se targuant d’être la manifestation d’une peinture métisse, et de fait reconnues comme telles, parce que l’artiste s’est contenté de coller sur sa toile un ou deux signes (masques, totems, et même pétroglyphes ) de la culture kanak, et ce sans que l’énergie multiple ne transpire.
Le sous-tendu n’est-il pas alors d’acquérir ainsi une légitimité? Le métissage en tant que légitimité, non-merci! Encore une exclusion! Je préfère vivre mes aller-retour, parfois incertains, parfois constructifs, dans ce front, ce lime, de l’interface culturelle. Je n’ai ni la prétention ni le désir d’acquérir un tertre ou un clan par ma création littéraire. La légitimité, si tant est qu’il en soit besoin, […] ne s’acquiert pas par des actes spectaculaires mais par un vécu qui échappe à toute analyse, mais qui n’échappe pas au cœur de l’Autre, mon interlocuteur, celui-là avec qui je veux construire une nation. […]
Ce que je rejette ce n’est pas l’idée du Métissage culturel – ce serait folie et ignorance de ma part – mais c’est le fait qu’en Nouvelle Calédonie les pouvoirs politique, administratif et culturel, s’emparent de cette notion, de cette possible réalité future, et présente le Métissage culturel calédonien, non seulement comme un fait accompli mais surtout comme un désir exprimé et totalement partagé par tous les habitants du pays. C’est un peu tôt pour la Nouvelle Calédonie. Nous ne sommes qu’au début de la rencontre véritable entre communautés libres, nous commençons tout juste à nous adresser des regards francs et ouverts les uns vers les autres. C’est pourquoi je préfère l’idée et la pratique de l’Interface Culturelle, il y a moins de risque d’y voir se perdre l’espoir d’une amitié véritable et constructive. »
« J’ai le sentiment d’évoluer dans un lieu d’emprunts, de rencontres, d’affrontements, d’amitiés, d’amour et de rejets. Un espace qui est celui d’une page blanche, d’une scène de théâtre ou de danse, une voie où deux ou davantage de cultures se donnent rendez-vous. » Good Night Friend peut se lire comme l’illustration de cette phrase qui nous dévoile la pensée de Nicolas Kurtovitch et nous éclaire sur le regard qu’il porte sur le monde. Le roman est le miroir de la société calédonienne, il est le miroir du monde ; son titre est un plaidoyer : « C’est pourquoi je préfère l’idée et la pratique de l’Interface Culturelle, il y a moins de risque d’y voir se perdre l’espoir d’une amitié véritable et constructive. »
Le roman est le miroir de la société selon la théorie qu’en élabore l’auteur, mais il est également en lui-même une interface culturelle, « une surface placée entre deux portions de matières ou d’espaces » , une surface entre l’art et la géographie humaine, un « lieu entre deux systèmes, deux organisations », un « dispositif destiné à assurer la connexion entre deux systèmes », un dispositif mis en place pour que les personnages se rencontrent, entrent en relation tant bien que mal, un dispositif entre les personnages issus d’univers culturels très divers leur permettant des échanges.
Il est intéressant également de noter que si le roman est à l’image du monde, le monde s’offre à lire pour l’écrivain comme un roman. Ce qui appartient au sens propre à la littérature (la page blanche, la page sur laquelle rien n’est encore inscrit), est entendu au sens figuré en sociologie : j’ai l’impression d’évoluer, dit l’auteur, dans « (un) espace qui est celui d’une page blanche, d’une scène de théâtre ou de danse, une voie où deux ou davantage de cultures se donnent rendez-vous. » Nous y reviendrons dans la troisième partie de notre étude : l’art et la réalité entretiennent des rapports étroits et complexes.
Cette notion dense d’interface culturelle devient donc un projet esthétique, un objet littéraire ; elle façonne et structure le roman où des voix multiples, toutes authentiques, s’élèvent, se croisent et s’entrecroisent, ou au contraire se fragmentent, résonnent côte à côte sans se mélanger. Pour l’écrivain, le roman réalise la rencontre avec l’autre. Prendre conscience qu’il existe en Calédonie une interface culturelle, c’est reconnaître « que nous existons dans un espace aux frontières par bonheur imprécises, où se rencontrent et s’enrichissent les cultures océaniennes et occidentales. » L’espace est aussi un « espace mental », la géographie ouvre à la philosophie. Ysabelle Martineau le dit d’une manière définitive lorsqu’elle écrit que la rencontre avec « l’Autre » est centrale dans l’œuvre :
« Centrale au point de vue thématique, car il est très souvent question de rencontre avec un autre espace, avec un être venant d’un autre monde et permettant à l’imaginaire de l’auteur d’appréhender ce nouvel espace psychique et culturel qu’est l’Autre. Chaque rencontre avec l’Autre est en fait porteuse de la promesse d’une ouverture de la pensée; le narrateur ou le personnage principal est toujours prêt à recevoir l’influx momentané de ce petit univers qu’est l’Autre dans son espace personnel, où l’on a créé assez de vide, assez de respiration, pour pouvoir l’accueillir. C’est ce que Nicolas Kurtovitch exprime lorsqu’il écrit:
Osons l’ignorance et le vide
La disponibilité
Que la parole fasse son chemin
De l’esprit et du coeur
(«Éditorial» Encre marine 1)
La rencontre avec l’Autre est également centrale au point de vue formel, puisque Kurtovitch l’exprime par le biais du narrateur, ou plutôt des narrateurs, puisque l’écriture se fait généralement sous la forme de narrations enchâssées, en faisant prendre à ces narrateurs des identités étonnantes, et par le biais de la focalisation. C’est par la focalisation, tantôt interne, tantôt zéro, qu’il réussit à imaginer, avec une extraordinaire empathie, ce que vivent Kanak, Aborigènes, Caldoches, hommes, femmes, jeunes, vieux qui pourraient être de partout, qui se rejoignent par leur quête, l’universel humain. »
Mais l’ouverture à l’autre est ambivalente. Cette rencontre avec l’autre, ce parcours dans son espace intime, suppose une réelle connaissance de soi. D’une part, l’autre peut permettre à un personnage de mieux comprendre le monde, d’avancer sans se tromper ; ainsi en est-il dans Good Night Friend de la rencontre entre Manuel et « le gars du squat », ou dans Astral Weeks de la lecture par Manuel du journal de Moueaou. Mais d’autre part, c’est en cherchant au fond de soi, aux « sources de son expérience » que l’on peut comprendre l’autre, prendre avec soi son « espace psychique et culturel ». C’est alors un autre pan de l’œuvre qui se dévoile, un autre aspect qui se révèle à nous. La rencontre avec l’autre est indissociable d’une rencontre avec soi. Or, les différents points de vue adoptés dans le roman engendrent tantôt une fragmentation des univers, tantôt une adéquation avec l’autre. Il en va de même pour ce qui est de soi, entité tantôt fragmentée, tantôt unifiée. C’est là, ce me semble, un aspect de l’œuvre de Nicolas Kurtovitch qui n’a pas encore été suffisamment mise en lumière. Certes, le narrateur adopte tous les points de vue, même lorsqu’ils se fragmentent, rendant compte ainsi de la notion d’interface culturelle et posant le roman comme lieu d’échange et de partage. Mais ce « je » dont il est sans cesse question est aussi parfois un espace morcelé, un lieu fragmenté, parce que fragmentaire. La fragmentation, autant que la rencontre, est un thème de l’œuvre. Léa, par exemple, se cherche, elle parle de la partie claire de sa vie et du reste ; elle demande à son père son nom d’origine pour se connaître, elle s’adresse à l’autre (son père) pour se ressaisir, s’approprier son identité. Or, Nicolas Kurtovitch interroge son père, cet absent, ce gouffre de silence, cet abîme, pour trouver un équilibre rendu instable par la mort. Nous aborderons ce thème à l’issue de cette étude lorsque nous étudierons le personnage du père.
Fragmentés, les personnages le sont aussi d’un point de vue esthétique, du point de vue de la création romanesque. En effet, de Good Night Friend à Astral Weeks les noms des personnages sont demeurés, pour la plupart, inchangés : d’un roman à l’autre, l’auteur a voulu « proposer une autre vie aux mêmes gens ». Telle est la pensée de l’auteur : nous vivons ce que nous vivons parce que nous avons fait des choix, mais nos aventures auraient pu être tout autres si nous avions fait des choix différents. Les romans de Nicolas Kurtovitch, Good Night Friend, Astral Weeks et un roman à venir, sont le laboratoire de cette pensée érigée au rang de théorie littéraire. Or, force est de constater le rapport étroit qu’entretiennent à nouveau littérature et réalité : si les personnages des romans sont fictifs, certains prénoms sont ceux de personnes réelles que connaît Nicolas Kurtovitch. Par exemple, son fils s’appelle Jonathan et il a pour ami dans la vie Théo, un acteur qui a joué dans les pièces de Nicolas Kurtovitch , Manuel est un ami poète, Léa était une élève de Do Kamo, championne du monde de va’a. Les aventures qui sont les leurs dans les romans n’ont aucun point commun avec la réalité, les romans ne sont pas des biographies. Mais si une personne s’efface dans la vie de Nicolas Kurtovitch, alors son prénom aussi s’efface d’un roman à l’autre . Les romans s’organisent donc autant autour du thème structurant de la rencontre avec l’autre que du thème de l’identité fragmentée, qui cherche à la fois son unité dans la connaissance de l’autre et dans la reconnaissance de la multiplicité des expériences qu’elle aurait pu vivre. « Je voudrais faire ressentir que ce que nous vivons n’est qu’une des vie qu’on aurait pu vivre, dit l’auteur. Le prénom a une autre vie » . Le prénom, c’est ce qui reste de l’individu, cette trace de ce qu’il est, cette « ombre » qui dit une autre vérité et qui appartient à l’art.
Il convient désormais d’étudier la rencontre avec l’autre, cet ami proclamé par le titre.
b- Amitié ou fraternité ?
Depuis le début de cette étude, nous employons les mots amitié et fraternité comme s’ils avaient été l’équivalent l’un de l’autre. Cela tient aux traductions possibles du titre. « Good night friend » peut-être traduit par : “bonne nuit l’ami”, ou “bonsoir, mon frère” ; cette dernière traduction est infidèle au mot « friend », mais elle s’inscrit dans son champ lexical. En effet, les amis s’appellent entre eux « frères », ils sont frères par métaphore, le mot est synonyme d’ami, de semblable, ce frère-là est notre égal. Par ailleurs, force est de constater que le roman entretient cette ambiguïté. En effet, les personnages principaux sont amis, Manuel est l’ami de Moueaou (« je cherche un ami », dit-il p.95), Léa est l’amie de Camille, Camille est l’amie de Manuel, sa compagne. Le lien d’amitié se noue autour du lien familial. Manuel et Moueaou sont frères, peut-être certes, « pas vraiment » frères, mais peu s’en faut ; ils sont de la même famille :
« Presque par hasard, Manuel a renoué les liens ; une mère, un père, pas vraiment sa mère ni son père, mais une famille qui a été la sienne, pendant quelques années, il y a longtemps » (remarque que l’on peut attribuer au narrateur omniscient, très discret, car les focalisations internes sont dans le roman à la première personne du singulier, Manuel n’avait sans doute aucune raison de penser à son passé à ce moment du texte ; cependant, il est vrai que l’identification des narrateurs est parfois vertigineuse, p.7).
« Elle lui parle de Manuel et je lui rappelle comment son père s’est occupé de lui comme d’un fils pendant les quelques années qu’il est resté à la maison. Il l’emmenait avec lui, dans la forêt, à la pêche, aux cérémonies, partout, Moueaou suivait. Ces deux-là, inséparables jusqu’à ce que Manuel s’en aille chez une parente » (discours indirect et pensée de Dila, la mère, p.32).
« C’est à ce moment, seulement à ce moment très précis, que j’ai ressenti et compris le lien surprenant qui les unit. Il n’a pas eu besoin de parler, il n’a dit bonjour à personne, seuls maman et lui existaient. Sept ans, je l’ai appris plus tard, sept ans durant lesquels il avait vécu à la maison, avant que je naisse, avec Moueaou, quand Léa était petite » (pensée de Théo, p.108).
Les personnages principaux sont donc amis, et dans le même temps frères et sœurs. Dila ne reçoit pas ce qualificatif, mais elle accueille Camille comme une amie ; le père, dans sa prison, est entouré d’amis, mais il est aussi traqué par son ennemi. Théo et Johanna ont des amis. Good Night Friend rassemble ainsi des amis, des frères et des sœurs. Les mots frère et sœur rendent compte, au sens propre, de liens familiaux, mais aussi au sens figuré de liens d’amitié. Relisons l’article « Frère » proposé par le Dictionnaire Historique de la langue française :
« La complexité de la construction et de l’évolution du vocabulaire de la parenté explique les diverses acceptions du mot frère en français. Celui-ci désigne une personne de sexe masculin par rapport aux enfants de mêmes parents (XIIIe s., frères germains) ; dans le cas du même père (XIVe s., frère consanguin) ou de la même mère seulement (mil. XVe s., frère utérin), on dit plutôt demi-frère. De cette acception viennent ressembler à qqn comme un frère, vivre comme des frères ; par extension, frère de lait (1538) se dit du fils d’une nourrice par rapport à celui (ou à celle) qu’elle a nourri. ◊ Depuis l’ancien français (v.1050), le mot se dit de l’homme en tant que membre de la « famille » humaine, en particulier en religion (1690), en parlant des hommes en tant que créatures du même dieu. Spécialement frère désigne (v.1175) les membres de certaines communautés religieuses et est le nom que se donnent les francs-maçons (1764). Par extension frères au pluriel se dit, comme en latin, de l’homme par rapport à ceux qui partagent les mêmes sentiments, intérêts, etc. ; frères d’armes a désigné (mil. XVe s.) des guerriers unis entre eux par des alliances et s’applique aujourd’hui à ceux qui luttent pour la même cause, aux membres d’une association, etc. »
Le « mot se dit de l’homme en tant que membre de la « famille » humaine », au pluriel le mot désigne « ceux qui partagent les mêmes sentiments, intérêts ». Les personnages principaux, qui sont tous singuliers, partagent en effet les mêmes sentiments parce qu’ils sont unis et solidaires devant le drame qui les frappe, ils partagent des espaces communs (la cuisine de Dila), ils ont des centres d’intérêt communs (le va’a de Léa ou l’opéra de Théo), ils appartiennent à la même famille ; ils s’entendent bien, mais surtout ils s’écoutent. Ils partagent, au sens premier du verbe, leurs sentiments : ils se confient les uns aux autres afin que ce qu’ils pensent ou que ce qu’ils ont vécu soit connu de l’autre personnage, à la fois frère, ami et confident. Ainsi Léa se confie-t-elle à Théo, par exemple, ou Moueaou à Manuel, qui le comprend. Leurs sentiments, pensées et opinions sont donnés en partage dans le roman, mais il demeure que celui qui peut tout savoir des consciences est le romancier, qui écoute ses amis et offre leur monde intérieur en partage aux lecteurs.
A cet égard, le romancier est bien une figure omnisciente, au sens théologique du terme : cette métaphore est filée dans le roman, portée par le personnage de Théo, soutenue par les propos de Dila. Dila prépare deux gâteaux, un pour Léa et un pour le temple –on se souviendra que sa famille est le temple de Dila, et que par conséquent ces deux gâteaux, issus d’une même pâte, sont destinés à une même entité, la famille temple. Tout dans le roman, même les plus infimes détails, même ce qu’il y a de moins romanesque, en apparence, et qui se confond avec le quotidien le plus banal, contribue à filer la métaphore de la famille humaine posée sous le regard de dieu. Mais ce dieu n’a sans doute pas tant une dimension spirituelle qu’une efficace définition littéraire : le romancier est un dieu, le dieu créateur de son œuvre, le monde du roman, il connaît toutes les consciences. Dila l’affirme dans ce propos théologique, mais le lecteur offre à ce dernier une interprétation esthétique. Elle réfute l’expression de « Dieu le père » et s’en explique :
« Les pasteurs parlent toujours de Dieu le père, de son Fils et de nous. Pour moi Jésus est un frère, je pense à lui comme on pense à un frère. Je ne sais pas si je prie comme il faut, je parle plutôt avec lui. Un frère, c’est important »
p.31.
Notons l’usage de la minuscule, qui confère à ce frère le statut de nom commun, commun à tous les hommes. Il n’est pas une puissance tutélaire, il est proche de Dila, proche par ce qui s’exprime dans le roman : le frère est celui qui écoute les hommes, les reconnais comme ses frères. Good Night Friend porte l’éloge du frère. Le frère est l’ami, l’amitié se conjugue en amour. Good Night Friend emprunte la voie, et la voix, de la bible, mais sans donner au livre qu’il est une dimension spirituelle ; il s’agit d’esthétique, d’art romanesque, de métaphores qui posent le romancier en frère des hommes : il est leur égal, il les écoute et, plus étonnant, il leur parle. Ecoutons encore le propos de Dila :
« J’aime l’idée d’un grand frère sur l’épaule de qui je peux laisser reposer mes cheveux. Simplement quelqu’un de sûr dans son amour et dans son amitié. Seul un frère peut conjuguer l’amour et l’amitié, être présent toujours et ne pas être importun. J’aime sa présence discrète, silencieuse, si forte pourtant. Souvent je ferme les yeux une petite seconde, vous ne vous en rendez pas compte, c’est pour être en contact avec lui, et il répond présent. Tu vas me croire folle Léa, mais crois-moi, je l’entends me parler en ce moment. (…)
– Papa ?
– Non, ton père ne peut pas être ce frère. Quel humain pourrait avoir une telle disponibilité ? Les pasteurs aiment à nous le présenter comme hors de portée, inabordable, j’ai toujours refusé cette présentation. Pour moi, il est très vite devenu un être proche. Avec lui il n’est pas question de pardon mais de conscience (…) »
pp.31-32.
Comme d’autres personnages, Dila entre dans la conscience, dans l’âme de sa fille, elle lit en elle, prenant la place du narrateur omniscient :
« Léa en écoutant (la « musique familière et familiale ») devine mon humeur. Son âme prend refuge dans les bruits familiers et rassurants de la cuisine, elle se vide et se laisse pénétrer par le quotidien, les gestes simples de tous les jours, les bruits de l’appartement, ceux qui font la vie. L’espace est petit, à peine quatre pièces, et pourtant l’amour qu’il suscite est sans limite. Alors je me surprends à aimer tout ce qui vit en Léa et autour de Léa, jusqu’à la prison qui abrite son père »
pp.29-30.
Il est étonnant de voir Dila présenter son propos comme une digression, un aveu étrange qui ferait penser à Léa qu’elle est folle. Léa souligne ce manque de cohérence dans son discours et l’interroge : « Pourquoi me parles-tu de Jésus maintenant ? » demande-t-elle p.31. Cependant, cette digression, ce détour, est semblable au détour révélateur du jeune homme du Vanuatu : il nous apprend, à nous lecteur, ce qu’est un frère transposé en principe esthétique d’une œuvre romanesque. Ainsi donc est-il clairement énoncé que le frère est lié à une problématique de la conscience. Mais quelle est la signification de cette « conscience » ? Faut-il comprendre que les personnages prennent conscience de quelque chose –et que serait alors ce quelque chose ? Ou faut-il comprendre que le frère est celui qui connaît les consciences, les pénètre et les met en partage ?
c- Des points de vue multiples :
La narration est tantôt à la troisième personne du singulier il ou elle, tantôt à la première personne, je. Le récit se construit en passant constamment d’une personne à l’autre, d’une personne grammaticale à l’autre et d’un personnage à l’autre. Le procédé pourrait faire songer au roman épistolaire, mais la structure du roman par lettres est plus rigide. Dans Good Night Friend, le récit pris en charge par un personnage peut être interrompu par la réaction d’un autre personnage, ou une intervention du narrateur omniscient. Le procédé, très artistique, profondément esthétique, fait alors songer au cinéma. Que l’on se souvienne des Ailes du Désir de Wim Wenders ; un ange marche dans Berlin et traverse la conscience des gens qu’il croise, il écoute le propos intérieur de chacun, et ces discours intérieurs s’énoncent tout logiquement à la première personne du singulier. Le spectateur, qui adopte le point de vue de l’ange, partage ces mondes intérieurs. Good Night Friend adopte une construction semblable. Le lecteur se promène parmi les consciences des personnages, ce qu’ils disent devient le lieu de sa lecture, de son cheminement dans le roman. Un lien s’établit donc entre tous ses discours, mais ce lien respectueux, fraternel et cette connivence avec chacun, ne peuvent être établis par les personnages dont les récits parfois se croisent et s’entremêlent, parfois se jouxtent. C’est une instance narrative supérieure qui relie l’ensemble de ces récits. Tout se passe en fait comme si cette unité, ce compagnonnage, ce dialogue entre tous les personnages, ce partage, le plus profond, cette rencontre avec l’autre, ne pouvait avoir lieu finalement qu’à un seul niveau de lecture, celui, précisément, de l’auteur et du lecteur.
Un passage du texte est à cet égard caractéristique. Il est l’antithèse du partage. Léa est venue trouver Quentin, le directeur de la prison, pour lui demander « une faveur », l’autorisation de voir son père hors des jours de visite. Un espace est commun, le bureau du directeur, mais la juxtaposition des points de vue dramatise le lien social, ce face à face sans réel échange, sans partage. L’opposition caricaturale des deux mondes (la France et l’ici, le pays des Noirs) confère au passage un aspect humoristique, satirique presque, parce qu’il joue sur des stéréotypes. Le lecteur est d’abord plongé dans la pensée du directeur, plus pathétique qu’effaryant. Puis la narration se poursuit par une autre focalisation interne, Léa réagit avec vigueur à la mise en scène de Quentin. Les personnages, qui se parlent, ne communiquent pas. Ils restent face à face et les points de vue dans le récit sont juxtaposés, ce qui traduit une absence de communication, et donc de communion entre les personnages, même s’ils essaient d’imaginer ce que peut ressentir l’autre. Nous citons le texte par extraits :
« – Vous me demandez une faveur, le savez-vous ? Evidemment vous le savez, sinon, vous ne seriez pas là.
Elle est assise sur le bord de la chaise, elle n’a pas voulu utiliser le fauteuil parce qu’elle est persuadée que l’entretien ne durera pas longtemps. Quelques minutes sur cette chaise à écouter le discours du directeur, et elle s’en ira voir son père, elle en est convaincue, c’est ce qui la rend pour l’instant très patiente. On verra la suite.
– Nulle part en France, vous n’auriez osé formuler une telle demande. La règle est, là-bas, la règle ; la même pour tous. C’est dur, mais c’est ainsi. Enfin, nous sommes à Nouméa et la règle doit souffrir quelques exceptions, je suppose, non ?
– Pourquoi pas, ose-t-elle me répondre.
C’est un Français se dit Léa, il n’est là que depuis quelques mois, il n’a pas eu le temps de s’acclimater, mais c’est maintenant que j’ai besoin d’une exception, pas dans trois mois.(…)
– Je vous sers un verre de citronnade ?
– Non merci. Vous êtes gentil, mais mon père ?
– Vous le verrez, ne vous inquiétez pas. Savez-vous que la citronnade est l’une des boissons les plus rafraîchissantes par ce temps ? Certains pensent et disent que c’est le sirop de menthe additionné d’eau fraîche, je ne suis pas d’accord. Ce qui est important dans la citronnade, c’est de ne pas se tromper de dose de sucre (…), c’est presque un art.
Un art, va plutôt te faire foutre. Va au diable avec ta citronnade et ta menthe à l’eau, ducon ! Tes prisonniers, ils ont de la citronnade à boire ? (…)
– Comme je vous le disais, en France vous n’auriez rien obtenu. Mais nous sommes ici, et il y a vous, les gens d’ici, les Noirs et les autres, alors je m’adapte (…).
Je vais continuer encore un peu sur ce ton histoire de la faire mariner, qu’elle sente qui est le maître. Ensuite je lui accorderai sa visite supplémentaire. (…) Je la sens bien là, elle doit vouloir me renter dedans après mon exposé sur la citronnade, quelle connerie ! Mais elle n’ose pas. Eh non ! C’est amusant ce petit jeu, on s’ennuie tellement ici.
– Vous n’êtes rien, vous n’avez pas de recommandation.
Il ne me regarde même pas. Il débite son texte, simplement pour passer son temps et me faire peur » (pp. 35-37)
Comme au théâtre où le dialogue est ponctué d’apartés, le discours des personnages est ponctué de commentaires, au style direct également, en focalisation interne. Le présent est le temps qui rend compte de cette connivence qu’entretient le lecteur avec le personnage au moment où ce dernier formule sa pensée. Mais comme au théâtre, le seul qui puisse tout savoir est le lecteur, le spectateur des ces scènes. Même si Léa comprend bien le jeu du directeur, même si le directeur imagine justement la colère de Léa, ils sont antagonistes. Le mot « maître » est en ce sens révélateur : Quentin, comme plus tard les agresseurs de Léa, veut la soumettre, la dominer, attitude dénoncée et condamnée dans le roman. Par contre, le narrateur, celui qui organise le récit, écoute tour à tour la pensée de chaque personnage ; celui que l’on veut confondre avec l’auteur a recueilli tous ces propos pour élaborer le roman. Il les a liés, reliés (comme le livre est relié finalement). Il est, à l’image de ses personnages qui marchent, celui qui a habité « le monde dans son universalité, dans un contact intuitif » et qui a « rencontré l’humain », pour reprendre les mots de Luc Baranger. La technique narrative adoptée dans le roman, celle des points de vue multiples ou « points de vue tournants », selon l’expression de Dominique Jouve, permet de fraterniser avec les hommes (les personnages qui sont si poches des personnes, de leurs modèles dans la réalité que le roman veut concurrencer). Cette technique permet de les peindre tels qu’ils sont, dans ce qu’ils ont de meilleur ou de pire.
« Nous découvrons l’histoire et les sentiments des personnages en partageant un instant de la vie intérieure de Léa, de Manuel, de Théo, du père, du directeur de la prison… cette radicale mutation par la technique des points de vue marque bien que le chemin de la compassion, seule voie de la fraternité pour l’auteur, est une affaire personnelle et qu’il y a des voies différentes, toutes authentiques » .
La juxtaposition des points de vue crée une juxtaposition des univers ; selon Dominique Jouve, chaque personnage trouve son chemin de la compassion. Il convient d’ajouter que seul le narrateur omniscient, qui est un visage du romancier, y parvient en peignant chaque membre de la « famille humaine », en entrant en chaque conscience comme dieu en chaque âme –l’image est traditionnelle en littérature. Il ne s’agit pas bien évidemment d’une théologie (quoiqu’un personnage se nomme Théo, comme si dans l’ensemble des jeux d’échos et de mise en abîme il y eut ici un clin d’œil du romancier). Toutes les pensées nous deviennent familières. Cet espace inscrit sur la page, l’espace où s’écrit la pensée, est le véritable lieu de la communication entre une instance narrative supérieure (l’auteur, et par conséquent, nous, les lecteurs) et les personnages. Par un jeu troublant du rapport entre réel et fiction, l’auteur a laissé parler librement ses amis, et d’autres, ces personnages qui voudraient tant concurrencer le réel pour devenir des personnes. Lorsque Nicolas Kurtovitch parle d’amis, c’est souvent pour convoquer dans sa voix le propos des autres, pour les invoquer et inscrire sur sa page leurs paroles . Sa voix est la voie de la fraternité, de l’énoncé du point de vue de l’autre, cet inconnu qui s’abolit en tant que tel dès lors qu’il est accueilli dans la voix du narrateur, que son propos est recueilli dans un ouvrage : dans un recueil précisément. Toute l’esthétique de l’œuvre de Nicolas Kurtovitch se cache et se révèle dans ce jeu d’échos : une voix, une instance narrative, attend ses amis, les accueille en un lieu –ce lieu singulier qu’est le livre- met en partage leurs points de vue qu’elle inscrit dans le recueil. Ce recueil de voix multiples, cette polyphonie qui crée le chant du monde, est le lieu des rencontres les plus improbables, de l’émergence du monde et de cette rencontre avec l’humain. La fraternité célébrée n’a pas tant lieu entre les personnages qu’entre un narrateur omniscient (l’auteur peut-être, à moins que ce ne soit son masque , puis le lecteur après lui) et les personnages.
« La poésie de Kurtovitch lie une émotion à une pensée et n’a pas peur de quitter la peau du blanc pour rentrer dans celle de l’homme universel. »
Ainsi Jean-Claude Bourdais commente-t-il la poésie de Nicolas Kurtovitch. Dans son premier roman, grâce aux points de vue multiples, l’auteur confère à ce principe esthétique un aspect renouvelé.
d- Des mises en abîme : le récit de Léa.
Qu’un instant de la conscience ou le propos d’un personnage soit donné en partage aux lecteurs est un procédé qui se trouve inscrit dans l’œuvre par un jeu vertigineux de mise en abîme. De même que le narrateur omniscient connaît les pensées des personnages, il y a des moments dans le roman où un personnage imagine ce que pense un autre personnage, à moins que ce ne soit les pensées de l’un et de l’autre qui ne s’enchevêtrent. Les pistes sont volontairement brouillées et, à certains moments du texte, il me semble qu’il est impossible de savoir qui est l’énonciateur d’un propos. Or, c’est précisément par ces récits dans le récit, ces pensées d’un personnage inscrites dans la pensée d’un autre, ces propos tenus par un personnage et reformulés par un autre, que s’offre à voir, comme dans un miroir, le principe esthétique à l’œuvre dans le roman où les pensées sont en partage.
Nous voudrions citer ici pour exemple le récit de Léa, des pages 61-79.
« Papa, lors des promenades, une fois que le gardien autorise ses pensionnaires à cesser de marcher en cercle, se dirige vers un endroit de la cours d’où on peut apercevoir la mer et, entourant Nouméa, les montagnes souvent couvertes de nuages pluvieux alors que sur la ville ne stagne qu’une nappe d’humidité inconfortable » p.61.
Comment Léa sait-elle ce que voit son père ? Soit elle l’a vu elle-même lors de ses visites à la prison, soit son père se confie à elle lors des brefs moments où elle peut le voir. Apparemment, la question semble être de peu d’importance. Mais elle gagne en densité dans la suite du récit. Il semble en effet que Léa s’approprie la pensée de son père, elle le pense, elle l’écrit, comme un romancier pense, écrit, modèle, façonne, son personnage. Elle entre dans ses pensées. Dès lors, sont-ce les pensées et les gestes du père qui s’inscrivent sur la page, ou sont-ce les pensées de Léa qui imagine, pour résister à la douleur de cette séparation qu’elle refuse, ce qu’est son père, ce qu’il fait, comment il se tient et plus important : ce qu’il pense ? Les portraits du père les plus intimes, les plus respectueux, les plus aimants, sont brossés par Léa :
« Léa vient me réveiller au salon où je dors pour me raconter ce qui n’a pas pu être dit devant maman ; le visage de papa, les rides qui se sont multipliées, les yeux de plus en plus profondément enfouis dans les orbites, avec les arcades sourcilières presque trop proéminentes. Les tensions de la peau sur les petits os du visage, les crispations de tout son corps lorsqu’elle évoque ce que nous, les deux « petits » nous vivons chaque jour. Je sais le corps fatigué de papa, ce corps qui n’est plus le sien, qui n’est plus celui qu’on a aimé, dehors » (récit de Théo, p.55-56).
Léa s’approprie son père. Au-delà même des descriptions physiques qu’elle en fait, elle pense sa vie intérieure :
« Il se parle à lui-même. Pour se donner du courage, pour ne pas devenir fou, pour y voir un peu plus clair dans sa situation, dans ses propres doutes, dans ceux de maman. Le sol de la cour est en terre battue, avec un peu de sable par-dessus, du sable jadis blanc, sali par le frottement quotidien des souliers. Il s’assoit parfois au pied du seul arbre de la cour.
« Cette maison est carrée, tout en pierres et en angles droits. Comment peut-on y vivre ? Comment y être heureux, même si ce n’était pas une prison ? Nous avons nous aussi, dans nos montagnes, des maisons carrées, mais elles ne sont pas aussi rigides, pas aussi vides ! Mais celles-là !(…) Quand je sortirai d’ici, je partirai de Nouméa, je retournerai d’où je viens. Je retrouverai le chemin de la case, de la pelouse devant la case, je trouverai aussi la route des champs et de la forêt. »
Il s’est échappé, il est retourné dans la tribu de son enfance. Vision de beauté et de douceur » (pp.61-62)
Léa dit : « Il se parle à lui-même », le discours du père est annoncé, puis les guillemets sont utilisés. Or, lorsque s’opère un changement de narrateur, l’auteur habituellement n’emploie pas les guillemets, comme nous l’avons remarqué lors de l’opposition de Léa et du directeur de la prison. Est-ce à dire que Léa cite les propos de son père, qu’elle les restitue ? Il se peut qu’elle se les imagine aussi. La tribu de l’enfance du père n’est-elle pas ce qu’elle recherche ? Dans sa reconstitution, Léa opposerait l’espace carcéral, clos, agressif, à la tribu, ouverte sur les champs et la forêt, c’est elle qui emprunte ces chemins qu’elle invente, fantasme, afin de trouver « l’autre pays » où le sable est toujours blanc, où la souillure de la rupture n’existe pas. Elle invente à son père un espace de liberté, parce qu’elle devine qu’il en rêve, parce qu’elle-même a besoin de retrouver une terre originelle, parce qu’elle est la fille du lien. Le texte, au sens étymologique : « ce qui est tissé », se poursuit ainsi, par un commentaire de Léa qui enchevêtre dans sa pensée l’image qu’elle a créé de son père :
« Vision de beauté et de douceur. Redevenu petit enfant courant presque nu autour des cases, dans la brousse, sautant de rocher en rocher au bord de la rivière, celui qui chante avec les tourterelles. Il s’arrête, essoufflé, au bord de la cascade, il entend le corbeau se moquer de lui » (p.62)
N’est-ce pas Léa qui a besoin de se dépouiller de ce qui l’entrave, de cet oripeau de nom qui n’est pas le sien pour remonter aux sources de ses origines, pour remonter le temps et l’abolir en retrouvant son nom, le vrai, « l’autre d’avant » ? N’est-ce pas elle encore qui a besoin, par amour, de faire tomber les murs de la prison afin d’en libérer son père, de lutter contre la mort qui progresse en lui chaque jour dans cet univers qui détruit les hommes ? Elle le fait s’évader et survivre :
« J’ai ce retour dans mon cœur et dans mon esprit » (p.62).
La phrase est ambiguë ; le père peut l’avoir prononcée, certes, mais on le sait si abattu déjà. Ce retour, pour le père, n’est peut-être que l’énoncé du désir de Léa. Elle souhaite trouver le pays de son père, pays qu’elle n’a jamais connu.
« Grâce à ça je vais survivre dans cette prison » (p.62).
« Grâce à ça », Léa survit. Elle survit à la prison qu’elle deviendrait, si elle s’enfermait en elle-même, si elle ne pensait pas à son père, si elle ne pensait pas son père. Elle survit à la séparation qu’elle ne peut supporter et dont elle veut s’affranchir : elle veut devenir libre, elle aussi, entendre le chant des oiseaux même s’ils se moquent, et survivre à la douleur de la séparation et du non-dit, à la douleur de toutes les ruptures qui hurlent en elle.
Ainsi la mise en abîme confère-t-elle à ce texte toute sa profondeur et sa beauté. Au creux des pensées de Léa se love le portrait de son père, au cœur de ses paroles s’inscrivent les paroles de son père ; point de retour, si ce n’est vers la prison ; elle fait le tour de son monde « dans (son) cœur et dans (son) esprit ». Léa établit ce lien, comme le romancier qui imagine et écrit la pensée de ses personnages.
Le père de Léa est sa source d’inspiration : « La rivière a quitté la petite vallée et me rejoint ici » (p.62). Cependant, sitôt énoncée, cette hypothèse de lecture est mise à mal par les phrases qui suivent :
« Et je te dis que oui, notre nom n’était pas celui-là, à l’époque de mon grand-père. Il a oublié notre nom le jour où il est parti, chassé de chez lui par ses propres frères parce qu’il s’était vendu aux blancs. Il est parti et en chemin il a ramassé un autre nom » (p.63).
Léa a-t-elle appris cette information en poursuivant ses recherches, à l’insu du lecteur ? La remarque semble peu judicieuse. Léa invente-t-elle cette réponse afin de combler le vide qui la hante ? Ou faut-il croire que ce n’était pas elle qui prenait en charge la pensée de son père comme nous avions voulu le croire jusqu’alors ? Dans cette dernière hypothèse, les pensées de Léa et du père seraient alors juxtaposées, et il n’y aurait pas non plus de communication entre ces deux personnages, le père refusant à sa fille la réponse qu’elle attend. Pourquoi alors ces guillemets que l’on n’emploie que lorsqu’on « fait parler » un personnage ? Le doute subsiste. La fin du chapitre pourtant affirme que Léa imagine les gestes et les propos de son père :
« Papa n’est plus près du mur, il fait quelques pas tout en lisant et s’en prend à Moueaou, j’en suis certaine : « Cet imbécile, où est-il ? Mais où il est, pour une fois que j’ai besoin de lui. Il abandonne Léa dans ce merdier. Je vais sortir, je vais sortir. » Il a cessé de lire, secoue les feuillets et regarde, sans le voir, le sol de la cour avant de reprendre la lecture de ma lettre » (p.76)
Il semble peut pertinent de chercher à résoudre le doute qui s’immisce dans l’œuvre : tantôt Léa met en scène son père dans son propre discours, tantôt s’énonce des informations nouvelles qui semblent inconnues à Léa et qui confère son autonomie au discours du père, ainsi lorsque le père évoque la présence du fils du sorcier dans la prison. Ce qui importe au romancier, c’est de mettre en lumière son propre travail. Il « fait parler » ses personnages, qui peut-être parfois lui échappent et vivent d’une vie autonome dans la fiction romanesque. Ce paradoxe pose et expose la modernité du roman. Mais rien n’est moins sûr cependant ; il se peut que Léa invente les informations qui lui manquent, il se peut que Théo, qui redit ce qu’a dit Léa, divulgue les informations qui lui ont été données plus tard, dans la chronologie distendue du roman. L’enchâssement de récit dans le récit crée un gouffre vertigineux, mais ce gouffre ne phagocyte pas le sens du texte : il le révèle tout au contraire, l’expose en creux en quelque sorte.
Les mises en abîme dans le roman sont multiples et complexes. En effet, Léa pense ce que pense son père, mais c’est Théo qui révèle ce que dit Léa. Théo, qui porte ce nom symbolique, est un autre double du romancier.
e- Les doubles de l’écrivain :
1- Théo :
Le récit de sa nuit d’errance que fait Léa est un récit complexe, puisqu’il inclut les réactions du père, puisqu’il se fait par lettre, une lettre qui passe sous silence la tentative de viol. Le récit est heurté, il progresse difficilement, à l’image de la voix de Léa qui ne s’élève que difficilement ; Léa révèle son aventure à son frère Théo et le récit, dès lors, se fait en de multiples fois, en plusieurs voix. Voici ce que dit Théo dans le chapitre qui précède :
« Léa me réveille et me parle. Elle me relate toute sa journée, me raconte son travail, ses entraînements, la fatigue de ses bras, la douleur de ses muscles et sa joie immense de glisser sur l’eau, me décrivant dans les détails ses moments en compagnie de Camille et de Manuel. Je suis comme son journal intime » (p.55)
Le présent : « Léa me réveille », est un présent d’habitude : habituellement, Léa réveille son petit frère et se confie à lui, comme en un journal intime, pour dire ce qu’elle n’a pas dit à sa mère : « Léa vient me réveiller au salon où je dors pour me raconter ce qui n’a pas pu être dit devant maman » (p.55). Suivent dans le chapitre des portraits, des instantanés de la vie de chacun organisés par l’humeur vagabonde de Théo, car ce soir-là où Léa est rentrée encore plus tard que d’habitude, Théo ne dort pas. La temporalité du roman va au plus près du réel : ce que dit Théo est énoncé le temps de sa veille, un peu comme si le temps de notre lecture se rapprochait le plus possible du temps de son attente, ou des instants qui précèdent immédiatement le retour de Léa. Le chapitre se clôt lorsque Léa rentre et que Théo comprend qu’il n’apprendra rien d’elle ce soir :
« Réveille-toi. Théo réveille-toi ! J’ai quelque chose à te raconter.
– Raconte, Léa, je suis réveillé ».
Elle n’a rien fait de tout ça. Elle s’est dirigée vers sa chambre. La porte s’est fermée et je n’ai pas pu me rendormir. Il ne s’est rien passé à la station d’essence, elle serait rentrée plus tôt et ne m’aurait pas ignoré. Ce n’est pas en relation avec papa, elle se serait également empressée de m’en faire part. Il s’agit de quelque chose de très personnel, d’intime » (p.59).
Ainsi le romancier ménage-t-il son suspens, en laissant un personnage envisager les différentes raisons du silence de Léa pour mieux les réfuter. Ainsi met-il en relief la difficile émergence de la parole. Le chapitre suivant est consacré à Léa. Il semble dans un premier temps que ce récit qu’elle a refusé à Théo soit offert au lecteur. Mais il n’en est rien ; un nouveau récit dans le récit, qui conduit à une nouvelle distorsion du temps, s’inscrit dans le chapitre. Il a fallu d’abord que Théo reconstitue toutes les pièces du puzzle de Léa avant que ce récit ne soit donné à lire, ou à entendre :
« Si Léa n’a pas tout écrit à papa, à moi, elle a fini par tout raconter, elle n’a rien omis, me racontant les odeurs et les bruits, ses propres frayeurs et ce qu’elle voyait dans le cerveau dégénéré de ces gens. Elle n’a pas tout raconté en une seule fois. L’ensemble est venu petit à petit, parfois elle m’en disait deux ou trois mots, d’autres fois, elle tenait la parole une heure durant, allongée sur mon lit (…) » (p.74).
Lorsque le chapitre commence, le lecteur peut très légitimement croire qu’il suit la pensée de Léa en focalisation interne :
« Papa, lors des promenades, une fois que le gardien autorise ses prisonniers à cesser de marcher en cercle, se dirige vers un endroit de la cours d’où on peut apercevoir la mer (…) »
p.61
Théo prend ensuite le relais dans la narration de l’histoire de Léa p.66. Il effectue un retour en arrière puisque l’évocation du père correspondait aussi au moment où ce dernier recevait la lettre de Léa. Dans cette lettre, Léa évoquait sa quête de Moueaou. Evocation sans doute incomplète que Théo révèle :
« Léa a changé de quartier. Il était déjà onze heures. »
Les récits s’enchevêtrent, la chronologie dans le roman se tord, se tend au maximum entre les personnages et les lieux, elle est le passé de Léa dans le squat, le présent du père en prison, le présent de Théo, toutes les fois où Léa est venue lui parler, la nuit, dans le salon. Rien n’interdit de penser que même les premières lignes de ce chapitre sont ce que Léa a dit à Théo, et que Théo dès lors, depuis le début, prenait en charge dans sa narration. N’oublions pas à cet égard que Théo, dans le projet initial de l’œuvre, devait être le narrateur exclusif du roman : « A l’origine, dans la première version du roman, le roman était entièrement rédigé, dit par Théo. Mais c’était difficile. La structure définitive du roman a été choisie parce que le projet initial ne fonctionnait pas correctement. » .
La lettre, comme le journal intime, font écho au texte écrit, au roman lui-même qui les comprend –les inscrit en lui. Tout se passe en fait comme si Théo était le romancier en attente de son inspiration, ou de la formule la plus juste qui lui permette d’écrire dans son roman ce qu’il réfute –la violence- et de l’écrire telle qu’elle est, avec ses heurts et ses chaos.
Etrange miroir que tend ici Théo au lecteur, car il est ensemble le romancier et le livre. Il est le livre, le journal intime, mais il est aussi une autre image du romancier, comme Léa également, puisqu’il mêle sa voix à celle de Léa, il rassemble ses propos, il les met en forme. Peut-être aussi imagine-t-il Léa pensant à leur père. Théo est le double de l’écrivain qui tend son livre au lecteur. Ce qui est caché aux autres personnages est par lui révélé au lecteur, son récit est bien la page de notre lecture. Ainsi peuvent se comprendre les passages écrits à la troisième personne du singulier, la narration est prise en charge par Théo :
« Ce qui finalement a sauvé Léa, s’est d’être habillée d’un jeans (…) » (p.74)
ou les passages entre guillemets qui ne sont pas des extraits de la lettre :
« « Je me suis relevée tout doucement, j’avais mal aux poignets et aux bras » »(p.75).
Les guillemets signalent peut-être qu’un personnage (Théo) « fait parler » un autre personnage (Léa), offre son aventure en partage dans sa voix qui l’accueille, la recueille. Or, ce procédé est à l’image de la poétique de Nicolas Kurtovitch, de son esthétique à l’œuvre dans son roman où sont accueillies les voix des membres de la « famille humaine ».
Le roman est une œuvre polyphonique, le lieu où des voix singulières deviennent plurielles, comme la voix du romancier sous ses masques. Théo prête sa voix à Léa, qui prête sa voix à son père : au creux de l’œuvre, dans le vertige de la mise en abîme, se rencontre un personnage singulier : le père. Mais avant d’étudier ce personnage, souvenons-nous de deux autres personnages, Manuel et Moueaou, qui sont aussi, à leur façon, des doubles de l’écrivain.
2- Manuel et l’écriture :
Manuel et Moueaou ne portent qu’un prénom, mais qui est aussi signifiant qu’un nom. Ils incarnent leur nom. Tout se passe en fait comme si les personnages étaient le nom, ainsi que le souligne Camille en évoquant le rapport du nom à la terre : « Avoir le nom, être le nom, c’est comme être la terre » (p.25). Le projet de Manuel n’est pas de retrouver son nom, de retrouver sa terre, mais de devenir écrivain. Il s’imagine écrire des manuels d’histoire :
« Un écrivain écrirait également l’histoire de cette vallée, comment et pourquoi les tribus qui y habitaient en sont parties, chassées par de nouveaux arrivants »
(p.50).
Manuel n’a pas pour désir de partir en quête d’un nom ; son nom définit son projet. Manuel est aussi un double de l’écrivain, qui à met en scène travers lui son travail de romancier. Voici comment Manuel retrouve Moueaou : il imagine sa vie.
« Il ferme les yeux. Le visage de Moueaou est devant lui.(…) Il voit le grand jeune homme se déplacer d’une maison à une autre, seul, puis avec d’autres personnes… »
p.51.
Finalement pour le trouver, il n’aura plus qu’à suivre son « rêve ». Un rêve, dit malicieusement le narrateur ; parler de mise en abîme du travail du romancier qui pense, en fermant les yeux peut-être dans un bon fauteuil de cuir, assis à sa fenêtre, à ce qu’il va écrire avant de se mettre à l’ouvrage serait plus judicieux.
Dans l’entretien du 25 mars 2008, Nicolas Kurtovitch nous a confié qu’il avait habité dans un appartement avec un balcon à Sainte-Marie ; depuis ce balcon, il désirait écrire la vie des gens qui passaient. Manuel, pour sa part, habite Vallée des Colons –le nom est plus symbolique pour un personnage qui se rêve écrivain de l’histoire de la vallée. Il a réparé un vieux fauteuil qu’il a placé sur son balcon. Il « a passé une dizaine d’heures à remplacer l’ancien cannage en lambeaux par un treillis de lanières élastiques » (p.50). Un « treillis », c’est-à-dire un entrecroisement de fils, de lanières en l’occurrence, qui sert d’armature, d’assise. Elastiques : les lanières se tendent, se distendent, selon la position de l’écrivain. Le fauteuil même de l’écrivain renvoie au projet à la fois esthétique et formel de l’auteur ; les points de vue s’entrecroisent, l’écrivain, ce tisseur de texte, les travaille en treillis élastiques :
« Maintenant, ce siège est assurément le meilleur de l’appartement. Du balcon, il a une vue superbe sur la Vallée des Colons. Pendant quelques minutes, il se laisse prendre par l’agitation d’une fin de journée, imaginant deux ou trois pages à propos de chaque personne qui, à l’instant, retient son attention. Cette grosse femme, par exemple, est-elle si en retard qu’elle s’empresse de monter dans le bus ? Cet homme qui tire sur la laisse de son chien tout en essayant dans le même temps d’ouvrir la portière d’une voiture, où va-t-il avec son chien ? (…) »
« C’est la vie qu’il voudrait écrire, la vie ne cesse ni ne meurt, elle change, elle est mensonge et courage, bonheur et détresse, attente et abandon et d’autres choses encore »
p.50.
Ce thème est comme obsédant dans l’œuvre de l’auteur, il était déjà illustré notamment par la nouvelle « quelques instants il y a quelques jours dans la vie de quelqu’un ». La préposition « dans » s’entend dans ses deux acceptions : il s’agit de décrire les quelques instants qu’a vécus quelqu’un, mais il s’agit tout autant d’entrer dans la vie de cette personne au point de ressentir ce qu’elle a ressenti et d’entrer dans sa peau. L’anonymat dès lors vole en éclat pour devenir quelque chose d’universel dans la palpation de la vie de cet homme, de ce« frère ». La métaphore est à nouveau celle de l’écrivain au travail, travail entendu en son sens étymologique, torturé par la souffrance ressentie lors de cette incarnation.
Dans Good Night Friend, Manuel nous permet d’imaginer l’écrivain lorsqu’il se met au travail, confortablement installé dans un fauteuil… ou rêvant d’être comme son personnage confortablement installé dans un fauteuil placé stratégiquement sur un balcon. Bien évidemment, le clin d’œil est anecdotique ; Manuel ne réalisera pas son projet d’écriture, il n’imagine d’ailleurs pas d’autre place à ses écrits, s’ils se concrétisaient, que dans un tiroir fermé. Le narrateur de Good Night Friend réalise ce qui n’est qu’un projet chez Manuel. Les points de vue sont bien tissés dans le roman, ils forment son cannage solide, son assise formelle. Manuel s’en tient à son désir d’écrire, mais il n’écrit pas pour autant. En cela même il n’éclaire qu’une facette du projet romanesque de Nicolas Kurtovitch. Il n’est lui même qu’une lanière, un lien qui guide le lecteur sur les pas de l’écrivain, un lien parmi tant d’autres qui participent de la définition de l’esthétique de l’œuvre de N. Kurtovitch.
3- Moueaou et l’espace :
Moueaou ne reçoit lui aussi qu’un prénom, il n’est pas en quête de son nom. Pourtant, son nom est lié à la terre. Le romancier procède différemment pour définir ce personnage. Moueaou est un prénom et un nom. Or, dans la culture mélanésienne nous l’avons déjà dit, le nom est lié à la terre. Moueaou, précisément, a trouvé sa terre, il l’a presque, avec d’autres, inventée de toute pièce. Loin de sa tribu du nord, il est le gardien d’une terre insolite, au cœur de Nouméa, une terre dont Manuel –représentant incrédule le lecteur- n’aurait pas soupçonné l’existence. Mais les vieux connaissent son histoire depuis près de 20 ans : elle est une reconstitution, en miniature et en raccourci, d’une terre mélanésienne et de la société calédonienne.
« Lorsque les vieux sont en mal de forêt, en mal de nature, en mal de dieux et d’ancêtres, cet espace leur offre un univers, un cosmos qui est le leur. Ils viennent ici, travaillent, passent d’un champ à l’autre, ils rencontrent d’autres vieux comme eux, d’autres vieilles, ils discutent sans se faire emmerder. Certains d’entre eux sont dans le coin depuis vingt ans, ils peuvent te raconter l’histoire de chaque mètre carré , de chaque parcelle, ils savent quand tel bananier ou telle canne à sucre a été planté, et puis par qui, et avec qui, et dans quelles circonstances (…). Si tu cherches quelqu’un, c’est eux qu’il faut venir voir, ils sauront où le trouver. C’est pas de la blague et ils en savent tout autant que les familles calédoniennes »
p.99.
La vallée décrite ici existe bien, elle longe la route stratégique entre Magenta et la Vallée du Tir. L’auteur précise qu’elle « est occupée depuis 82-83. Avant, il y avait des champs et des cabanes de jardiniers » . A nouveau, ce qui importe à l’auteur n’est pas d’être un géographe, mais bien d’évoquer un espace afin d’y transcrire « le comportement des individus ». La vallée de Moueaou n’a pas d’importance en tant que lieu sur une carte. Elle est importante parce qu’elle nous apprend que certains mélanésiens, dont Moueaou est le représentant, n’ont pas subi passivement l’exil vers la ville mais qu’ils ont transporté et transplanté leur culture dans la ville. Leurs plantations, si riche de sens pour les mélanésiens, sont une implantation culturelle réussie. Ils ont inscrit leur monde, leur espace culturel, dans une parcelle du monde urbain. Au-delà, car le projet de Nicolas Kurtovitch n’est pas ethnologique, cette vallée transformée par les comportements humains est à l’image du roman qui est un espace où les individus inscrivent, sur la parcelle de la page, dans la vallée des paragraphes qui les abritent, leur histoire et leur culture, diverses et complémentaires, à l’image de « l’interface culturelle » définie par l’auteur.
Moueaou est le prénom, le nom, et la terre. Il a trouvé sa terre, il a trouvé sa place dans le monde.
« – Je suis de cette vallée, précisément et uniquement de cette vallée. Je voulais que tu saches où je vis et à quelle terre j’appartiens désormais. Et tu peux le voir, elle n’est pas bien grande. Mon clan et mon lieu ne sont que cette vallée »
p.100.
Moueaou n’a plus besoin de retourner en tribu, son monde est là, en miniature, comme le monde est là, sous les yeux du lecteur, en miniature dans l’espace et le temps du roman. Il est le gardien de cette terre où « les vieux » viennent pour parler, pour échanger. Si l’on poursuit l’analogie du monde et du roman, le statut de gardien qui est celui de Moueaou n’est pas sans rappeler le statut de gardien qui est celui de l’écrivain. Tout se passe ici comme si le roman était l’illustration des théories littéraires de Nicolas Kurtovitch, et un profond plaidoyer pour l’unité et l’amitié en Nouvelle-Calédonie. Les kanak de la Vallée en savent tout autant que les familles calédoniennes ; l’auteur voudrait lui aussi laisser s’exprimer dans son œuvre toutes ces voix qui disent le pays. C’est ce qu’il nomme la vigilance :
« La vigilance c’est être attentif à soi, à ce que j’aime en moi et ce que j’aime en l’autre, c’est dire cet amour. La vigilance c’est encore être attentif à ce qui, autour de soi, va à l’encontre de ce en quoi je crois, la compréhension des uns et des autres, particulièrement en situation de pluriethnie et de pluriculturalisme, et de le dire.
A mon humble niveau, l’écriture est ce qui me permet d’assumer le drame dans lequel j’ai été projeté lorsque j’ai pris conscience de la situation politique de mon pays, il y a vingt vingt-cinq ans. Chez un intellectuel, un artiste, un être tout simplement sensible, cette conscience ne peut être que dramatique. Accepter ce drame, le dépasser, permet d’assumer sa condition humaine. Qui peut nier la réalité de l’histoire coloniale ? Personne. Il vaut mieux, alors, en être tout à fait conscient, une conscience vigilante. C’est le seul moyen de continuer de vivre intellectuellement, artistiquement. Mon écriture est ma voie, elle me mène à la connaissance et à la conscience de l’univers où je suis. Elle vise aussi à jeter un pont entre nos communautés en Nouvelle-Calédonie, mettant en situation la beauté et la grandeur de la culture, du vécu, des hommes kanak. Ceci ne peut être vrai qu’à la condition que je ne pratique pas en parallèle, mon propre dénigrement, seulement et toujours, la vigilance à tout égards.
L’universel tient en peu de mots, en peu de notions, en peu de circonstances dramatiques, c’est tant mieux. Au nom de cet universel la culture dominante a trop éliminer. La vigilance s’exerce aussi à préserver la différence, tant pis pour ce qui, tout à fait en apparence, va à l’encontre de valeurs universelles hâtivement définies. »
L’un et l’autre sont des gardiens ; Moueaou est le gardien de la vallée, le narrateur est vigilant, attentif à une culture différente de la sienne dont il montre la beauté et la grandeur ; la métaphore de la culture –culture des plantations et culture d’un peuple-, et la métaphore de l’espace, géographique et mental, sont filées tout au long du roman, elles sont son fil directeur. Moueaou est un double de l’écrivain mais, comme Manuel, il n’éclaire qu’une facette du travail de l’écrivain. La « vigilance » en effet dont parle Nicolas Kurtovitch revête un caractère complexe. Moueaou n’illustre qu’une des attitudes des mélanésiens face à la menace d’exil dans les villes, mais il dit dignement le refus de l’acculturation et de la domination, préoccupation affirmée dans la communication « Ecrire en pays dominé ». Il est un lien, comme Manuel et les autres personnages, dans le vaste projet de l’écrivain :
« Ecrire en pays dominé lorsque sa propre culture est dominante c’est avant tout écrire la grandeur, la dimension universelle, l’apport de la culture de l’autre, au génie de l’humanité. Il y a comme un devoir vis à vis de cet autre qui depuis longtemps a été réduit à une simple existence de « l’homme à l’âge de pierre; sans véritable culture », ce devoir c’est de révéler au Monde l’existence, dans le sens complet du terme, incluant les dimensions culturelles, politiques, économiques, de l’Autre. Révéler que ceux que nous côtoyons ont pu et peuvent encore exister sans nous. Ecrire mon sentiment et mon expérience que l’existence de l’autre dans sa pleine dimension, loin d’être un risque, est bien au contraire, une possibilité unique de grandir, une source d’enrichissement et de développement, tant spirituel que moral, culturel et politique. Ecrire la rencontre de l’autre, une rencontre rendue possible par la pratique de l’esprit vide (…). Ecrire afin que d’autres à leur tour ouvrent les yeux, aiment et respectent l’autre, celui qui a été nié, celui à qui la culture dominante, (a) dénié toute humanité, sans se rendre compte qu’elle déniait alors à ses propres enfants cette même humanité. Vivre enfin d’égal à égal, et ce n’est pas en se niant, en étant son propre fossoyeur, qu’on peut espérer aider à l’amour de l’autre. »
III- Le père : entre problématique personnelle et problématique littéraire
Moueaou affirme que les cultures peuvent vivre d’égale à égale, il n’est pas dominé ; l’admiration que lui porte Manuel est semblable à cette admiration respectueuse que l’auteur cherche à susciter chez le lecteur à l’égard de « l’autre ». Mais les personnages du roman ont un devenir singulier. Moueaou réussit, vit et devient un gardien, son père meurt, dominé par la prison, il meurt avec sa culture mais d’une manière paradoxale : en la proclamant vivante en lui et en se proclamant vivant. Le personnage du père mérite de retenir toute notre attention.
Le père est une mosaïque, il est un personnage stratifié. Il est au confluent des théories littéraires de Nicolas Kurtovitch et des réminiscences de la vie de l’auteur qui l’érigent comme un ensemble sédimentaire ; nous voudrions lire chacune de ces strates, si cette prétention nous est possible.
– Il illustre le principe de la vigilance, puisque c’est à travers lui qu’est restituée avec fidélité la culture kanak. Il donne à entendre sa voix de mélanésien, le roman lui confère toute sa grandeur : le roman devient ce lieu d’échange, cette interface culturelle chère au romancier.
– Il est un double de l’écrivain. En effet, lorsqu’il meurt, il devient le monde, conformément à la spiritualité mélanésienne. Mais ce « tout » qu’il devient rappelle l’image du romancier, qui est « tout » dans son roman.
– Il est une double de l’écrivain, mais non plus double entendu en son sens esthétique, mais bien double parce que l’écrivain parle de lui et de ce qui le préoccupe en évoquant l’image du père.
– Enfin, il pose une problématique littéraire, celle de la création des personnages dans l’œuvre de Nicolas Kurtovitch.
a- Les références à la culture mélanésienne : l’homme exilé et le chef du clan.
Le personnage du père est au cœur du roman, un peu comme si dans l’architecture romanesque il avait été une clé de voûte. Si les personnages de Léa et de Manuel cherchent Moueaou, si ce dernier revient auprès des siens, c’est parce que le père a besoin de son fils. Il détermine donc l’action et le devenir d’autres personnages. Il est accompagné par un leitmotiv : « un homme se tient entre le ciel et la terre », lit-on dans le roman régulièrement lors de ses apparitions. Or, le mot « kanak » est un mot hawaïen, « kanaka » qui signifie précisément « homme » , voire « homme debout » entend-on parfois. Liée au personnage du père, une interrogation sur les mélanésiens exilés en ville et d’une manière plus absolue, sur la condition humaine traverse le roman. Cette interrogation est posée à travers les thèmes de la fatigue et du renoncement.
Parallèlement, Léa se tourne vers lui pour connaître leur nom de famille. Il est le plus vieux de la famille. Il est semblable au poteau central des grandes cases dans l’architecture mélanésienne. Le poteau central est orné d’une figure d’ancêtre qui souvent tire la langue, représentation stylisée de la parole qui s’énonce et de la parole qui s’écoute, qui se mange. Les mots partent du poteau central, parcourent la case, les autres poteaux symbolisant les membres du clan et reviennent à lui. Voici ce que l’on peut lire dans l’ouvrage Arts Kanak :
« La grande case est comme une image de la société kanak toute entière. C’est l’endroit où se rencontrent le ciel et la terre, les esprits des défunts et ceux des vivants.
Le poteau central représente le corps du Grand Aîné, les poteaux du tour de la maison les clans qui se soutiennent. Sans eux, il n’est rien et l’édifice s’écroule. »
Le père est à l’image de ce poteau central, leur identité est soulignée à plusieurs reprises dans le texte par Léa :
« Un homme se tient entre le ciel et la terre, pense-t-il, il les réunit, alors il faut se tenir droit, sans rigidité, droit et souple, aucune arrogance dans cela, simplement la satisfaction de l’attitude juste »
p.16.
Puis quand, brisé par la prison, le père fatigue, quand son identité ploie sous le fardeau de l’emprisonnement, Léa pense :
« Cet homme ne marche plus comme un homme. Lui qui affirme que l’homme se tient droit, entre le ciel et la terre, il est voûté, ses épaules sont lourdes, ses bras trop longs et sans énergie »
p.39.
Il est semblable à une case qui s’effondrerait dans la boue ; les descriptions de l’être humain et de la maison qui s’effondre se mêlent et s’enchevêtrent :
« La toile du pantalon dissimule des cuisses si fines, si vides qu’elles ne portent plus son bassin, ses genoux ne sont que des bouts d’os entourés de peau, chaque pas l’affaiblit. Il marche dans de la boue, la boue colle à ses pieds nus, la boue l’aspire et l’engloutit peu à peu, ses jambes lourdes n’ont plus la force de l’extraire du magma où se mêlent de la terre mouillée, de la paille humide et des carreaux de carrelage blanc, ceux-là mêmes qui recouvrent le sol de toute la prison »
p.40.
Son corps déjà est aspiré par la terre mortifère. Son corps est une prison ; son âme aussi : le père emprisonne en lui le secret du nom. Sa pensée s’enferme ; au lieu de divulguer le nom, le père refuse l’échange. Le geste de coutume qu’il voulait initier pour réconcilier sa famille avec celle de son agresseur devenu sa victime n’aura jamais lieu. Le poteau central de la case ne remplit plus son office et le lien familial autour de lui se délite. La famille n’est pas désunie, même si Moueaou a trouvé ailleurs sa terre, son véritable lieu ; non, la famille ne trouve plus sa terre, la tribu rêvée par Théo un instant (p.57), le nom demandé par Léa instamment ; elle perd un de ses membres le plus important : le père lui-même. L’image de la case du grand chef solide, symbolisant le clan, ne résiste pas à l’image de la prison. Le père a enfermé en lui-même son savoir, et ce savoir disparaît –momentanément- avec lui. Dans l’économie du roman, il lui faut mourir pour que la parole soit libérée. Cette parole, ce savoir qui pèse comme un fardeau sur les épaules d’un vieux de la tribu, est donnée comme un libération après la mort du père :
« Enfin il allait pouvoir se libérer du poids que représentait ce nom. Durant tant d’années il l’avait prononcé, en silence ou d’une petite voix à sa femme, pour qu’il n’en oublie pas les sonorités.(…) Non, vraiment, ce secret devenait trop dur à porter, il était bien content de s’en débarrasser, bien content que quelqu’un veuille s’en charger, car le nom ne devait pas mourir totalement. Elle avait parlé d’un équilibre à retrouver pour ses enfants et de ré-appropriation de vieux et nécessaires savoirs. Ca, ça lui plaisait ! »
pp.121-122.
La figure du père est reléguée au second plan, que l’on se souvienne des propos de Dila concernant un dieu frère. Good Night Friend n’est pas le roman du père, c’est le roman du frère. « Dila se sent libre de partir. En outre, son questionnement devient légitime une fois le père mort » .
b- Le double de l’écrivain :
Mais relégué au second plan, sa figure personnage est riche de sens et d’enseignement. Parce qu’il dévoile un pan de la culture kanak, il participe bien de cette vigilance sur laquelle Nicolas Kurtovitch attire notre attention. Le père meurt mais le narrateur attire notre attention sur la grandeur du monde auquel il appartient, ce monde et cette culture auxquels qu’il convient de reconnaître pour exister aussi. Le père est dominé, dominé par ses propres choix qui l’enferment, dominé par le mode, dominé par la prison. Or, il devient en cela même le lieu d’une interrogation à la fois politique et esthétique de Nicolas Kurtovitch.
1- La mort et la renaissance par l’écriture
Dans l’article déjà cité :« Ecrire en pays dominé lorsque sa culture, sa langue, sont l’outil de la domination », l’auteur évoque le drame de la prise de conscience de la colonisation : « Cette conscience est un drame, c’est une véritable première mort ». La mort du père devient métaphorique, elle est l’image de la conscience qu’a l’écrivain de vivre dans un pays où l’autre souffre, où l’autre est encore soumis « aux séquelles du colonialisme ». La création du personnage du père épouse parfaitement la pensée politique et esthétique de Nicolas Kurtovitch, et il convient pour mieux comprendre de reconnaître le rôle de l’écriture. Le père meurt, mais l’instant de sa mort est décrit dans le roman comme un moment de naissance au monde. Le père mourant se confond avec l’univers. Or, lorsque Nicolas Kurtovitch parle des vertus de l’écriture, il parle de naissance au monde. Dans le monde mélanésien, celui qui meurt vient habiter le monde, il renaît au monde sous une forme différente, il devient un « flux » et se dissout dans « l’esprit totémique » . L’auteur définit ainsi l’écriture :
« Cette conscience est un drame, c’est une véritable première mort. Mais il en va de cette première mort comme de toutes celles qui revêtent ce caractère de nous laisser sans vie sans pour autant nous l’avoir ôté définitivement, il en va qu’il faut renaître. Il faut alors renaître ou mourir effectivement, c’est à dire : succomber. Sans que ce ne soit une décision, l’énergie de survie qui s’est manifestée en moi l’a fait par l’intermédiaire, entre autre, de l’écriture, mais c’est sous cette forme, l’écriture, que cette énergie permet la communication et l’échange. Ecrire est pour moi la possibilité de naître à nouveau. »
Ecrire, écrire la souffrance de l’autre, est ce qui permet « une plus grande intelligence de la situation de son pays ». L’écriture permet d’accéder à une autre conscience, de naître à cette autre conscience :
« Mais qu’on ne s’y trompe pas, il ne suffit pas d’aligner des mots, des phrases, des chapitres, des publications, pour que l’écriture agisse. Ecrire est avant tout un dialogue avec soi-même, c’est un questionnement, un doute, écrire, c’est vivre «à la frontière ». Si on veut que l’écriture soit opérante dans cette optique de renaissance, si on souhaite , par elle, accéder à une autre conscience, en d’autres termes : si on écrit parce que l’énergie dépasse notre volonté, alors l’unique solution, l’unique porte par laquelle il faut passer est de s’ouvrir au Monde. Naître à nouveau par l’écriture exige une écriture trempée à l’encre de la sincérité et du vécu. »
En ce sens, le parcours du père est une transcription métaphorique des propos tant politiques qu’esthétiques du romancier. Sa renaissance évoque celle du romancier lorsqu’il accède à une grande lucidité, à la compréhension plénière de la situation de son pays et à la « compassion, la compréhension, la connaissance, de la souffrance et des épreuves de l’autre ». Le parcours du père rend compte d’une expérience artistique. Le père inscrit dans Good Night Friend, par sa mort et sa renaissance, le sens que donne le romancier à l’écriture et partant, à l’ensemble de son œuvre. Mais la comparaison s’arrête là : le père devient le monde mais il n’est pas la conscience de ce monde. Sa voix se perd dès lors qu’il se dissout dans le monde de la fiction romanesque. L’écrivain, pour sa part, doit continuer à être et à écrire son monde pour que « l’écriture agisse » en lui et autour de lui.
Cet extrait de la mort du père, mort niée, traduit aussi la dimension universelle qu’il acquiert. Or, il s’agit là d’une préoccupation essentielle à l’auteur :
« Ecrire en pays dominé lorsque sa propre culture est dominante c’est, lorsque j’écris mon rapport à l’Autre, avant tout écrire la grandeur, la dimension universelle, l’apport de la culture de l’autre, au génie de l’humanité ».
Dans le même temps, sans paradoxe aucun, la conception de la mort est si particulière au monde mélanésien que cet épisode est aussi une contribution à la restitution « de la culture de l’autre », dans sa singularité, dans son « génie », dans son appartenance à cette forme de « patrimoine mondial de l’humanité ». Le narrateur a accompagné l’autre, le père, vers sa dernière demeure, dans sa fusion avec l’univers, mais le narrateur n’a pas fusionné avec l’autre. Cette thèse est développée dans l’article « Tentation caméléon et métissage culturel » où le romancier affirme qu’afin de « garantir un équilibre intellectuel et psychique », il faut savoir « rester soi et en même temps (…) être près de l’autre en évitant la fusion » :
« Gardons-nous de n’être que le miroir de l’extérieur car ce qui fait la force d’un cœur est sa capacité de puiser en lui l’énergie de vie et d’en irriguer l’espace tout autour ».
Le personnage du père nous permet donc d’appréhender les théories du romancier. Le père qui se dissout dans le monde irrigue de son sang la terre de ses ancêtres et de ses héritiers, comme le veut la cosmologie mélanésienne ; le romancier fait jaillir de son cœur (métaphore qu’il conviendra d’expliquer) « l’énergie de vie » qui se répand sur le monde romanesque jusqu’au lecteur. Le père est aussi un double du romancier, du romancier tel qu’il se met en scène dans Good Night Friend. Il est temps dès lors de relire ces pages qui décrivent la mort du père.
2- Un texte fantastique ?
Le récit de la mort du père est stimulant. Page 79, le père est vivant et un personnage annonce à mots couverts qu’il va le tuer : « Pour toi, ça ira oui, quelques temps, le temps que je veux bien te donner. Après je m’occuperai de toi ». Page 103, Quentin, en point de vue interne, annonce au lecteur sa mort : « leur père est mort ». Plus loin dans le roman, des pages 109 à 115, le père raconte sa mort, il parle de sa blessure et rapporte même le propos de celui qui le déclare mort : « Il est mort, il n’y a plus de sang, recouvre-le avec la serviette, le Directeur décidera pour la suite » (p.115). Puis le père poursuit sa réflexion sur ce qu’il ressent. Deux hypothèses de lecture s’offrent donc au lecteur, conforment à cette « hésitation fantastique » que définit Todorov : soit le père n’est pas mort et celui qui l’a déclaré mort a parlé trop promptement –le roman reste alors réaliste. Soit le père est mort et le roman bascule dans une dimension fantastique. « Je ne vois plus, je n’entends plus, la vie de surface s’en va, emportée par le vent comme il emporte à la surface de l’océan les petites vagues qu’il forme lui-même, pour le seul plaisir de les emporter ensuite » (p.115). Le vent emporte la vie de surface, elle ne s’abolit pas, elle se poursuit en profondeur : ici commence le récit fantastique. Le personnage passe dans l’autre monde : « Quelque chose me persuade que je dois passer. Passer. Un mot surgit de nulle part, qui s’impose en creusant une brèche dans le noir » (p.110). Les cris des vivants percent cette nuit, puis s’estompent pour laisser place à celle d’un défunt qui vient lutter contre lui, métaphore de la lutte de la vie contre la mort. A la fin de cette lutte, de cette description de la mort qui s’inspire du mythe mélanésien de la roche percée qui permet le passage dans l’autre monde, le lecteur lit ces phrases :
« La vie de surface a trouvé dans la blessure, un trou par lequel elle retourne à sa maison. A la place, la vie de profondeur, celle qui s’ancre au pied de la montagne. Celle qui n’a ni forme, ni odeur, ni son, celle qui permet d’être tout à la fois, le carrelage de la prison, la pierre de la cour, le sable de la cour, le bois de la table, et chacun de ceux qui m’entourent, ceux qui étendent la serviette sur mon corps et mon visage. Je les sens, je vais encore les sentir pendant longtemps »
p.115.
Par sa chronologie, par le choix narratif de laisser le père raconter sa mort, le roman abolit l’idée de mort, renouant ainsi avec les mythes mélanésiens. Mais, devenant « tout à la fois », les vivants et les défunts, les êtres et les choses, le passé et le présent avec ce pont lancé vers le futur (« je vais encore les sentir pendant longtemps »), le père devient, à son tour, un double de l’écrivain qui peut être « tout à la fois » dans son roman et faire surgir « la vie en profondeur ». Le père a refusé de divulguer leur nom à Léa, le romancier lui a refusé son nom : sa vie, son aventure, l’a enfermé en prison, une prison dont il sort pour devenir le monde. Par les derniers mots qu’il prononce il se confond avec le romancier.
3-une problématique personnelle
« Lorsque le roman commence, le père n’est déjà plus là », commente l’auteur lors de l’entretien du 25 mars 2008. Cela tient, de son propre aveu, à son histoire personnelle. Il est donc aisé de lire dans les traits du père des éléments autobiographiques, mais non pas tant dans les faits, la trame de l’histoire, que dans la démarche. Le père n’a pas de nom, il est « le père », une sorte d’archétype. « Léa l’appelle papa, donc comment peut-on l’appeler ? » Nicolas Kurtovitch a dû bien logiquement appeler son père “papa”, le nommer père. A cet égard, il est intéressant de noter que Nicolas Kurtovitch porte le prénom de son père, ainsi qu’il le confie à Hamid Mokaddem :
« Je suis le fils de Slobodan Kurtovitch (…). Ismet aurait dû s’appeler Slobodan. Il s’est appelé Ismet parce que le cousin germain de mon père est mort à la guerre, le seul mâle de la famille avec mon père. C’est une tradition de la famille Kurtovitch de donner le nom d’Ismet par mémoire à ce cousin de mon père mort à la guerre. Ismet s’est appelé Ismet au lieu de Slobodan. C’est donc moi, le deuxième fils, qui est appelé Slobodan. Mon père est le seul fils d’une famille de six. »
« Ce qui est constituant de nous-même est constituant du livre », confiait l’écrivain. Peut-être qu’en sondant le visage de son père le narrateur veut-il, comme Léa, sonder le mystère de son être, sa part la plus intime, la plus secrète? Léa demande à son père le secret de son nom : elle pense ainsi se trouver comblée s’il lui donnait la réponse. Nicolas Kurtovitch voudrait aussi sans doute poser des questions à son père, l’enjeu de ce questionnement serait la plénitude de soi. La question n’est pas pour lui celle du nom. La question se trouve posée différemment : elle est un questionnement sur l’être et l’histoire.
Le père absent est une problématique personnelle à l’auteur. C’est également ce qu’il confie à Hamid Mokaddem :
« – Tu n’as pas connu ton père?
– Pas de manière consciente, mais j’ai quelques souvenirs.
– Des bribes?
– Des bribes, et pas toujours très heureuses. Si, j’ai deux souvenirs heureux.
– C’était dur?
– Très dur. Avec nous, avec ma mère. J’ai surtout des souvenirs très durs avec ma mère. Je comprends et je suis d’accord lorsqu’elle s’est enfuie. Mon père n’a jamais revécu ici. Ma mère a fait en sorte qu’il ne puisse pas s’installer ici. »
Que faire dès lors de cette absence? Un vide se creuse en soi. L’autre, le père, porte en lui une partie de soi. L’interroger est impossible : il est l’absent, le prisonnier, le défunt. La démarche de Léa qui interroge en vain son père et qui lui prête des pensées est semblable à la démarche de l’écrivain qui pose dans son œuvre le visage d’un père absent et silencieux, à qui il prête des pensées. Se réapproprier l’autre, c’est tenter de saisir dans son unité sa propre identité. Nicolas Kurtovitch met ce geste en texte, à la fois d’une manière semblable et différente, dans la nouvelle Une Vie . Dans cette nouvelle, le narrateur, qui se confond davantage encore avec le romancier, se recueille sur la tombe de son père à Nouméa, au cimetière du Sixième Kilomètre –un père qui lui a quatre sœurs, et non cinq comme Slobodan Kurtovitch. La voix argentine et enjouée d’une jeune fille, qui évoque les souvenirs heureux de son père, emporte l’imagination du narrateur qui veut essayer de reconstituer la vie de son père, de lui trouver des souvenirs heureux. Car le narrateur ne cherche pas des souvenirs heureux de son enfance ; il cherche à rendre heureux son père. Lorsque la jeune fille se tait, il dit :
« Le silence qui s’est établi ensuite m’a ramené peu à peu au ciment où reposait ma tête, puis à la photo et au visage qui y était imprimé. J’ai souhaité qu’il me parle car j’espérais que peut-être ainsi, il réussirait –tout était maintenant trop tard- à évacuer cette douleur sourde qu’il ne devait pas manquer de ressentir, par ma faute, à l’évocation de ce qu’avait subi une nouvelle fois sa chère ville de Sarajevo. »
Ce qui rend triste le narrateur, c’est la vie même de son père :
« C’est la gaieté qui émanait de cette jeune voix qui m’attirait et me rendait heureux, contrastant avec la tristesse qui m’avait habité quelques minutes auparavant à l’évocation du visage de mon père sur son lit de mort. Non pas que je l’ai beaucoup connu et que je perdais un être cher. Il n’est pas ma mère et il n’a pratiquement jamais vécu avec nous. La tristesse m’est venue plutôt du souvenir de ce qu’avait vécu cet homme, définitivement loin de chez lui dès l’âge de dix-huit ans ! »
Le narrateur s’approprie la vie de cet homme, son père :
« J’ai travaillé lentement, en prenant le temps de penser au vieil homme qui se trouvait sous la pierre. Il y avait une photo, abritée d’une plaque de verre. Elle le représente debout, les bras croisés, regardant fixement l’objectif comme quelqu’un qui n’a pas l’habitude d’être photographié, ce qui était certainement le cas. Tout en m’affairant lentement je lui ai jeté des regards ; ce visage très émacié et des yeux sombres surmontés d’épais sourcils retiennent chaque fois mon attention. J’ai lu sur ce visage comme dans un livre d’histoire, un livre qui raconterait les nombreuses pérégrinations de réfugié à travers l’Europe d’abord, puis à travers le monde entier par la suite. Mais dans cette histoire personnelle j’ai aussi lu l’histoire de l’Europe, de ces hommes qui s’étaient entretués sur ordres d’empereurs puis de dictateurs qu’inconsciemment ils avaient, pour la plupart, portés au pouvoir. »
Le narrateur réinvente son père, il l’imagine enfant heureux, mais effacer « soixante années » de son existence lui permet d’effacer soixante années de l’existence de l’Europe, ses années les plus sombres. Le père conduit à une autre problématique personnelle, à une autre interrogation de l’auteur : la guerre, celle qui, voulant anéantir l’humanité, anéantit l’humain en l’homme :
« Je vais garder en mémoire pendant encore longtemps la voix heureuse et pleine d’enthousiasme de cette jeune fille. Elle m’a plu, j’aimerais faire sa connaissance. Tout comme j’aime à imaginer mon père non pas quelque part en France ou dans le monde, mais plutôt à Sarajevo, à une époque où il était encore jeune et quelque peu insouciant, loin de la guerre à venir et de l’errance qui allait être le lot de milliers de personnes. Je préfère voir son visage regardant les toits de la Bascarscija depuis les collines, à l’instar de Nyazz, quelques temps après la levée du siège. Sinon, où se poserait-il pour m’offrir son regard ? Dans un de ces quartiers de la banlieue de Tours où je l’ai retrouvé quinze années après que ma mère nous ait avec bonheur enlevés à son anachronique et stérile autorité, alors qu’il se morfondait dans un ennui hautain vis-à-vis des ses semblables ? Non. Ça je ne le veux pas. Cette voix évoquant une partie de pêche sous un jour récréatif m’a apporté la clef du problème : rayer d’un trait soixante années de son existence pour n’en retenir que les premières. Lui, enfant emmailloté de larges bandes de tissus, adolescent courant les montagnes ou les rues de la vieille ville. Ces soixante années n’avaient fait que conduire sa ville au carnage et à la mort, à la trahison et à la barbarie. Autant ne pas associer cet homme, ici enseveli, à cette partie du siècle. »
Cette interrogation sur l’inhumain en l’homme, interrogation dont le lieu est Sarajevo, est au cœur D’Astral Weeks. Le lien entre Une Vie et Good Night Friend paraît plus ténu. Cependant, la fin de la nouvelle est infiniment révélatrice. Le narrateur écrit les « années d’errance » de son père ; d’abord, l’ordinateur ne veut rien savoir, puis, après s’être reposé, le narrateur rallume l’ordinateur, qui n’a pas gardé en mémoire les soixante pages écrites (les soixante pages qui concernaient les soixante années qu’il fallait oublier) :
« Il y avait bien un nom de fichier mais il n’enregistrait qu’un seul kilo-octet, autant dire rien du tout. Comme si sa vie n’avait pas existé après son départ de Sarajevo.
Peut-être n’avait-il pas voulu que de quelconques traces de lui subsistent, maladroitement écrites par un fils qui, somme toute, n’y connaît pas grand-chose. »
Le silence du père, absent, effacé, est la source d’inspiration intarissable du fils, qui ne décline pas tant la vie de son père que ce qu’il est lui-même. En observant le visage émacié des pères, les narrateurs de Nicolas Kurtovitch cherchent à trouver leur propre image et celle de l’humanité toute entière.
4-Une problématique littéraire
Problématique personnelle, le principe participe surtout d’une problématique littéraire. Nicolas Kurtovitch donne vie à son père, il lui donne une voix, comme il donne vie et voix aux autres, « dominés », qui ne peuvent pas se dire, comme il donne vie et voix à ceux qui souffrent. Or, force est de constater que donner chair à l’autre, à un homme, n’importe quel homme, « étrange et inconnu », qui « mérite tout autant qu’un autre, tout autant qu’un homme célèbre, d’avoir son histoire, une partie de sa vie racontée, simplement, sincèrement », est ce qui préside précisément à l’émergence du personnage en littérature.
Relecture de « qq inqtants il y a qq jours ds la vie d’un autre »
Conclusion :
Dans Good Night Friend, Nicolas Kurtovitch met en roman ce qui est à l’œuvre dans sa poésie, mais loin de n’être qu’une variation sur un thème entendu, le roman permet à l’auteur un renouveau fécond de son esthétique. Exploitant toutes les possibilités qu’offre le roman, ces voies, ces chemins, le romancier poursuit sa route vers l’humain, il marche à la rencontre des hommes. Son recueil accueille leurs voix multiples, tantôt contradictoires, tantôt enchevêtrées, mais toujours, finalement, réunies et unies. Les mises en abîme participent de l’esthétique du roman et lui confèrent toute sa profondeur. Les personnages sont, tour à tour, les doubles du romancier, du romancier qui porte le masque de ses personnages. Il couche leurs récits par écrit : « good night friends », il les accueille de manière fraternelle, et ce lien fraternel acquiert une résonance quasi religieuse, sans être jamais mystique.
Il est singulier de noter que le nom de famille, retrouvé par la mère à la fin du roman, n’est pas divulgué au lecteur. Le nouveau nom lui-même était tu ; le lecteur sait seulement qu’il commençait par la lettre « T », comme « Tais-toi ! » (p.18). « Peu importe son nom » (p.19) dit Léa à propos du nom de son professeur. Les noms de famille ne seront pas divulgués, un peu comme dans la société mélanésienne où certains noms, ceux qui disent le secret de l’être, ne peuvent être dévoilés. Peut-être ces noms n’ont-ils pas d’importance pour le romancier lui-même ; à son niveau, le seul nom qui sera le trait d’union entre tous les êtres, le nom qui scellera leur union, celui qui dira leur nom de famille, c’est le titre qui énonce le lien fraternel, c’est le nom « friend » décliné en « frère » ; les mots du roman qui explorent et dévoilent les univers intérieurs de chacun dépassent la rupture épistémologique qui empêchait les hommes d’être unis les uns aux autres. Sans le mot de frère, les hommes ne reconnaissent pas le lien qui les unit, ils vivent les uns à côté des autres, ils se côtoient, se parlent sans se comprendre, se violentent, s’agressent. Par les procédés mis en oeuvre dans le roman, par la présence de personnages qui refont les gestes du romancier, par les récits dans le récit et parce que les personnages pensent ou disent les autres personnages, les mots vont au-delà de la rupture, une rupture épistémologique et humaine, en rappelant aux hommes qu’ils sont frères. Le lecteur lit en eux et, plus étonnant, certains personnages lisent dans l’âme des autres : les mises en abîme participent du projet esthétique de l’auteur.
Le nom est bien en cela même une terre : la famille humaine, réunie sous ce nom de « frère », habite le lieu qu’est le roman, cette terre d’accueil, le double de notre monde ; le narrateur l’énonce clairement :
« Camille sait que le nom dans la société kanake est une terre, il est Une terre. Sans un nom véritable le lien est rompu. Avoir un nom, être le nom, c’est comme être la terre »
p.25.
« Il est Une terre » et une terre Une, unie, unique, c’est aussi la définition du roman. Les références à deux univers profondément différents, la société kanak et le christianisme, concourent, d’une manière inattendue, au surgissement d’image cohérente : le nom est la terre dans la société mélanésienne ; pour les chrétiens, il a suffi a Dieu de nommer le monde pour que le monde soit ; le verbe également est la terre, le monde, et tous les êtres vivants. Nicolas Kurtovitch connaît le monde mélanésien –source d’inspiration de ses nouvelles et de ce premier roman-, mais il est imprégné de culture européenne, il connaît cette figure littéraire du romancier-créateur, dieu omniscient dans son œuvre. Ces deux sources d’inspiration, aux antipodes l’une de l’autre (culturellement et géographiquement), trouvent ici leur cohérence. Elles parcourent, parallèlement, les pages du roman pour en définir l’esthétique. Nicolas Kurtovitch est l’homme des synthèses. Dila, personnage caché, reclus au fond de sa cuisine, effacé, et Théo, personnage apparemment secondaire, sont en fait la clef de bien des énigmes. Ils guident le lecteur ; à travers eux, le romancier révèle la clef de lecture du roman qui suppose que par le nom de frère soient unies les consciences, réunies par les mots en un lieu, la terre-roman.
Le nom est intimement lié au lieu, il est le lieu.
Il est une métaphore dont nous avons peu parlé, il s’agit de la métaphore de l’eau. Cà et là jaillissent des sources dans le roman. Des sources d’inspiration, à n’en pas douter. La « rêverie de l’eau », pour emprunter cette belle expression à Gaston Bachelard, permet aux personnages de retrouver leurs sources, de lier passé et présent dans la permanence du nom : le courant de l’eau comprend tous les temps et s’ouvre sur de vastes lieux, il dissout les ruptures. Retrouver le nom d’avant, c’est abolir une rupture dans la connaissance de soi, c’est abolir la rupture épistémologique qui veut que les hommes aient perdu, ou renoncé, à ce nom qui fait l’unité de l’être, à ce nom qui reconstitue la fratrie, la « famille humaine ». Certains mots séparent les hommes, d’autres les unissent. A la surface de cette eau-là se mire l’inconnu qui guide aimablement Manuel. Dila, et non Léa, plongeant dans la rivière de son imaginaire, une rivière pourtant bien réelle devant elle qui la conduit vers l’océan qui englobe le monde, dira le nom, liera les lieux, accomplira la quête de l’unité pour sa famille, « son temple » (p.56). Une nouvelle mise en abîme éclaire l’œuvre. L’eau accompagne poétiquement ce jeu troublant de miroirs : Dila renoue avec la terre et le nom ancestraux, elle renoue avec le passé, remonte aux sources du temps, franchit tous les espaces ; le roman prend fin quand le nom est trouvé, quand il y a réconciliation (n’oublions pas que le grand-père a été chassé par ses propres frères), quand le roman a rassemblé toutes les paroles de chaque membre enfin apaisé de la « famille humaine », quand la fracture épistémologique s’est résorbée. De fait, le roman commence dans une bibliothèque où Léa, la lectrice qui veut renouer les liens, vient trouver Manuel, l’homme des livres, solitaire à ce moment du texte. Le roman se clôt quand la famille a retrouvé son nom, quand les êtres se sont réconciliés, quand toutes les pensées des amis, des frères, ont été réunies au cœur du recueil. Le lecteur peut suivre le fil du texte, l’encre coule d’histoire en histoire, librement, il peut lire comme l’on regarde « l’eau sauter de rocher en rocher » (p.62 et p.124). Il se trouve dès lors dans la même position que Dila :
« A partir de quelques agencements la nature donne à contempler la totalité du monde, permet de percevoir à partir de l’eau et de la roche, des arbres et des sons, la vie dans sa plénitude » (p.124)
Or, cette description de la nature participe de la définition de l’œuvre, puisque le roman inscrit en lui « la vie dans sa plénitude ». La faille inscrite au cœur des mots (du nom de famille, des propos qui se juxtaposent) n’existe plus puisque la famille humaine est rassemblée, le monde vivant, vibrant autour d’elle peut être contemplé, dans l’espace du roman.