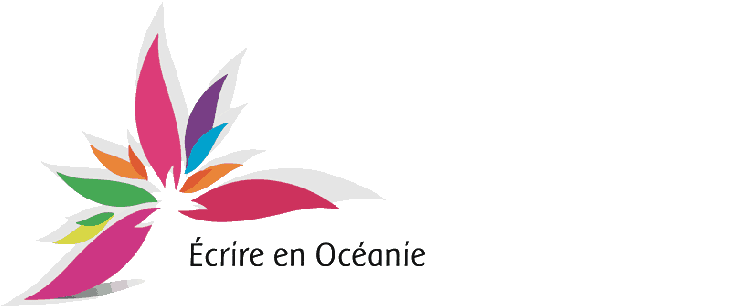« Fils du ciel » de Frédéric Ohlen
Orageux en fin de journée
Publié aux éditions « L’Herbier de Feu », « Fils du ciel » de Frédéric Ohlen est un beau fragment de littérature traversant une existence. Cette longue nouvelle, ou ce monologue théâtral, est un fascinant voyage au bout de la vie, en temps universel et en « blanc et noir ». Suicide en lignes…
À vingt mille kilomètres de distance, les hasards de l’édition font que Frédéric Ohlen nous délivre avec « Fils du ciel » une histoire voisine du dernier prix Goncourt « L’art français de la guerre » d’Alex Jenni. Le personnage principal est aussi un vétéran des guerres d’Indochine et d’Algérie, en confessions. Le Goncourt fait six cents pages et « Fils du ciel » trente seulement. Mais, c’est un bonheur concis de lecture avec une langue évocatrice, avec des mots qui sont des coups de pinceaux précis pour donner à voir. À l’image de la couverture « rivetée de rouille » sur laquelle une usine moribonde étale ses fenêtres borgnes et ses cheminées éteintes. Sur le ciel, en transparence, des fils d’acier et des poutrelles fantômes permettent d’accéder à un au-delà meilleur où les souvenirs continuent de passer en boucle sur l’écran merveilleux de l’enfance.
Car ce gardien barricadé, prêt à tout faire sauter, va faire des allers-retours sur sa vie en s’adressant à une jeune femme, une médiatrice sensée l’amadouer, et au lecteur suspendu à ses aveux. Le taiseux qui a toujours eu le silence pour ami se mue en un bavard intarissable. Les mots sont les seules armes qui lui restent, son baroud d’honneur malgré les explosifs, espoirs de terre brûlée régénératrice, et ce revolver dérisoire pour forcer l’écoute.
Un cœur palpitant de serpent
Alors qu’il s’annonçait radieux, le ciel se couvre des nuages noirs du fatum. La soirée sera orageuse. Derrière les éclaircies des flash-back colorés, on perçoit l’immense solitude du narrateur en quête d’absolu, de rédemption, de liens affectifs jamais tendus ou trop vite rompus. On y croise Anna, la jeune Vietnamienne « aux cheveux qui sentent la neige chaude » et qui danse « cambrée comme si elle courait vers quelqu’un », sa mère Kim qui cache ses mains de roturière derrière de fins gants blancs, une vieille marchande préparant du thé où flotte un cœur palpitant de serpent « comme une olive sanglante dans un Martini », le lac de l’épée à Hanoi et l’île aux tortues dorées, fossoyeuse de son unique et premier amour, un théier millénaire aux vertus médicinales enchâssé dans la roche, un chien fidèle et son rassurant « Tic-Tic » de griffes courant sur le ciment, des tentes de SDF au bord du Canal Saint-Martin ou une petite gare/cercueil perdue dans le désert algérien.
Assis entre ciel et terre sur la structure d’acier du pont Doumer à Hanoi, il regardait déjà le monde d’en haut et le trouvait beau avant de s’enfoncer dans l’âge adulte qui noircit l’azur, trouble les eaux claires, distille son venin, tutoie la misère sociale et fait rater le tournant amoureux. En vendant l’objet spirituel, il perd l’innocence, « sabre » toute sa vie et doit expier.
Vous l’aurez compris, il est impossible de raconter la richesse de ce texte dont les passages sur l’Asie vous encourageront à la relecture de peur de passer à côté de ses fragrances obsédantes. Pour clore ce livre, chronique d’une mort annoncée, la légende apparemment sibylline du samouraï (encore un sabre) est un dernier bijou, brillant comme un diamant noir. Rideau !
Rolross