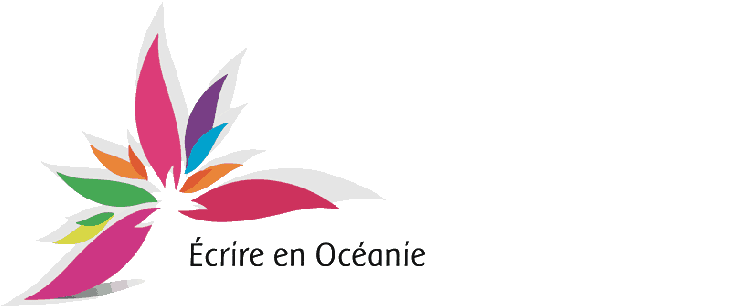Diego Jorquera
Je suis né le 9 septembre 1954 à Barcelone, installé en France trois ans plus tard. J’ai fait à Lyon des études secondaires littéraires et artistiques. Après une période d’indétermination personnelle et professionnelle et de voyages, j’ai suivi une formation de menuisier en 1978. J’ai exercé ce métier jusqu’en septembre 2005, date de mon départ pour la Nouvelle Calédonie où je suis Formateur Professionnel pour Adultes.
Mes premiers écrits remontent à l’âge de deux ans où j’ai agrémenté le papier peint tout neuf de la chambre de mas parents de hiéroglyphes à l’aide d’un morceau de charbon. Plus structuré, un poème remarqué au collège par ma professeur de français m’a valu de passer d’une section moderne à une section classique. Par la suite j’ai donné le jour à quantité de brouillons, poèmes et chansonnettes divers ainsi qu’à des traits d’humeur dans des revues et journaux dont je n’ai pas cru bon conserver la trace ou si peu. Si l’on excepte ma contribution au Dauphiné Libéré comme correspondant local dans les années 90, le réel déclic a eu lieu en 2003 à la suite de la lecture de «Châteaux de la colère» d’ Alessandro Barrico qui m’a transporté et déclenché en moi le courant de l’écriture.
J’écris peu, par à coups, frénétiquement parfois, tout ce qui me vient, avec ou sans contrainte et sur les sujets et dans les formes les plus variés : nouvelles, poèmes, chansons, haïkus… Lire et écrire m’est vital, échanger et partager l’écriture l’est tout autant.
© ENVOI de Diego Jorquera
Je suis né dans une clinique là où maintenant s’élève un stade olympique. Est-il exactement au même endroit? Je m’en moque, Pour ce qui fut le début de mon périple je ne laisserai pas les détails gâcher mon plaisir! Barcelone était à cette époque une ville dont les meurtrissures de la guerre civile achevée quinze ans plus tôt, et bien qu’elle se montrât par instants grimée pour la parade, étaient prégnantes. Ma mère l’étant aussi, je vins bientôt au monde dans un curieux mélange d’euphorie feinte et de fatalité imposée dont j’ai eu quelquefois du mal à me départir.
Déjà avant moi mon père avait l’esprit vagabond pour un pays qu’il avait idéalisé. Des prétextes économico politiques, pas tous infondés, lui permirent de réaliser son rêve. Nous nous trouvâmes ma mère déjà grosse de ma sœur et moi, en route pour ce pays de cocagne que, via un court séjour en Afrique du Nord, j’allai découvrir du haut de mes presque trois ans. Mes plus anciens souvenirs sont sans doute incertains mais ils me parlent : des appartements à demi vides, des adultes parlant bas et des mômes tristes à l’affût de bêtises à faire que n’osaient plus faire leurs parents. Puis un jardin éclaboussé de soleil et c’est déjà un autre pays, des enfants vivants, une jeune fille qui me gave de sourires et de crayons de couleur. Un viaduc au dessus d’une ville étourdissante de blancheur, ma cheville meurtrie par un galet projeté par une voiture sur les quais.
Barcelone, Oran, Marseille, des villes de mer et de lumière puis, trop vite, l’entrée dans la pénombre de l’automne, le gris d’un autre monde à apprivoiser quand j’avais à peine entrevu les précédents. Rien dans ma mémoire du trajet de la Méditerranée aux rives des banlieues lyonnaises. La caméra, mieux que la plume, rendrait ce fondu enchaîné donnant le jour par une aube frileuse, à une cour d’école grouillante d’enfants emmitouflés. Et au visage bienveillant se penchant sur moi de la maîtresse, me demandant dans une langue inconnue dont je percevais tout le sens : «Veux-tu que je te fasse découvrir mon monde?»
J’en oubliai jusqu’à ma mère, anxieuse, en retrait, et de ce jour j’ai toujours eu du mal à refuser chaque nouvelle proposition de ce genre. La dernière en date fut celle que je me fis à moi-même de ce pays-ci où je suis de passage comme beaucoup d’entre vous.
© CANTILÈNE de Diego Jorquera
En fait, ce qui lui faisait souci n’était pas tant d’avoir à assurer la subsistance de sa progéniture, ça non, elle y arrivait très bien. Mais elle aurait aimé pouvoir le faire autrement.
Certes, monsieur Parsifle n’était pas un méchant homme, pas plus que les précédents. Jamais il ne la contraignit à quoique ce fut en échange de ses largesses. Et il était très gentil, presque paternel, avec nous. Non, le problème ne venait pas de là, bien qu’un peu plus de présence pour elle n’aurait nuit à personne.
C’est plutôt de ses idées, comment dire…farfelues, que provenait la gêne de ma mère. Oh, bien sûr son enfance, son histoire et la dure réalité de son sort de jeune émigrée urbaine et veuve ne la prédisposaient pas à la galéjade mais quand même!
Bon d’accord, la fois où il avait rapporté un lézard manchot cela nous avait prodigieusement intéressés. Surtout Manuel, qui s’était entiché de la bestiole au point de vouloir l’appareiller : il lui avait fait porter une prothèse faite d’un cure-dents lié à un morceau de cartouche de stylo par un méchant bout de fil de fer.
Et le jour où, mystérieux et au bord du fou-rire, il avait extrait de son espèce de besace élimée un chat maigre dont les yeux semblaient plus gros que la tête, c’est Carlita que cela avait ravi cette fois-là. Jusqu’à ce que la pauvre bête agonise de trop manger ou de trop d’amour.
Mais le comble fut atteint lorsque, par une froide et humide fin d’après midi de septembre, tout le quartier fut alerté par une cavalcade effrénée dans la ruelle. Ce n’était rien d’autre que monsieur Parsifle essayant de rattraper un genre d’autruche, ou d’émeu, on ne le sut jamais puisque l’animal réussit à lui fausser compagnie. Il nous dit l’avoir troqué à un ancien directeur de zoo soûl rencontré dans un bar du port, contre une montre de gousset et quelques tournées de calva.
Il fut sans doute pénible à ma mère, mais elle estima que c’était devenu nécessaire, de donner congé à notre bienfaiteur.
Ceux qui lui succédèrent ne furent certes pas tous tristes, mais aucun n’arriva jamais à la cheville de monsieur Parsifle ; Augustin Pilatre de son prénom, cela ne s’invente pas! Nous fûmes tous attristés, et Carlita plus que quiconque, d’apprendre qu’Augustin avait fait une chute mortelle en voulant cueillir trois brins de génépi à sa nouvelle conquête.
Quant à moi, que l’âge et la pudeur convenue que cette société d’hommes attribue aux filles pubères aurait du rendre plus sage que mes frère et sœur, je crois que je fus inspirée par ce personnage plus que de raison.
Pas tant pour avoir affublé du prénom inspiré d’ “Auguste Bécasson” le stupide poupon de Carlita. Pas tant non plus pour avoir laissé celle-ci prendre froid par ma naïve inconséquence, une nuit de janvier où je prétendais surprendre par la fenêtre grand-ouverte des étoiles filantes traverser la brume, bien que cela fût sans doute à l’origine du mal qui emporta ma cadette.
Non, la principale inclination que je doive à Augustin est ce sentiment irréel qui se saisit de moi la nuit venue : je sens alors, avant de sombrer dans un sommeil agité, la certitude que je vais enfin dénicher l’animal le plus extraordinaire que recèle l’univers et qui délivrera ma mère de cette conviction imbécile que Carlita est quelque part dans le sud à vivre une vie meilleure.